|
Back
CD et livres: l’actualité de mai
05/15/2022
Au sommaire :
Les chroniques du mois
En bref
Face-à-face
ConcertoNet a également reçu
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Hervé Niquet dirige Phryné de Saint‑Saëns Hervé Niquet dirige Phryné de Saint‑Saëns
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Samuel Hasselhorn chante Schubert Samuel Hasselhorn chante Schubert
 Marko Letonja dirige Janácek Marko Letonja dirige Janácek
 La soprano Anna Prohaska La soprano Anna Prohaska
 Ecrits de Theodor Adorno Ecrits de Theodor Adorno
  Oui ! Oui !
Emőke Baráth chante Haendel
Le Quatuor Belcea interprète Brahms
Alexey Zuev interprète Stravinski
Evgueni Svetlanov dirige Stravinski et Svetlanov
Thomas Van Haeperen dirige Lenot
Florent Albrecht interprète Field
Herbert Blomstedt dirige Mozart et Vorísek
Thomas Jensen dirige Sibelius
Le chef d’orchestre Charles Munch
Le chef d’orchestre Michael Stern
John Wilson dirige Respighi
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Witold Rowicki dirige Tchaïkovski
Le chef Heinz Rögner
Le Ludwig Orchestra
Herbert Blomstedt dirige Brahms
Lahav Shani dirige Weill et Chostakovitch
Le OFF interprète Strauss
Andrew Manze dirige Mozart
Roger Norrington dirige Schumann
Pablo Heras Casado dirige Schumann
Nicholas Collon dirige Sibelius
Alessandro Crudele dirige Respighi
Julia Fischer interprète Tchaïkovski
Lars Vogt interprète Mendelssohn
Pas la peine
Tugan Sokhiev dirige Chostakovitch
Olga Pashchenko interprète Mozart
Kristian Bezuidenhout interprète Beethoven
Semyon Bychkov dirige Mahler
Hélas!
La soprano Sarah Traubel
En bref
Field, l’« inventeur » du nocturne
Deux chefs derrière le Rideau de fer
Blomstedt : leçon de style dans Brahms
Chostakovitch : avantage Shani
Les Belcea en excellente compagnie
Le Ludwig Orchestra en dance band
Les libres propos de Jacques Lenot
Tout le piano de Stravinski
Svetlanov à Paris
Strauss orchestral ou chambriste ?
Field, l’« inventeur » du nocturne

Florent Albrecht (né en 1975) n’est pas adepte de la facilité : pour son premier album, publié à un âge où certains, avant lui, avaient déjà presque achevé leur carrière discographique, il choisit une intégrale des Nocturnes par John Field (1782‑1837). Le compositeur irlandais, créateur d’un genre très vite adopté par Chopin – qui en reprit le schéma quasi immuable (dans un tempo modéré, une main droite belcantiste, volontiers ornementée et accompagnée par une main gauche égrenant des arpèges réguliers) – et prolongé par Fauré, pourrait pâtir de ce voisinage encombrant mais Albrecht parvient à valoriser sa musique. D’abord en choisissant un pianoforte à mécanique viennoise du facteur napolitain Carlo de Meglio (1826), accordé selon un tempérament inégal et aux harmoniques légères permettant de jouer de cette « pédale d’atmosphère » typique du jeune Chopin. Ensuite en soignant le texte par une recherche des manuscrits ou sources les plus anciennes, ce qui le conduit en outre à écarter deux pièces abusivement qualifiées de nocturnes par des éditeurs peu scrupuleux et à inclure en revanche un inédit pétersbourgeois : il n’y en a toutefois que dix‑sept ici, écrits entre 1812 et 1837, et on ne comprend pas pourquoi tous ne peuvent trouver leur place sur le disque, qui dure à peine plus d’une heure, alors que l’interprète précise dans la notice que « pour ne pas dépasser la durée du CD, la version non inédite de l’opus posthume et le Nocturne VII sont uniquement disponibles en streaming ». Enfin et surtout, le pianiste français adopte le ton juste, tout en délicatesse et sans mièvrerie, sans que cette succession de pages de même caractère ne finisse par susciter l’ennui (Hortus 197). SC
Deux chefs derrière le Rideau de fer
 
.
Les archives radiophoniques allemandes offrent l’occasion de mieux appréhender l’art de deux chefs qui, s’ils se sont régulièrement produits à l’étranger, n’en ont sans doute pas moins souffert d’appartenir à une génération qui s’est trouvée du « mauvais » côté du Rideau de fer.
Ainsi de Witold Rowicki (1914‑1989) qui, s’il a certes effectué des tournées avec la Philharmonie nationale de Varsovie, dont il a été le directeur musical pendant un quart de siècle, réalisé des enregistrements à l’étranger, notamment une intégrale des Symphonies de Dvorák à Londres (Decca), et exercé très brièvement des fonctions à Bamberg, demeure dans les mémoires essentiellement pour ses disques de musique polonaise. Les inépuisables archives de la SWR (Radio de l’Allemagne du sud‑ouest) permettent de l’entendre (en studio) dans des œuvres de Tchaïkovski, principalement deux symphonies, la Cinquième et la Sixième « Pathétique » (1962 et 1969). L’Orchestre de Baden‑Baden et Fribourg n’est pas toujours irréprochable, mais joue pleinement le jeu de ces interprétations entières, très expressives, exacerbant les sentiments, sensuelles et sauvages, lyriques et grandioses, mais jamais excessives et tenues d’une main de fer, dont témoignent de spectaculaires accélérations. Tour à tour charmeuse et incisive, la Suite de Casse‑Noisette avec l’Orchestre de Stuttgart (1979) bénéficie d’une meilleure qualité sonore (album de deux disques SWR Classic SWR19112CD).
Certains chefs originaires d’Allemagne de l’Est ou en activité dans ce pays ont acquis une renommée au‑delà du Mur, comme Tennstedt, Masur ou Flor, mais beaucoup d’autres, comme Bongartz, Kegel, Suitner ou Pommer, ne nous sont quasiment connus que par le disque. C’est également le cas de Heinz Rögner (1929‑2011), auquel l’éditeur Genuin rend hommage grâce à des enregistrements de la MDR (Radio de l’Allemagne centrale). Pianiste et altiste de formation, il a fait ses classes à l’ancienne à Weimar, avant d’occuper des fonctions à la Radio de Leipzig (1958), au Staatsoper de Berlin (1962) et, surtout, à l’Orchestre (mais aussi au Chœur) de la Radio de Berlin (1973‑1993), avec lequel il a fait de fréquentes apparitions au Japon, où il dirigeait également le Yomiuri Nippon Symphony. Mais il reste avant tout une personnalité de la vie musicale lipsienne, où, sans y exercer formellement des fonctions, il a très souvent dirigé à la fin de sa carrière, comme le montrent ces concerts captés au Gewandhaus entre 1994 et 2001 avec l’Orchestre ou la Philharmonie de chambre de la MDR, dont il était alors le premier chef invité de facto. Sans être suspect de complaisance avec le régime communiste, il n’a donc jamais quitté l’Allemagne (de l’Est), ce dont il a toutefois peut‑être conçu une secrète déception, comme le suggère la notice (en allemand et en anglais), d’une grande richesse, comprenant une biographie détaillée ainsi que des témoignages de musiciens, d’élèves, d’amis et de la famille. Ce coffret de quatre disques donne un aperçu du vaste répertoire d’un chef qui affichait une rare modestie, disant à ses musiciens qu’il était « là pour [leur] rendre les choses plus faciles ». Décrit de façon tout à fait pertinente par un critique comme « débordant de retenue », on ne dira pas pour autant qu’il fait preuve de componction. C’est plutôt de sérénité qu’on pourra en revanche parler, caractéristique qui réussit davantage à des œuvres telles que la Pastorale de Beethoven, toute de délicatesse et de lyrisme, sans doute aussi un peu indolente, ou à l’ouverture Mer calme et heureux voyage de Mendelssohn, qu’à l’Inachevée de Schubert, très posée. Sans aller jusqu’aux exigences hors norme d’un Celibidache, Rögner assume une lenteur assez fascinante, comme dans l’arrangement par Mahler du Quatuor « La Jeune Fille et la Mort » de Schubert. On attendait beaucoup de Reger, en quelque sorte le « régional de l’étape », mais si une minutie infinie s’accompagne d’une certaine poigne, celle‑ci ne se révèle toujours suffisante. Confirmation de goûts éclectiques mais pas idiomatiques pour deux groschen, Le Tombeau de Couperin de Ravel et Un Américain à Paris de Gershwin – on apprend que Rögner se faisait aussi pianiste de jazz pour les bals du Staatsoper – surprennent par leur suavité. La conclusion est cependant la plus convaincante, avec Bruckner, son compositeur de prédilection, dans une Sixième Symphonie qui respire magnifiquement (GEN 22742). SC
Blomstedt : leçon de style dans Brahms

Après deux albums consacrés respectivement aux deux premières symphonies de Brahms, Herbert Blomstedt (né en 1927) achève une intégrale par un seul album, au minutage généreux, regroupant les deux dernières, à l’image du programme qu’il dirigeait en décembre 2021 à l’Orchestre de Paris. Il est des Troisièmes plus impétueuses mais le résultat n’en est pas moins admirable : d’une assurance tranquille confinant à la sérénité, avec une souplesse et une subtilité infinies, le chef arrondit les angles d’autant qu’il est à la tête de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, dont on ne sait duquel des pupitres il faut louer le plus la somptuosité. Ce Brahms plus transparent et apaisé qu’emphatique ou tendu convainc peut‑être moins dans la Quatrième, où l’on peut préférer la noirceur et la vigueur de Karajan ou Kleiber mais n’enlève rien à ce qui, à bientôt 95 ans, constitue l’un des atouts de Blomstedt : une incontestable pertinence stylistique par‑delà les modes (Pentatone PTC 5186 852). SC
Chostakovitch : avantage Shani
 
Warner publie au même moment des enregistrements de deux symphonies de Chostakovitch, peut‑être les plus célèbres, enracinées dans la terreur de l’ère stalinienne et d’une qualité tellement aboutie que chacune est devenue un « classique » du genre, au répertoire de presque tous les chefs, spécialistes ou non du compositeur.
Dans la Cinquième (1937), Lahav Shani (né en 1989) trouve le ton juste, en concert avec le Philharmonique de Rotterdam où il a succédé en 2018 à Yannick Nézet‑Séguin dans les fonctions de chef‑dirigent. La dimension de « classique » est parfaitement assumée dans cette interprétation complète et équilibrée, sans excès de pathos ni passages à vide, mais qui a les défauts de ses qualités : une certaine neutralité expressive et une difficulté à restituer les enjeux historiques de la partition, entre affirmation de l’artiste face au pouvoir et « retour en arrière » après les audaces de la Quatrième. Dans une prise de son (en studio, cette fois‑ci) laissant davantage de place à la réverbération, le couplage est inattendu mais heureux avec une autre symphonie de ces années sombres, la Seconde (1933) de Weill, qui, sur le chemin de l’exil américain, acheva à Paris cette « Fantaisie symphonique » où l’on reconnaît sans peine l’ironie un peu sèche de l’auteur de L’Opéra de quat’sous, même s’il surprend parfois par ses inflexions mahlériennes, notamment dans le Largo central (0190295478346).
Avec son Orchestre national du Capitole, Tugan Sokhiev (né en 1977) a déjà enregistré la Huitième et devait diriger la Septième « Leningrad » le 18 mars. Les conséquences de l’invasion de l’Ukraine en ont décidé autrement et il est donc à craindre que cette série ne s’interrompe avec cette Dixième (1953), le chef russe ayant démissionné dans les conditions que l’on sait des fonctions de directeur musical qu’il exerçait depuis 2008. A la différence de Shani, l’enregistrement a été effectué en studio, ce qui pourrait contribuer à expliquer une sorte de distance et de monumentalité, un manque de tension, de rage, de noirceur, de mordant et d’ironie, même s’il faut saluer le sérieux et la probité de l’interprétation ainsi que la parfaite tenue de l’orchestre, sans doute moins favorisé par la prise de son, avec des soli (violon, cor anglais, clarinette, cor) très soignés (0190296377716). SC
Les Belcea en excellente compagnie

Après les Quatuors et le Quintette avec piano (avec Till Fellner), le Quatuor Belcea poursuit son parcours dans l’œuvre de Brahms avec les deux Sextuors, pour lesquels il a ici aussi trouvé des partenaires à sa hauteur, l’altiste Tabea Zimmermann et le violoncelliste Jean‑Guihen Queyras. Sans surprise, la qualité instrumentale est exceptionnelle, tant dans la sonorité que dans la virtuosité et la mise en place, époustouflante dans les passages rapides. Cette excellence est mise au service d’une approche volontiers épurée, plus classique que romantique, conférant à ces deux œuvres la sérénité de sérénades mozartiennes. Dès lors, ceux qui en attendraient à la fois davantage d’aspérités ou de rondeur seront déçus (Alpha 792). LPL
Le Ludwig Orchestra en dance band

Bonne sélection de crossover que ce « Dance With Me » du Ludwig Orchestra, avec le concours de l’arrangeur Bill Elliott, pas très convaincant pour la partie vocale cependant. De fait, la sélection de danses latino, du cha‑cha ¿Quién será? de Pablo Beltrán Ruiz dans une excellente adaptation d’Elliot à la samba Lambada du groupe Kaoma arrangée par Greg Anthony Rassen, de danses de salon comme le one‑step Ruffy Ruffles de Green et Irwin arrangé par Bill Cahn, la mythique valse viennoise « I could have danced all night » de My Fair Lady de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner également arrangée avec des trésors d’imagination par Elliott, de même que le tube Moonlight Serenade de Glenn Miller qui ouvre le programme, sont d’excellents choix. Et le Ludwig Orchestra, enrichi d’un fameux quatuor de saxophones, le Quatuor Berlage, joue tout cela avec un chic parfait. La salsa Copacabana de Barry Manilow dans l’arrangement de Rassen prend des couleurs tropicales torrides avec le concours de la trompettiste Lucienne Renaudin Vary. Mais... le choix du soprano canadien Barbara Hannigan, excellent dans le répertoire contemporain, et ses propres choix, disqualifient un peu l’entreprise : la tiédeur qu’elle instille à Youkali de Kurt Weill, que l’on a connu autrement défendu par Teresa Stratas en 1981 sur un fameux enregistrement Nonesuch ou par tant d’autres depuis, et la fadeur de « I could have danced », pour lequel il n’est guère besoin d’aller chercher plus loin que l’original, découragent rapidement. Citons encore la nostalgie qu’insuffle cet ensemble à la valse anglaise Je veux t’aimer, trésor de Robert Stolz, et l’urgence rythmique dans le célébrissime quickstep Whispering de John Schonberger, le swing d’In the Mood, jive de Wingy Manone encore revu par Elliott, et la mélancolie du Salut d’amour d’Elgar qui clôt l’album pour achever de qualifier ce magnifique programme de divertissement de ce formidable dance band et de reflet des spectacles qu’il donne maintenant dans le monde entier (Alpha 790). OB
Les libres Propos de Jacques Lenot

Parution tardive que celle des Propos recueillis de Jacques Lenot : l’œuvre a été écrite en 2011, la création de l’intégralité de ses douze pièces est intervenue en mai 2016, par l’ensemble belge Sturm und Klang dirigé par Thomas Van Haeperen, et l’enregistrement a été réalisé en février 2017 par les mêmes. Douze mouvements, sans autre titre qu’une simple numérotation de I à XII, Propos recueillis mais aussi, en quelque sorte, recueil de propos puisqu’il s’agit ici d’« un essai de transcription et d’orchestration » successivement de six lieder pour contralto de 2007 sur des poèmes d’Else Lasker‑Schüler et de deux triptyques de 2011 (voir ici), l’un pour piano inspiré par Hölderlin et Faulkner, l’autre pour violon et piano de nouveau par Lasker‑Schüler. Douze est également le nombre des instruments, quatre bois, trois cuivres et cinq cordes, dont la prise de son très mate ne favorise pas la fusion et la séduction des timbres. Ce n’est toutefois pas l’essentiel, car la musique de Lenot est avant tout expression, lyrisme et sensibilité dont on n’est pas frustré près d’une heure durant (L’Oiseau prophète 006). SC
Tout le piano de Stravinski

D’abord curiosité – l’œuvre pianistique de Stravinski demeure peu connu – puis perplexité – on pensait que ce corpus était relativement peu développé, mais voici un coffret de cinq disques, plus de cinq heures et demie de musique, avec un bon lot de « premières mondiales » ! Il est vrai qu’il s’agit des « Complete Piano Solos & Transcriptions » de celui qui était par ailleurs un estimable pianiste et un compositeur ayant pour habitude d’écrire à son clavier. Pour ce qui est des musiques originales, elles couvrent une période relativement courte, si l’on excepte deux très brèves esquisses pour une sonate (sérielle) de 1966 : à des œuvres relativement développées, comme la rachmaninovienne Sonate en fa dièse mineur (1905), les scriabiniennes Etudes opus 7 et les néoclassiques Sonate de 1924 et Sérénade en la s’ajoutent de courtes pièces s’inscrivant dans un éventail stylistique très large, depuis les Tarantelle (1898) inachevée et Scherzo (1902) de jeunesse jusqu’à l’humour au énième degré de Praeludium, Tango et Circus Polka en passant par l’ambiance « groupe des Six » des Cinq Doigts et de Piano‑Rag‑Music ou par les circonstanciels Souvenir d’une marche boche (1915) et Valse pour les enfants (Une Valse pour les petits lecteurs du Figaro) (1917).
La principale découverte de cette publication réside dans la quantité insoupçonnée de transcriptions réalisées par Stravinski lui‑même, posant immédiatement une question restant sans véritable réponse, hormis pour celle très connue de Petrouchka (Trois Mouvements) réalisée pour Rubinstein et dont tous les virtuoses se sont ensuite saisis : à qui étaient‑elles destinées, au vu de leur très grande difficulté technique ? Toujours est‑il que ballets et œuvres scéniques y tiennent la plus grande part : L’Oiseau de feu, Apollon musagète (presque méconnaissable), Le Baiser de la fée et Jeu de cartes dans leur intégralité, la Grande Suite de L’Histoire du soldat, douze numéros de Pulcinella, l’Ouverture de Mavra et le début de Renard. Les autres transcriptions comprennent le poème symphonique Le Chant du rossignol, Ragtime, deux des Trois pièces faciles pour piano à quatre mains, une des minuscules Berceuses du chat, le choral des Symphonies pour instruments à vent et même le chœur du Prologue de Boris Godounov de Moussorgski. Pour l’interprète, le défi est évidemment colossal : avec Alexey Zuev (né en 1982), ça fuse, ça éclate, ça explose, il fonce, il y va joyeusement, le piano mettant en valeur la modernité de l’écriture par l’accent mis sur la dimension rythmique et par la lumière crue projetée sur les harmonies (Fuga Libera FUG 777). SC
Svetlanov à Paris

Cela fait tout juste vingt ans, le 3 mai 2002, qu’Evgueni Svetlanov est décédé à Moscou à l’âge de 73 ans. A cette occasion, parmi les concerts qu’il donnait régulièrement à la fin de sa carrière à la tête des formations de Radio France – on se souvient ainsi d’une bouleversante Mer de Debussy avec le National en 2001 (Naïve) – sont publiés pour la première fois des témoignages à la tête du Philharmonique de Radio France. En mars 1999 à Pleyel, c’est un Petrouchka (1911/1947) de Stravinski fortement personnel et haut en couleur, où Svetlanov prend son temps comme il savait si bien le faire, c’est‑à‑dire en mettant en valeur les détails d’orchestration mais sans jamais distendre pour autant le discours, bien au contraire, car l’œuvre aura rarement paru aussi colorée, dramatique et expressive, le « Philhar’ » déployant cette « sonorité puissante et riche » remarquée par Gaëlle Plasseraud dans le compte rendu qu’en avait alors publié ConcertoNet. Svetlanov dirigeait également ses propres œuvres, comme sa Première Symphonie en avril 1999 et ici, en avril 2001 (et non 2002 comme indiqué par erreur dans la notice), la création française de son Poème (1975) pour violon et orchestre à la mémoire d’Oïstrakh. Le soliste en était Vadim Repin (né en 1971), l’un des partenaires privilégiés de ses programmes parisiens (et qui interprétait par ailleurs ce soir‑là le Concerto de Miaskovski). Avec un maximum d’engagement et une sonorité splendide, le violoniste russe magnifie une partition stylistiquement égarée dans son siècle mais d’une belle puissance expressive (Warner Classics 5054197145421). SC
Strauss orchestral ou chambriste ?

Le OFF est un « collectif » de musiciens de l’Orchestre de Paris qui se donne pour ligne de conduite de « concevoir la musique de chambre et le répertoire orchestral comme un tout indissociable ». Bien que curieusement sous‑titré (en anglais dans le texte) « Chamber Music Works », l’album présente un programme fidèle à cette déclaration d’intentions avec plusieurs œuvres de Richard Strauss, originales ou arrangées, dont le statut apparaît hybride : adaptation pour cinq musiciens (et condensation de moitié) d’un poème symphonique par Franz Hasenöhrl, sous le titre Till Eulenspiegel, pour une fois autrement !), prélude d’opéra initialement écrit pour une formation de chambre (Sextuor de Capriccio), œuvre dont l’effectif n’est plus vraiment chambriste mais pas encore orchestral (Sérénade en mi bémol pour treize instruments) et adaptation pour septuor à cordes par Rudolf Leopold d’une page pour orchestre de vingt‑trois cordes (Métamorphoses, qui donne son titre à l’album – mais sans l’accent aigu). On passe une heure agréable à écouter l’arrangement un peu étique de Hasenöhrl, le magnifique Prélude de Capriccio, la charmante et rare Sérénade de jeunesse et le très habile passage de vingt‑trois à sept cordes des tardives et sublimes Métamorphoses. Dommage que la matité de l’enregistrement ne mette pas au mieux en valeur le talent et l’excellence instrumentale des vents et cordes de l’Orchestre de Paris (NoMadMusic NMM100). SC
Face-à-face
Mozart : Symphonie « Prague »
 
Datée du 6 décembre 1786, la Trente‑huitième Symphonie a été créée le mois suivant à Prague, ville chère au cœur de Mozart, qui, pour sa première visite, se conformait peut‑être à une habitude locale en composant une symphonie en trois (amples) mouvements, sans menuet en troisième position, et, surtout, mettait en valeur la qualité des bois pragois. Deux versions récentes viennent non pas de la capitale tchèque mais d’Allemagne.
Après les deux dernières symphonies réalisées à la Radio bavaroise en 2013 et 2017 (voir ici), Herbert Blomstedt (né en 1927) dirige cette fois‑ci l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, enregistré en concert en septembre 2020. Nulle fatigue – il s’offre le luxe de respecter toutes les reprises, portant la durée de l’œuvre à près de 40 minutes – et, surtout, un souci constant de luminosité, de clarté et de simplicité : il est des interprétations plus conflictuelles et motivées, mais il est difficile de rester insensible aux soyeuses sonorités lipsiennes. Le complément de programme confirme que Blomstedt conserve une certaine prédilection pour des répertoires négligés, avec la Symphonie en ré (1821) de Jan Václav Vorísek (1791‑1825), Tchèque établi à Vienne dès 1813. Quelle formidable énergie chez ce chef de 93 ans, qui rend justice aux contrastes romantiques, notamment de l’Andante et du Scherzo (en mineur), particulièrement réussi, presque déjà un furiant à la Dvorák ! C’est donc à la fois enfin une alternative à l’enregistrement de décembre 1950 d’Ancerl avec la Philharmonie tchèque (Supraphon) et une occasion de redécouvrir cette œuvre qui soutient la comparaison avec les premières symphonies de Schubert ou celles de Weber (Accentus ACC30574).
En studio en mars 2021, Andrew Manze (né en 1965) observe lui aussi toutes les reprises, de telle sorte que le premier mouvement dure plus de 18 minutes ! A la tête d’une fort convenable Philharmonie de la Radio de la NDR (Hanovre) dont il est le Chefdirigent depuis 2014, il défend une approche assez sage et consensuelle, parfois même un peu éteinte, compromis prudent entre les deux grandes écoles stylistiques, « baroqueuse » et « moderne », qui manque moins de soin que d’élan. La splendide Trente‑neuvième bénéficie peut‑être d’un peu plus d’éclat et de peps (SACD Pentatone PTC 5186 765). SC
Schumann : les quatre Symphonies
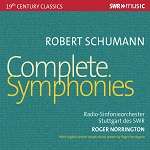 
Composées en dix ans seulement (1841‑1851), les Symphonies de Schumann n’ont pas tout à fait acquis la réputation de celles de Beethoven ou de Brahms, ne serait‑ce qu’en raison d’une orchestration souvent dénigrée. Elles n’en sont heureusement pas moins solidement installées au concert comme au disque, où une réédition et une nouveauté viennent tenter de se mesurer avec Paray, Szell, Sawallisch, Bernstein... on en oublie évidemment !
En novembre dernier, Roger Norrington a annoncé qu’à l’âge respectable de 87 ans, il mettait fin à sa carrière. Parmi ses intégrales symphoniques actuellement rééditées et réalisées avec feu l’Orchestre de la SWR de Stuttgart, dont il a été le directeur musical de 1998 à 2011, celle consacrée à Schumann, captée en concert en septembre 2004 et précédée de courtes introductions en anglais, se révèle d’un intérêt inégal. Sans surprise avec le chef anglais, qui avait déjà enregistré les Troisième et Quatrième quinze ans plus tôt avec ses London Classical Players (sur instruments « anciens »), certains choix déroutent et l’orchestre paraît parfois un peu sec, mais les symphonies paires apparaissent moins réussies que les impaires, avec une Deuxième assez laborieuse (malgré l’admiration qu’il professe pour l’œuvre) et une Quatrième (dans sa version originale de 1841, préférée de Brahms) hésitant entre pesanteur et vigueur (album de deux disques SWR Music SWR19530CD).
Si Pablo Heras Casado, comme Norrington, défend volontiers des interprétations « historiquement informées », à l’image de ses (trop raides) enregistrements beethovéniens avec l’Orchestre baroque de Fribourg (voir ici), on en est très loin ici avec le confort et la plénitude sonore de l’Orchestre philharmonique de Munich. Cette intégrale, plus homogène, plus conventionnelle et mieux enregistrée que celle de Norrington, ne présente pas de points faibles, mais guère de points saillants non plus (album de deux disques Harmonia mundi HMM 902664.65). SC
Sibelius : Septième Symphonie (1)
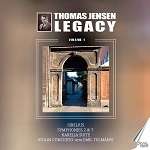 
1923 : Schönberg « invente » invente le dodécaphonisme, mais n’en convient pas moins qu’il reste beaucoup de chefs‑d’œuvre à écrire en ut majeur. C’est précisément ce que Sibelius fait l’année suivante dans la dernière de ses symphonies – malgré des tentatives dont n’ont subsisté que les rares esquisses ayant échappé à sa vigilance (voir ici), il n’y aura pas de Huitième. Même si elle entretient, dans sa conception, des liens avec les deux précédentes, elle demeure unique dans son corpus symphonique, ne serait‑ce que par sa construction d’un seul tenant... comme la Première Symphonie de chambre de Schönberg. Dans deux enregistrements d’archives mais aussi dans deux versions récentes, aucun chef finlandais – ils sont pourtant nombreux et talentueux ! – mais ces publications confirment que cette musique ne leur est pas réservée.
Une des (nombreuses) embûches de cette Septième consiste à assurer la continuité des différents épisodes durant près de 25 minutes. Défi relevé en vrai sibélien par Thomas Jensen (1898‑1963) dans le premier volume, intégralement consacré au compositeur, d’une série que Danacord publie en hommage à celui qui fut chef permanent de l’Orchestre symphonique de la Radio danoise à partir de 1957. Outre cette Septième réalisée en studio pour la radio (27 mai 1963), contrastée, colorée et tellurique, la Deuxième, captée quant à elle en concert (juillet 1962) mais également une première au disque, malgré quelques imperfections, vaut par sa fantastique tension, son sens dramatique, sa puissance et son souffle. Vie, naturel, franchise, sens épique et narratif caractérisent les admirables compléments réalisés plus tôt pour Decca que sont la Suite « Karelia » (juin 1952) et, surtout, les Quatre Légendes (juillet 1953), même si l’on a bien sûr entendu plus somptueux cor anglais dans Le Cygne de Tuonela. Dans le Concerto pour violon (avril 1952), Emil Telmányi (1892‑1988), le gendre de Nielsen, très en délicatesse avec la précision, donne l’impression de jouer sa vie à chaque note. Nul doute que la suite de cette série sera au moins aussi captivante, notamment si elle permet d’entendre le chef dans la musique de Nielsen, dont il fut l’élève avant de devenir l’un des interprètes les plus inspirés (album de deux disques DACOCD 911).
Le Symphonique de Boston compte parmi les orchestres éminemment sibéliens – il donna la première américaine de cette Septième dès 1926 sous la direction de Koussevitzky. Ce n’est pas en revanche le qualificatif qu’on accole spontanément au nom de Charles Munch, qui en fut le music director de 1949 à 1962. Pourtant, il la dirigeait régulièrement, même si ce témoignage capté en concert (30 juillet 1965) et accompagné de ses encouragements coutumiers de la voix est tout sauf orthodoxe : installant un climat digne des Métamorphoses de Strauss, il transforme l’œuvre en une grandiose et puissante élégie, d’un lyrisme éperdu et d’une lenteur admirable (8 minutes de plus que Jensen), culminant dans une péroraison absolument homérique. Le reste de cet album de deux disques n’est hélas pas du même niveau, malgré une Centième Symphonie « Militaire » de Haydn – un compositeur qui lui réussissait toujours – dynamique, charnue et savoureuse (concert du 9 octobre 1959) et une Cinquième de Beethoven (29 janvier 1960) entre poigne et démesure mais qui n’apporte pas davantage que son enregistrement officiel en studio de mai 1955. C’est surtout le Requiem allemand de Brahms donné à Tanglewood le 19 juillet 1958 qui pose problème car peu de choses parviennent à émerger du brouillard très épais de la prise de son, parmi lesquelles hélas la méforme vocale et stylistique des solistes, Hilde Güden et Donald Gramm. Il est vrai que l’éditeur n’est pas très regardant sur la qualité sonore ou même éditoriale, annonçant non pas la Septième de Sibelius... mais En saga ! Regrettable, pour le moins (Urania WS 121.397). SC
Sibelius : Septième Symphonie (2)
 
Après les enregistrements d’archives, place à deux versions récentes venues des Etats‑Unis et, quand même, de Finlande.
Michael Stern (né en 1959) opte pour la sérénité et l’apaisement, préférant la poésie à la puissance, quitte à paraître un peu trop tendre, avec la solide contribution de l’Orchestre symphonique de Kansas City dont il est le music director depuis 2005. Proposant un intéressant programme de « symphonies en un mouvement », le chef américain convainc que le postromantisme assumé de la Première de Barber (d’un seul tenant mais en quatre parties nettement circonscrites) vaut largement le détour et anime d’un bel élan le Poème de l’extase (effectivement parfois qualifié de « quatrième symphonie » de Scriabine), plus conquérant que capiteux (Reference Recordings RR‑149).
Ayant succédé en 2021 à Hannu Lintu à la tête de l’Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, Nicholas Collon (né en 1983) est devenu le premier non‑Finlandais à exercer les fonctions d’ylikapellimestari auprès de cette formation presque centenaire. Le chef anglais bénéficie d’une meilleure belle prise de son et réussit particulièrement la section vive de la symphonie, très dynamique voire dramatique, mais peut‑être parce qu’il porte trop d’attention aux détails aux dépens de la ligne, son interprétation semble trop prosaïque et manquer de spiritualité et de chaleur. Dommage, car en complément de cet album, les Suites des musiques de scène pour Le Roi Christian et Pelléas et Mélisande sont bien plus vivantes et colorées (Ondine ODE 1404‑2). SC
Respighi : Pins de Rome
 
Huit ans après Fontaines de Rome, le compositeur conçoit le deuxième élément de ce qui formera, avec Fêtes romaines (1928), sa « trilogie romaine » de poèmes symphoniques. Bien que défendue en son temps par Toscanini et de nos jours par Muti, cette musique – pourquoi ne pas le reconnaître ? – n’a pas bonne presse : à des considérations d’ordre esthétique sur la faiblesse du développement des thèmes ou sur le kitsch de la démarche (tels ces chants d’oiseaux enregistrés dans « Les Pins du Janicule ») s’ajoute un contexte politique où, deux ans après la Marche sur Rome, Respighi, qui s’est vu reprocher ses sympathies pour le régime fasciste, conclut son œuvre sur une marche pesante (« Les Pins de la voie appienne ») par laquelle « une armée consulaire [...] monte triomphalement au Capitole ». Mais le public, depuis un siècle, y trouve son compte, soit qu’il assume son mauvais goût, soit qu’il apprécie un orchestrateur hors pair, nourri de son séjour en Russie, notamment auprès de Rimski‑Korsakov, et d’une remarquable assimilation des maîtres de l’époque en la matière (Strauss, Debussy). Il suffit donc d’un (très) bon orchestre et d’un chef qui y croit – mais sans en faire trop. A défaut de Rome, deux versions récentes nous à conduisent à Londres : cela tombe bien, les bons orchestres n’y manquent pas.
John Wilson (né en 1972) a recréé en 2018 le Sinfonia de Londres, une formation « pickup » qui convainc sans difficulté dans les Pins mais aussi dans les deux autres parties de la trilogie (curieusement présentée dans l’ordre Fêtes-Fontaines-Pins). Les choses restent sous contrôle – les lions pourraient rugir davantage dans « Circenses » – mais l’ensemble, à la fois spectaculaire et de bon goût, a peut‑être également un petit côté light music qui n’est pas déplacé du tout (SACD Chandos CHSA 5261).
Le Philharmonique de Londres n’est pas avantagé par la prise de son – il est vrai qu’il est difficile de lutter avec Chandos – à la fois trop lointaine pour donner une bonne image d’ensemble et trop proche pour ne pas susciter l’impression de coups de projecteur successifs sur les détails dont ne manque pas une telle partition. Alessandro Crudele (né en 1974) paraît un peu moins engagé, plus distant que Wilson, et davantage motivé par le reste de son programme, il est vrai tout à fait intéressant : les trois Impressions brésiliennes (1928), qui traduisent une certaine conception de la couleur locale, et la Suite en quatre parties du ballet Belkis, reine de Saba (1932), qui lorgne parfois franchement du côté de Shéhérazade quand elle n’annonce pas Khatchatourian (Linn CKD692). SC
ConcertoNet a également reçu
 Sarah Traubel Sarah Traubel
Dans un album intitulé « In meinem Lied » (mots qui concluent « Ich bin der Welt abhanden » de Mahler), la soprano allemande (née en 1986), petite‑nièce de la soprano Helen Traubel (et du chef Günter Wand), explore différents aspects du répertoire (post)romantique germanique, autour de quatre des cinq Rückert‑Lieder de Mahler et des Quatre derniers lieder de Strauss, associés à quatre lieder de Liszt et quatre lieder de Korngold, mais elle ne peut faire valoir qu’une diction quasi radiographique, décevant, pour le reste, par des aigus trop souvent aigres et brisés, des graves inexistants, un timbre froid et frêle et un manque presque constant d’engagement. Et pour tout arranger, son partenaire, Helmut Deutsch (né en 1945), ne se situe pas à son niveau coutumier d’excellence (Aparté AP288). LPL
 Olga Paschchenko : Mozart Olga Paschchenko : Mozart
Bien accompagnée par l’orchestre baroque Il gardellino de Jan De Winne et Marcel Ponseele, la pianiste russe (née en 1986) a choisi deux des plus beaux concertos. Elle y insuffle beaucoup de vie et de vigueur, son pianoforte étant hyperactif même dans les tutti, au risque de devenir trop carrée et brutale, davantage dans le Dix‑septième que dans le Neuvième « Jeunehomme », plus équilibré, tandis que l’opportunité de certaines de ses initiatives, proches de la minauderie, est fortement questionnable (Alpha 726). LPL
 Kristian Bezuidenhout : Beethoven Kristian Bezuidenhout : Beethoven
Précédé de deux albums, celui‑ci, enregistré voici près de cinq ans, apporte la touche finale à l’intégrale des Concertos entreprise par le (forte)pianiste sud‑africain (né en 1979) dans le cadre de l’« Edition Beethoven 2020‑2027 » d’Harmonia mundi. Telle est notre époque : accents marqués voire coups de boutoir sont de mise, comme s’il était nécessaire de surjouer le drame sous‑jacent au Troisième Concerto. A la raideur du phrasé, auxquels s’ajoutent quelques maniérismes, ornements dérogatoires et le parti pris agaçant, pour le soliste, de ponctuer les tutti d’accords ou d’arpèges. Le tempo est évidemment plutôt rapide, et même bousculé dans l’Allegro con brio initial du Premier Concerto. Pablo Heras‑Casado (né en 1977), à la tête de l’excellent Orchestre baroque de Fribourg, n’est hélas pas en reste. En fin de compte, comme dans beaucoup de versions actuelles se disant animées par une approche « historiquement informée », on en apprend donc davantage sur ce qu’est aujourd’hui l’interprétation beethovénienne que sur les œuvres proprement dites. Dommage que le meilleur d’un programme concertant se trouve dans... les cadences (retravaillées par le pianiste), qui permettent de goûter pleinement la qualité de l’instrument, copie (1989) d’un Conrad Graf de 1824 réalisée par le facteur américain Rodney Regier (HMM 902412). LPL
 Julia Fischer : Tchaïkovski Julia Fischer : Tchaïkovski
Pentatone réédite l’album enregistré en avril 2006 par la violoniste allemande (née en 1983), qui semble aborder de façon un peu embarrassée le Concerto, entre souci de maintenir une prudente retenue et initiatives plus contrastées. Sa musicalité et, bien sûr, sa virtuosité trouvent peut‑être mieux à s’exprimer dans la Sérénade mélancolique et Scherzo‑Valse. A la direction de l’Orchestre national de Russie comme au piano (dans le triptyque Souvenir d’un lieu cher qui complète le programme), on a plaisir à retrouver le regretté Yakov Kreizberg (1959‑2011) : bien plus qu’un accompagnateur, c’est en effet un musicien complice de la soliste, avec laquelle il a réalisé de nombreux autres disques (SACD PTC 5186 095). SC
 Lars Vogt : Mendelssohn Lars Vogt : Mendelssohn
Parmi les œuvres concertantes, le (Second) Concerto pour violon domine sans conteste, mais les pages où le piano est soliste peuvent néanmoins faire valoir le charme et la sensibilité coutumières du compositeur. C’est sans doute aux liens noués entre le pianiste allemand (né en 1970) et l’Orchestre de chambre de Paris, dont il est le directeur musical depuis 2020, qu’on doit ces versions presque chambristes, faisant dialoguer un piano d’une belle finesse, bien placé au premier plan par la prise de son, et un effectif instrumental assez peu fourni. Cette approche bénéficie sans doute davantage au Second Concerto, moins connu et plus intimiste, et au Capriccio brillant qu’au Premier, qu’on a entendu plus éclatant (Ondine ODE 1400‑2). SC
 Semyon Bychkov : Mahler Semyon Bychkov : Mahler
Avec celui qui en est le šéfdirigent depuis 2018, la Philharmonie tchèque se lance dans un « nouveau voyage » mahlérien, quarante ans après l’achèvement d’une intégrale de référence sous la direction de Václav Neumann. Cette musique est donc dans les gènes de l’orchestre mais malgré le choix de la relativement modeste Quatrième pour entamer ce parcours, on est franchement déçu par une interprétation hésitant entre pusillanimité et maniérisme. Dommage, car le lied final est dévolu à l’excellente soprano Chen Reiss (Pentatone PTC 5186 972). LPL
La rédaction de ConcertoNet
|