|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de novembre
11/15/2016
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Juanjo Mena dirige Albéniz Juanjo Mena dirige Albéniz
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Marin Alsop dirige Bernstein Marin Alsop dirige Bernstein
 Trois ballets de Lloyd Newson Trois ballets de Lloyd Newson
 La Musique au temps de Louis XIV La Musique au temps de Louis XIV
 Gabriel Tchalik interprète Locatelli Gabriel Tchalik interprète Locatelli
 Le TrioSono Le TrioSono
 Paul McCreesh dirige Le Pré aux clercs Paul McCreesh dirige Le Pré aux clercs
 Hermann Bäumer dirige Gernsheim Hermann Bäumer dirige Gernsheim
  Oui ! Oui !
Vladimir Jurowski dirige un hommage à Svetlanov
Andrea Chénier à Londres (2015)
Le Quatuor Bingham interprète Bridge et Scott
Raphael Terroni interprète L. Berkeley
Norman Del Mar dirige Bantock
Le Manuscrit XIV 726 du couvent des Minorites de Vienne
Enrico Gatti interprète Corelli
La Musique de film en France
Concertos baroques autour de Monica Huggett
Friedrich Haider dirige Les Joyaux de la Madone
Benjamin Schmid interprète Wolf-Ferrari
Le Viol de Lucrèce à Glyndebourne (2015)
Josef Vlach et l’Orchestre de chambre tchèque
La musique au temps de Rubens
Pablo González dirige Granados
Theodore Kuchar dirige Erkin
Rumon Gamba dirige des compositeurs britanniques
Le Trio Enescu interprète Enesco et Arenski
Anthologie Armin Jordan
Enrique Mazzola dirige Dinorah de Meyerbeer
Gerd Albrecht dirige Weinberger
Anthologie Georges Prêtre
Wolfgang Doerner dirige Auber
Symphonistes anglais chez Lyrita
Le compositeur Humphrey Searle
David Measham dirige Josephs
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Baptiste Romain et Le Miroir de musique
Johannes Pramsohler interprète Montanari
Stefano Romani dirige Il campiello de Wolf-Ferrari
Alfred Walter dirige Spohr
Le violoncelliste Alexander Rudin
Anthologie Evgueni Mravinski
Vernon Handley dirige Rootham
Le compositeur Alfred Butterworth
Le compositeur Peter Racine Fricker
Martyn Brabbins dirige Chagrin
Pas la peine
Marco Pedrona et Marco Montanelli interprètent Tessarini
Frieder Bernius dirige la Passion selon saint Matthieu
Le Concerto Köln
Ira Hochman dirige C. P .E. Bach
Le compositeur Arnold Cooke
Paul Mann dirige O’Brien
En bref
Auber: enfin?
Encore une version recommandable du Viol de Lucrèce
Anthologies de chefs (1): Armin Jordan
Anthologies de chefs (2): Evgueni Mravinski
Anthologies de chefs (3): Georges Prêtre
Voyage en Anatolie avec Erkin
Enesco et Arenski: premiers trios
Une Dinorah venue de Berlin
Le Royaume-Uni, l’autre pays de la symphonie
Réjouissant florilège baroque concertant
Double hommage à Weinberger et à Gerd Albrecht
Granados s’invite à l’orchestre
Josef Vlach prend la baguette
Portrait musical de l’Europe du début du XVIIe siècle
Wolf-Ferrari (1): un essai vériste
Wolf-Ferrari (2): dernier hommage à Goldoni
Wolf-Ferrari (3): une déclaration en forme de concerto
Rumon Gamba revisite le Royaume-Uni
A la découverte de Hertel
Spohr: retour d’une intégrale
Carl Philipp Emanuel Bach peu inspiré
La terne carte de visite du Concerto Köln
Une Saint Matthieu en petite forme
Auber: enfin?

Source inépuisable de lumineuse gaîté, la musique de Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) reste un remède inégalé, année après année, pour lutter contre les longues soirées d’hiver maussades. Las, on ne peut que constater le peu de projets que suscite son œuvre pourtant conséquente – ses acolytes français Hérold et Adam (exception faite de son insubmersible ballet Gisèle) n’ayant pas davantage la faveur des programmateurs, au disque comme au concert. Ce répertoire saura-t-il un jour retrouver sa place face au grand concurrent de jadis, Rossini, dont les ouvrages apparaissent incontournables aujourd’hui partout dans le monde? On ne remerciera donc jamais assez Naxos et le chef Wolfgang Dörner de s’intéresser, qui plus est avec un orchestre français, à Auber. C’est en effet avec l’Orchestre régional de Cannes- Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont Dörner fut le directeur musical de 2013 à 2016) qu’a été enregistré le premier volume de cette série, anthologie de huit ouvertures choisies parmi les quelques quarante-sept ouvrages lyriques d’Auber. On pourra évidemment regretter que l’ancien assistant de Lorin Maazel n’ait pas prévu un minutage plus généreux encore, se contentant d’à peine plus d’une heure de musique. Sa sélection regroupe fort heureusement tous les «tubes» irrésistibles d’Auber, jadis enregistrés par le grand Paul Paray et son Orchestre de Detroit pour Mercury. Si les versions ciselés et rythmiquement étourdissantes de Paray restent irremplaçables ici, Dörner a pour lui le soyeux d’une direction qui avance, sans se poser de questions. On aimerait sans doute davantage de reliefs ici et là, mais cette direction a au moins pour avantage de ne jamais céder à la facilité. Un excellent second choix (8.573553). FC
Encore une version recommandable du Viol de Lucrèce

La vidéographie britténienne s’enrichit avec Le Viol de Lucrèce (1946) à Glyndebourne en 2015, fort recommandable, comme le splendide spectacle à Aldeburgh en 2001, paru chez le même éditeur (OA 1123). Opus Arte a raison de publier aussi la captation de cette production très convaincante. Une des particularités de la mise en scène puissante et imaginative de Fiona Shaw réside dans l’importance du chœur masculin et du chœur féminin. Plus que simples observateurs et commentateurs, ils incarnent, dans les années 1940, deux archéologues qui vivent sur leur chantier de fouilles la tragédie de Lucrèce en s’identifiant aux figures antiques: les voix de l’excellent Allan Clayton et de Kate Royal se complètent parfaitement, malgré le timbre peu amène de la soprano. Christine Rice se montre tout de dignité en Lucrèce, et vocalement digne d’éloges, mais moins saisissante et bouleversante que Sarah Connolly. D’excellents chanteurs à la mâle assurance endossent de manière irréprochable les rôles de Junius (Michael Sumuel), Collatinus (Matthew Rose) et Tarquinius (Duncan Rock, débordant de testostérone), tandis que Catherine Wyn-Rogers exprime avec justesse le caractère maternel de Bianca. Moins analytique que Paul Daniel, Leo Hussain dirige un Orchestre philharmonique de Londres à la fois percutant et subtil. Malgré le travail élaboré sur les lumières, la scénographie très sombre ne passe pas toujours bien à l’écran. L’image de François Roussillon parvient toutefois à restituer la beauté du dispositif et des effets visuels (DVD OA 1219D ou Blu-ray OABD 7206D). SF
Anthologies de chefs (1): Armin Jordan

Après Igor Markevitch et Jean Martinon, la collection économique «Icon» rend hommage à Georges Prêtre (voir par ailleurs ici) et à Armin Jordan (1932-2006), disparu voici tout juste dix ans. Ce sont ici seulement ses «French Symphonic Recordings», réalisés entre juin 1977 et décembre 1994, qui sont réédités, ce qui exclut donc ses importants enregistrements lyriques, qu’il s’agisse, au demeurant, d’opéras français (Le Roi Arthus, Pelléas et Mélisande, Ariane et Barbe-Bleue) ou non (Parsifal), et ne doit pas faire oublier que l’un des domaines de prédilection du chef suisse était également le postromantisme germanique. Mais ces treize disques très copieusement remplis (près de 16 heures et 20 minutes), concentrés pour la quasi-totalité sur un demi-siècle (1880-1930) de musique française de César Franck à Maurice Delage, n’en sont pas moins précieux. Héritier, dans ce répertoire, de personnalités aussi dissemblables que son compatriote Ernest Ansermet et Charles Münch, Jordan en diffère nettement, ne retenant ni la rigueur objective du premier ni l’enthousiasme débridé du second: chez lui, l’élégance et la subtilité prédominent, parfois jusqu’à une nonchalance voire une indolence excessives, la transparence reste de mise chez les compositeurs franckistes, loin de toute tentation wagnérienne ou brucknérienne, mais la violence et la noirceur qui jaillissent çà et là n’en apparaissent que plus saisissantes. On retrouvera bien sûr ici les formations helvétiques dont il a été le directeur musical – Orchestre de chambre de Lausanne (1973-1985) puis Orchestre de la Suisse romande (1985-1997) – mais aussi l’Orchestre symphonique de Bâle, l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, le (Nouvel) Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre national de France (pour un succulent disque Chabrier) et le Kammer Ensemble de Paris. Davantage encore que dans Franck, Fauré ou les quasi-intégrales Debussy et Ravel, pour lesquelles la concurrence est évidemment plus rude (même si, entre autres, les mélodies du second confiées à Rachel Yakar et Philippe Huttenlocher valent le détour) et qui donnent lieu à quelques doublons avec des versions antérieures (Ma mère l’Oye, Le Tombeau de Couperin), ce sont, outre le programme Chabrier susmentionné, Chausson (Viviane, Poème de l’amour et de la mer avec Jessye Norman, Symphonie en si bémol), Dukas (Symphonie en ut, La Péri) et les rares Delage et Jaubert (chantés par Felicity Lott) qui font le prix de cette anthologie (coffret Erato 0190295953539). SC
Anthologies de chefs (2): Evgueni Mravinski

Après une «Special Edition» chez Melodiya, Evgueni Mravinski (1903-1988) est de nouveau à l’honneur, avec le lancement, chez Profil, d’une «Edition» dont le premier volume – le deuxième est d’ores et déjà annoncé – se révèle somme toute relativement décevant par son caractère hétéroclite. Certes les versions de studio aussi célébrissimes que célébrées – trois dernières symphonies (1960) et Premier Concerto avec Richter (1959) de Tchaïkovski – demeurent toujours aussi définitives et il est intéressant de pouvoir disposer ici en outre d’enregistrements qui n’avaient pas fait leur réapparition dans de bonnes conditions depuis fort longtemps, réalisés soit en studio (où le chef russe cessa hélas toute activité dès 1961) – Sixième Symphonie de Chostakovitch (1946), Cent-unième Symphonie «L’Horloge» de Haydn (1952) –, soit en concert. Dans cette seconde catégorie, on trouve un inédit – une Trente-neuvième Symphonie de Mozart qui daterait de 1961 – mais le son est généralement assez précaire (et le public très enrhumé), ce qui nuit à des témoignages manifestement exceptionnels, comme une Douzième Symphonie «L’Année 1917» de Chostakovitch (octobre 1961) foudroyante, électrique et tenue d’une main de fer. De plus, certains enregistrements pâtissent des aléas du direct, notamment Richter à la peine dans le Second Concerto de Brahms (décembre 1961, et non 1951 comme indiqué) mais aussi l’Orchestre philharmonique de Leningrad lui-même, dont la légendaire précision est parfois prise en défaut. Enfin, un disque est entièrement dédié à la musique française – Pavane pour une infante défunte et Boléro de Ravel, Nocturnes (février 1960) et La Mer (1962) de Debussy: Mravinski mérite assurément d’être entendu même si (ou bien – peut-être – parce que) son approche paraît assez exotique dans ce répertoire (coffret de six disques PH15000). SC
Anthologies de chefs (3): Georges Prêtre

En même temps qu’à Armin Jordan (voir par ailleurs ici), la collection «Icon» rend hommage à Georges Prêtre, qui a fêté ses 92 ans en août dernier. Si, pour le Suisse, ces rééditions n’offrent de révélations ni quant à la qualité ni quant au répertoire, on n’en dira pas autant pour le Français, dont la carrière – du moins, telle que vue de son propre pays – a paru longtemps se résumer à deux noms – Poulenc, Callas – qui ont certes contribué très tôt à sa célébrité mais qui ont par trop éclipsé ses nombreuses autres affinités esthétiques. Même s’il fut choisi pour l’inauguration de l’Opéra Bastille, la consécration vint principalement de l’étranger, notamment de Vienne, où, avant d’en devenir «chef honoraire à vie», il fut premier chef invité des Symphoniker de 1986 à 1991 (alors qu’il n’occupa des fonctions équivalentes à Paris que très brièvement, à l’Opéra en 1970-1971) et où il se fit également adopter par les Philharmoniker, pour le meilleur – les éditions 2008 et 2010 du concert du Nouvel An – comme pour le pire – des prestations où le mauvais goût excédait les limites de la décence (voir ici). Ces dix-sept disques (17 heures et 20 minutes) de «Symphonic Recordings» réalisés en studio entre novembre 1960 et mai 1990 ont donc pour premier mérite d’exclure le domaine de l’opéra, où il a toujours été reconnu. Ils comportent peu de doublons (Troisième Symphonie de Saint-Saëns avec Maurice Duruflé puis Marie-Claire Alain, versions françaises et anglaises de l’Histoire de Babar le petit éléphant de Poulenc et de L’Histoire du petit tailleur de Harsányi, les deux avec Peter Ustinov) et convient, dans des prises de son et des montages pas toujours très heureux, les principales phalanges parisiennes (Société des concerts du Conservatoire puis Orchestre de Paris, Opéra, National) mais aussi, outre l’Orchestre symphonique de Vienne, le Philharmonique de Monte-Carlo ainsi que, plus épisodiquement, deux formations londoniennes, le (New) Philharmonia et le Royal Philharmonic. On découvre un chef sans complexes, au sens dramatique très sûr, plus soucieux d’énergie et de couleur que de second degré, mais sans jamais – ou presque – tomber dans la complaisance qu’on a trop souvent eu l’occasion de lui reprocher ces dernières années en concert. Sans surprise, la musique française tient une part de choix, au-delà même, bien sûr, des références établies chez Poulenc (Suite des Biches, Les Animaux modèles). Prêtre s’impose dans des registres très différents, pour peu qu’on oublie un décevant disque Debussy-Ravel-Satie ou des Landowski à l’orchestration massive (Première Symphonie «Jean de la peur», Troisième «Des espaces» et Quatrième, qu’il créa) qui ont bien mal vieilli (à supposer qu’ils aient jamais été jeunes). A l’aise dans Berlioz (Symphonie fantastique) comme dans Jongen (Symphonie concertante avec Virgil Fox), il se révèle même franchement épatant dans Roussel (Bacchus et Ariane, Fragments symphoniques du Festin de l’araignée), Milhaud (La Création du monde, Le Carnaval d’Aix avec un Michel Béroff survolté, les Suites française et provençale) et Dutilleux (Fragments symphoniques du rare ballet Le Loup), tandis que les œuvres de Castillon (Concerto pour piano avec Ciccolini, Esquisses symphoniques) et d’Indy (Diptyque méditerranéen, Poème des rivages) lui doivent leur diffusion auprès d’un large public. Le sommet de cette contribution à la musique française réside peut-être dans l’intégrale Saint-Saëns – pas les cinq Symphonies, hélas, mais seulement les trois numérotées – enregistrée à Vienne en mai 1990 (vingt-cinq ans après un Carnaval des animaux d’excellent aloi avec Ciccolini et Weissenberg), d’une légèreté, d’une finesse et d’une grâce exceptionnelles, qui font regretter qu’on ne dispose pas ici de témoignages de son art dans le premier classicisme viennois. Cela étant, la réussite n’est pas moindre avec certains compositeurs étrangers: plus que d’honnêtes Tchaïkovski (Cinquième Symphonie) et Dvorák (Neuvième Symphonie «Du nouveau monde»), plus que des Berg d’un expressionnisme rugueux mais brouillon (Concerto de chambre et Concerto «A la mémoire d’un ange» avec Christian Ferras et Pierre Barbizet), on retiendra des Russes très punchy (Dans les steppes de l’Asie centrale, Danses polovtsiennes du «Prince Igor», Une nuit sur le mont Chauve, Capriccio espagnol), des Gershwin ébouriffants (Rhapsody in Blue et Concerto en fa avec Daniel Wayenberg) et des Chostakovitch assez inattendus (Ouverture de fête, Douzième Symphonie «L’Année 1917»). Voilà qui sonne globalement comme une réhabilitation bienvenue (coffret Erato 0190295953522). SC
Voyage en Anatolie avec Erkin

Il existe à ce jour peu de disques disponibles présentant des œuvres d’Ulvi Cemal Erkin (1906-1972), plus connu en tant que membre du groupe des «Cinq Turcs». On connaît mal cette génération de compositeurs de la première moitié du XXe siècle, ayant pourtant fait ses études musicales en Europe sous la houlette des plus grands pédagogues. C’est précisément le cas du surdoué Erkin, encouragé par ses parents à intégrer le Conservatoire de Paris afin de suivre, notamment, les cours de composition de Nadia Boulanger. Entre 1925 et 1930, ces cinq années passées dans la capitale vont marquer durablement son style, enrichi par ailleurs de la collecte de motifs populaires recueillis dans toute l’Anatolie, donnant à ses œuvres un coloris oriental qui rappelle autant Rimski-Korsakov que Khatchatourian. L’une de ses œuvres les plus célèbres, la danse rhapsodique Köçekçe (1943), ouvre ce disque, hommage éclatant aux spectacles travestis en vogue dans les harems ottomans jusqu’à la fin du XIXe siècle. Avec l’emploi des percussions typiques, on a là le souvenir lointain des turqueries ayant jadis inspiré Mozart (L’Enlèvement au sérail) ou Haydn (Symphonie militaire), pour ne citer qu’eux. On retrouve dans le tout dernier mouvement de la Deuxième Symphonie, composée en 1948 mais seulement orchestrée en 1958, la référence à des danses où Erkin fait valoir un emploi étourdissant de la rythmique sur des thèmes folkloriques. Une autre très belle œuvre, dirigée par un excellent Theodore Kuchar à la tête de l’Orchestre symphonique d’Etat d’Istanbul, conclut ce disque sur le Concerto pour violon, composé en 1947, avec James Buswell en soliste. Erkin est proche du style de Prokofiev, tout en y incorporant là encore des «coloris orientaux», donnant toute sa saveur et son originalité à ce disque hautement recommandable (Naxos 8.572831). FC
Enesco et Arenski: premiers trios

L’élan généreux et la technique précise du Trio Enescu conviennent parfaitement aux deux œuvres au programme de son deuxième récital confié au disque et consacré pour moitié à son inspirateur, Georges Enesco (1861 1955) dont le Premier Trio avec piano en sol mineur invite le Premier Trio en ré mineur d’Anton Arenski (1861-1906). Composés à trois ans d’intervalle, respectivement en 1897 et 1894, les deux trios ont en commun un souffle romantique et de nets liens avec la musique des aînés, celui du compositeur avec Tchaïkovski, Rimski-Korsakov et peut-être Mendelssohn, celui du compositeur roumain avec Brahms et Schumann. Enesco n’avait que seize ans lors de la composition de son trio, aux influences non seulement bien naturelles mais transcendées, alors qu’Arenski, trentenaire, essuyait les reproches de ses anciens maîtres qui auraient préféré le voir ouvrir de nouvelles voies. Le compositeur russe créa néanmoins du nouveau avec des principes bien assis et, encore souvent à l’affiche aujourd’hui, son Trio, défendu avec flamme par le Trio Enescu, déploie quatre mouvements dynamiques, lyriques, et intenses, les éclairages allant du sombre à l’incandescent en passant par la clarté ludique d’un Scherzo animé. L’étonnante maîtrise, l’équilibre et l’aplomb du Trio plein de vie du jeune Enesco ne portent pas encore la marque si personnelle du compositeur à venir mais la partition récemment retrouvée ne manque ni d’ardeur ni d’adresse. Une gamme ascendante récurrente du plus bel effet traverse le premier mouvement d’instrument en instrument avant la douce élégance de l’Allegretto et la nostalgie hymnique de l’Andante. Les contrastes d’un Presto bien nommé, aux accents péremptoires ou gracieusement fluides, concluent l’œuvre avec panache. Fondé en Allemagne en 2011, le jeune Trio Enescu surmonte avec brio les difficultés techniques des deux pièces, la fougue de sa prestation chaleureuse étant tout à fait engageante (Genuin GEN 16447). CL
Une Dinorah venue de Berlin
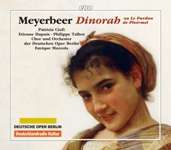
Si les plus grands ouvrages de Giacomo Meyerbeer (1791-1864) retrouvent peu à peu les faveurs de la scène, il faut s’armer de patience pour trouver des défenseurs de ses deux derniers opéras, pourtant tout aussi intéressants. Ces deux dernières années, on doit ainsi à Enrique Mazzola et aux forces du Deutsche Oper de Berlin ce rare intérêt pour Vasco de Gama (ou L’Africaine, 1865) et Dinorah ou Le Pardon de Ploërmel (1859) – tout dernier opéra créé du vivant du compositeur. Mais si CPO a publié en 2013 un Vasco de Gama qui nous venait non pas de la capitale allemande mais de Chemnitz, avec une distribution différente dirigée par Frank Beermann, la présente parution nous permet de retrouver la production berlinoise de Dinorah. On reconnaîtra tout de suite ici la patte de Mazzola, aussi allégée que savante, ductile et aérienne, à qui ne manque parfois qu’un semblant d’emphase et d’espièglerie, là où Meyerbeer compense les faiblesses dramatiques de son livret par des effets orchestraux dont il a le secret: c’est peu dire que son orchestre est un personnage à part entière dans cet ouvrage dont l’Ouverture avec chœurs n’est pas la moindre des réussites. Le présent enregistrement propose la version originale en français avec dialogues parlés, tandis que la version italienne préfère les récitatifs. Dommage que Patrizia Ciofi (Dinorah) soit ici dans un si mauvais jour, desservie par un timbre voilé, des vocalises bien à la peine et surtout un français étonnamment incompréhensible. Elle forme par ailleurs un couple mal assorti avec Philippe Talbot, dont l’éloquence, la souplesse de l’articulation autant que la diction sont un régal de chaque instant. On notera aussi le vaillant et exemplaire Corentin d’Etienne Dupuis, tandis que le Chœur du Deutsche Oper assure bien sa partie. Une version inégale, par conséquent, qui vient s’ajouter à la version précédente de James Judd, parue chez Opera Rara en 1979 (coffret de deux disques 555014-2). FC
Le Royaume-Uni, l’autre pays de la symphonie

Après deux anthologies concertantes consacrées respectivement aux cordes et au piano, Lyrita public un troisième coffret de quatre disques (SRCD.2355) de nouveau intégralement consacré à la musique britannique et, cette fois-ci, au genre symphonique, avec, sous le titre «British Symphonies», la réédition d’œuvres de treize compositeurs: plus d’un siècle de musique (de 1867 à 1973) au-delà des grands classiques que sont (ou qui devraient l’être) Elgar, Vaughan Williams, Walton et Tippett pour démontrer que, parmi les grandes nations, et au regard du leadership incontesté du monde germanique, le Royaume-Uni, dans une grande diversité stylistique et une heureuse intégration d’influences extérieures (notamment scandinaves), s’est imposé, pour détourner un célèbre slogan publicitaire, comme «l’autre pays» de la symphonie. A l’appui de cette démonstration, les meilleurs chefs (Boult, Del Mar, Handley, Pritchard...) et orchestres (Philharmonia, Philharmonique de Londres, Symphonique de la BBC, Symphonique de Londres...) britanniques, au travers d’enregistrements réalisés depuis la fin des années 1960 jusqu’au début de notre siècle, florilège de disques précédemment parus séparément voici environ une décennie chez le même éditeur, auxquels le lecteur soucieux d’approfondir la connaissance de ces compositeurs sera successivement invité à se reporter.
Le tout jeune William Sterndale Bennett (1816-1875) fut invité en Allemagne par Mendelssohn: plus de trente ans après, on en entend encore nettement l’écho dans la Symphonie en sol mineur (1867), qui prend parfois aussi des teintes schumaniennes dans ses quatre mouvements enchaînés par de brefs intermezzos. Elle est tirée d’un disque où elle était couplée avec quatre ouvertures, celle de la pastorale La Reine de mai (1858) et trois autres tenant plus du poème symphonique que de l’ouverture, publiées à Leipzig: Parisina (1835), Les Naïades (1836), déjà bien mendelssohnienne, et La Nymphe des bois (1838) (SRCD.206).
La Première Symphonie (1932) de Cyril Rootham (1875-1938), qui brille par son orchestration colorée et sa générosité mélodique, tout en évoquant Vaughan Williams par ses tournures modales et folkloriques, peut être entendue par ailleurs sur un album regroupant l’Ouverture pour une tragédie grecque (Œdipe à Colonne) (1911) de Granville Bantock (1868-1946), trop souvent académique, et Les Oiseaux de Rhiannon (1920), l’un des «poèmes orchestraux» de Joseph Holbrooke (1878-1958), plus original mais très inégal (SRCD.269). Un volume de publication plus récente permet de mieux se familiariser avec l’œuvre de Rootham. De beaucoup plus vastes dimensions (près de quarante minutes) et se concluant avec l’intervention d’un chœur, la Seconde Symphonie «La Révélation de saint Jean» (1938), dont l’orchestration fut achevée par Patrick Hadley, est moins attendue, plus sombre et méditative. Elle est couplée avec l’Ode au matin de la Nativité du Christ (1928) pour solistes, chœur, chœur d’enfants et orchestre, toute de délicatesse et de raffinement harmonique, une de ces belles pages chorales dont les Britanniques ont le secret (REAM.2118).
La Sinfonietta (1944) d’Ernest Moeran (1894-1950), au néoclassicisme ensoleillé dont les robustes éléments folkloriques peuvent se teinter de rêverie sibélienne, est issue d’un album qui propose par ailleurs un must absolu du répertoire britannique, la Symphonie en sol mineur (1937), ainsi que l’Ouverture pour un masque (1944) (SRCD.247).
On reste à un niveau comparable avec la Première Symphonie (1922) d’Arnold Bax (1883-1953). A ceux qui en seraient restés au cliché d’une musique anglaise tenant de la fade aquarelle, on ne saurait trop recommander cette œuvre à la vigueur digne d’un Roussel, d’une grande profusion de climats, luxu(ri)eusement orchestrée, annonciatrice de la Quatrième de Vaughan Williams comme de la Première de Walton – il est à peine imaginable que deux de ses trois mouvements résultent de l’orchestration d’une sonate pour piano. Dans son couplage d’origine, elle était associée à l’ultime, profuse et imposante Septième, avec son vaste final à variations (SRCD.232).
Autre symphoniste par excellence, Edmund Rubbra (1901-1986) a laissé onze Symphonies. La Quatrième en impose par son caractère spéculatif, évoquant, comme chez beaucoup de contemporains britanniques, Sibelius mais aussi, de façon moins attendue l’intensité d’un Messiaen, autre fervent catholique, jusqu’à un impressionnant choral conclusif, et la profusion (certes plus disciplinée) d’un Villa-Lobos. Dans sa parution d’origine, elle était couplée avec la belle et très sibélio-elgarienne Troisième (1939), qui se conclut par un thème varié suivi d’une fugue (Rubbra venait d’orchestrer les Variations et Fugue sur un thème de Haendel de Brahms), mais aussi Un hommage (1942) pour les soixante-dix ans de Vaughan Williams, élégie pastorale un peu compassée, et la plus substantielle ouverture Resurgam (1975) (SRCD.202).
Alan Rawsthorne (1905-1971) a écrit trois Symphonies, mais il est représenté ici par une œuvre antérieure, les Etudes symphoniques (1938), sous forme de thème suivi de cinq variations et d’une fugue, conjuguant un néoclassicisme à la Hindemith avec un brio orchestral qui n’est pas sans rappeler le «Mercure» de Holst. Ces pages élégantes et fluides étaient précédemment parues avec les deux Concertos pour piano – le Premier (1939/1942) avec une verve rythmique et musclée à la manière de Prokofiev, le Second (1951) avec ses atmosphères à la fois plus raffinées et contrastées – et la très enjouée ouverture Street Corner (1944) (SRCD.255).
D’une belle inspiration, la Troisième (1969) des quatre Symphonies de Lennox Berkeley (1903-1989), en un quart d’heure d’un seul tenant, intrigue voire fascine, avec sa puissance postromantique abstraite et concentrée, où l’on peut entendre de lointains échos de Hindemith, Sibelius ou Stravinski. Dans sa parution originale, elle était accompagnée de nombreuses œuvres brèves, d’esprit plus léger et néoclassique, plaisant, souriant et frais, un peu à la manière de Jean Françaix, même si les mouvements lents portent leur part d’ombre voire de drame: Mont Juic (1937), suite de quatre danses catalanes coécrite avec Britten, Sérénade pour cordes (1939), Divertimento en si bémol (1943), Partita pour orchestre de chambre (1965) et la «Canzonetta» extraite d’une Symphonie concertante pour hautbois (1973) (SRCD.226).
Autre symphonie d’un quart d’heure et d’un seul tenant (mais clairement structurée en quatre parties), la Cinquième «Hydriotaphia» (1973) de William Alwyn (1905-1985) est dédiée à «la mémoire immortelle de Sir Thomas Browne (1605-1682): citoyen de Norwich, physicien, philosophe and maître incomparable de la prose anglaise», auteur de l’élégie éponyme Hydriotaphia, Urn-Burial: or, a Discourse of the Sepulchral Urns lately found in Norfolk. Dernière des cinq Symphonies du compositeur, elle tient, sans être descriptive, du poème symphonique, avec son postromantisme spectaculaire, presque cinématographique. Elle était originellement parue avec les Deuxième (1953) et Troisième (1956), qui cultivent elles aussi une veine généreuse et grand spectacle, entre Strauss et Khatchatourian, ce qui ne saurait surprendre de la part de son auteur, qui affirmait que «la musique est l’expression des émotions» (SRCD.228).
D’assez amples proportions (38 minutes), la Seconde Symphonie (1956/1975) de Grace Williams (1906-1977) détonne quelque peu dans ces paysages britanniques, avec son mélange d’ironie et de tragédie à la façon de Chostakovitch, sa violente énergie, impulsée par les trompettes, la caisse claire et le fouet: sombre et puissante, l’œuvre pourrait s’apparenter à la Symphonie «1940» de Bainton ou même à la Cinquième de Prokofiev. Elle avait d’abord était publiée avec l’enregistrement de deux œuvres plus tardives, les quatre Ballades (1968), tout aussi hautes en couleur, et Fairest of Stars (1973) pour soprano et orchestre, sur un poème de Milton, beaucoup plus apaisé, radieux et serein même, sans doute aussi plus fidèle à la tradition anglaise (SRCD.327).
Malcolm Arnold (1921-2006) fait presque figure ici de célébrité: l’intégrale de ses neuf Symphonies a été récemment rééditée par Chandos de telle sorte qu’il est intéressant de découvrir ici la Première (1955) de ses trois Sinfoniettas, brève partition requérant un orchestre haydnien mais de langage plutôt romantique, où l’on reconnaît bien la patte du compositeur dans l’entraînant Allegro con brio final. Dans sa première parution au disque, elle était en bonne compagnie avec la Sinfonietta (1932) du tout jeune Britten et celle (1950), toute de bonheur, de Berkeley, le néoclassicisme stravinskien du Divertimento «Sellinger’s Round» (1953) de Tippett et le délicat Divertimento (1962) de Rawsthorne (SRCD.257).
William Wordsworth (1908-1988), homonyme du poète, dont il était l’arrière-arrière-petit-neveu, a laissée huit Symphonies. Solidement tonale, la Troisième (1951) évoque parfois la rigueur de Bartók mais aussi les ambiguïtés de Chostakovitch, notamment dans l’introspectif Andante espressivo central. Elle est extraite d’un album comprenant par ailleurs la Deuxième (1948) (SRCD.207) mais on peut aussi trouver chez le même éditeur la sévère Première (1944) et la plus expansive Cinquième (1960), «symphonie sans tête» comme la Sixième de Chostakovitch, ainsi que la plus convenue ouverture Conflit (1968), tout dernièrement parues dans les captations de diffusions à la BBC réalisées par Richard Itter, le fondateur de Lyrita (REAM.1121).
Sous la direction de Josef Krips, la Deuxième (1958) des cinq Symphonies de Humphrey Searle (1915-1982), l’un des premiers Britanniques à recourir aux techniques d’écriture dodécaphoniques, fait preuve d’un fort sens dramatique et expressif en même temps que d’un raffinement orchestral très poussé (Lento central). Elle était couplée avec les deux dernières symphonies de Robert Still (1910-1971): la Troisième (1960), qui lui valut, à l’âge de 50 ans, un doctorat en musique à Oxford mais dont la vigueur roussélienne ou waltonienne (mais sans en posséder la luxuriance orchestrale) teintée d’inflexions mahlériennes – notamment dans le beau Largo central – ne saurait pour autant être qualifiée d’académique, et la Quatrième (Sinfonia) (1969), moins maladroite, en seul mouvement, d’une inlassable énergie (SRCD.285). L’édition récente des trésors de la collection Itter (voir ci-dessus) permet de découvrir deux autres symphonies de Searle, encore plus ramassées (moins de 20 minutes), la Troisième «Vénitienne» (1960), dont la rigueur sérielle est équilibrée par une constante intensité et une grande virtuosité orchestrale, et la Cinquième (1964), plus radicale, dédiée à la mémoire de Webern (dont il fut l’élève), ainsi que les douze brèves Zodiac Variations (1970) pour orchestre de chambre et Labyrinthe (1971), page très spectaculaire, librement inspirée de la légende de Dédale et Minos (REAM.1130).
D’origine sud-africaine mais établi en Angleterre depuis 1946, John Joubert (né en 1927) a composé deux Symphonies. La Première (1955), finement écrite, aérée et agile, à l’exception d’un Lento, ma non troppo assez massif, où le drame prédomine, s’achève dans une jubilation franchement néoclassique. Elle était originellement couplée avec la Première (1966) des trois Symphonies (achevées) de William Mathias (1934-1992), au néoclassicisme scintillant et poétique, dans le meilleur de la tradition britannique où l’on pourra percevoir des échos de Holst, de Britten et du premier Tippett (SRCD.340).
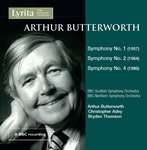 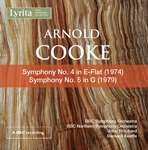
 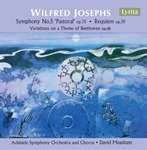
Toujours grâce au legs Itter, comme pour Wordsworth et Searle (cf. ci-dessus), Lyrita incite à la découverte de trois autres symphonistes anglais. Ainsi de la parution de trois des sept Symphonies d’Arthur Butterworth (1923-2014), les Première (1957), au néoclassicisme vindicatif, dans l’esprit d’Honegger ou des plus sombres symphonies de Vaughan Williams, Deuxième (1964), nouveau cauchemar où les catastrophes se succèdent de manière encore plus apocalyptique (mais à l’Adagio plus épique et inquiet), et Quatrième (1986), où la tempête ne s’est guère apaisée, même si elle se situe davantage dans le moule de la tradition symphonique d’un Nielsen, avec une séduction sonore nettement plus affirmée (album de deux disques REAM.1127).
Auteur de six Symphonies, Arnold Cooke (1906-2005) fut l’élève, à Berlin au tournant des années 1920 et 1930, de Hindemith: cinquante ans plus tard, cela s’entend encore de façon presque caricaturale dans la Quatrième (1974), assez proche de la Symphonie en mi bémol du compositeur allemand. La Cinquième (1979), toujours d’une belle vigueur, paraît à peine moins tributaire du style de son maître (REAM.1123).
Peter Racine Fricker (1920-1990), lointain descendant de notre tragédien, vécut les trente dernières années de sa vie aux Etats-Unis. La Cinquième (1976), dernière de ses Symphonies et commande de la BBC pour les vingt ans du Royal Festival Hall de Londres, associe l’orgue à l’orchestre pour un résultat assez terne, bruyant et décousu. Antérieur de près de vingt ans, l’oratorio La Vision du Jugement (1958) marque davantage bien qu’indéniablement plus conventionnel, s’inscrivant dans la lignée grandiose et spectaculaire des grandes fresques chorales britanniques, dans un style qui rappellera Le Festin de Balthazar de Walton (REAM.1124).
Wilfred Josephs (1927-1997) écrivit pour le cinéma et la télévision (il collabora notamment à la série Le Prisonnier) tout en laissant une œuvre abondante, dont pas moins de douze Symphonies. Lyrita réédite deux microsillons publiés originellement chez Unicorn et réalisés en 1982 et 1983 par l’Orchestre symphonique d’Adélaïde dirigé par David Measham. La Cinquième Symphonie «Pastorale» (1971), sans aucun rapport avec celles de Beethoven ou même de Vaughan Williams, ouvre sur un univers à la fois original et disparate, où se succèdent avec une grande versatilité et une fausse candeur, un peu comme chez Malcolm Arnold, l’amer et le sucré, au travers d’épisodes évoquant, parfois quasiment jusqu’à la citation, des influences très variées (Mahler, Sibelius, Nielsen, la Seconde Ecole de Vienne, Chostakovitch). Les Variations sur un thème de Beethoven (1969), composées en vue du bicentenaire de la naissance du compositeur, se fondent sur le Menuet de la Vingtième Sonate pour piano et sur celui, partiellement identique, du Septuor: de caractère et d’inspiration composites, à la manière des Variations sur un thème de Frank Bridge de Britten, les neuf variations sont toutes fort éloignées du style de l’original, entre la dérision ludique d’un Intermezzo grotesque et le postromantisme germanique d’une poignante Passacaille. Partition sans doute la plus célèbre de Josephs, dirigée en son temps par Giulini, le Requiem (1963), pour baryton, chœur et orchestre, met en musique des textes hébraïques, notamment le kaddish, et est introduit par un sombre quintette à deux violoncelles intitulé Requiescant pro defunctis iudaeis (1961) et entrecoupé par trois interventions purement instrumentales (deux de cette même formation de cordes et une de l’orchestre), dont les titres en latin («Lacrimosa», «De profundis», «Monumentum») renvoient clairement à une tout autre liturgie. Malgré ce syncrétisme, nul doute que pour ce descendant de juifs polonais, le souvenir des atrocités nazies, au moment même du procès Eichmann, fut à la source de cette heure de musique, intense, lyrique, recueillie, au langage d’une belle sobriété, qui saisit l’auditeur sans abuser du pathos (album de deux disques SRCD.2352).
 
Quittons Lyrita, d’abord pour l’infatigable découvreur qu’est Toccata Classics, qui, après un album de piano, se lance dans trois volumes consacrés à la musique orchestrale de Charles O’Brien (1882-1968). Ecossais d’ascendance irlandaise par son père et française par sa mère, «il met rarement l’auditeur au défi, il divertit toujours» – la notice (en anglais) ne s’en cache pas. De fait, l’ouverture de concert Ellangowan (1909) d’après le roman Guy Mannering ou l’Astrologue de Walter Scott, pourrait avoir été écrite près d’un siècle plus tôt par un Mendelssohn sur le chemin des Hébrides. La dimension folklorique disparaît dans la Symphonie en fa mineur (1922), charmante et délicate, tenant assez bien ses trois quarts d’heure de durée, mais toujours anachronique et guère originale. Paul Mann, qui a établi de nouvelles éditions critiques des partitions, les dirige avec beaucoup de soin et de tendresse, à la tête d’une belle formation lettone, l’Orchestre symphonique de Liepāja (TOCC 0262).
Enfin, Naxos s’intéresse à Francis Chagrin (1905-1972) qui, comme Fricker et Josephs, a beaucoup écrit pour le cinéma. D’origine roumaine (né Alexander Paucker), c’est à Paris, où il étudie avec Dukas et N. Boulanger à la fin des années 1920, qu’il adopte son nom. Martyn Brabbins et l’Orchestre symphonique de la BBC donnent le premier enregistrement de ses deux Symphonies, qui n’ont pas forcément bien vieilli – la Première (1959/1965), acérée, sèche mais un peu superficielle, moins bien que la Seconde (1971), âpre et paroxystique, qui prend davantage l’auditeur à rebrousse-poil tout en dégageant quelque chose de l’auguste froideur du marbre (8.571371). SC
Réjouissant florilège baroque concertant

Même si le titre de ce disque, «Concerti Bizarri», n’est pas vraiment explicité par l’avant-propos de Monica Huggett, le plaisir constant que celui-ci nous apporte ne s’en trouve en rien émoussé! Car, au travers de cinq compositeurs plus ou moins connus de la période baroque (Vivaldi, Telemann mais aussi Heinichen, Fasch et Graupner), Monica Huggett et son Orchestre baroque irlandais nous permettent d’entendre plusieurs concertos qui ont presque tous pour point commun de faire intervenir plusieurs solistes: hautbois, flûte, violoncelle... La diversité des œuvres est incroyable. On connaît bien entendu le Concerto pour deux violoncelles RV 531 de Vivaldi, une de ses œuvres-maîtresses, mais comment ne pas vibrer au style assez reconnaissable de Fasch, tant dans son très beau Concerto pour flûte, hautbois et orchestre que dans l’original Concerto pour deux hautbois de chasse, deux violes et deux bassons (quel Allegro!)? Comment ne pas se laisser emporter par le concerto de Telemann, formidable par ses rythmes et ses sonorités (le premier mouvement, presque nonchalant, la finesse de la mélodie dans le troisième) ou par le concerto de Heinichen, dont le deuxième mouvement, justement intitulé (Largo) Pizzicato, offre un véritable écrin pour le hautbois solo? Tous les musiciens sont excellents (basson virtuose dans le premier concerto de Graupner) et, sous la houlette de Monica Huggett, prennent un vrai plaisir à interpréter ces concertos dont la fraîcheur n’éclipse en rien la profondeur de certaines mélodies. Un disque excellent, à mettre entre toutes les oreilles (Linn CKD 526)! SGa
Double hommage à Weinberger et à Gerd Albrecht

C’est très probablement le décès du regretté Gerd Albrecht, voilà deux ans, qui a incité Capriccio à ressortir de ses cartons des enregistrements inédits réalisés par le chef allemand en 2000 et 2002 avec l’Orchestre symphonique allemand de Berlin, tous consacrés à la figure méconnue de Jaromír Weinberger (1896-1967). On connaît surtout le compositeur tchèque naturalisé américain pour son chef-d’œuvre lyrique Svanda dudák (Schwanda, le joueur de cornemuse, 1927), encore donné épisodiquement sur scène, comme c’était le cas à Dresde voilà bientôt trois ans (les anglophones liront aussi avec intérêt l’article dédié à son opéra Wallenstein, suite aux représentations viennoises de 2012). Le disque d’Albrecht réunit trois œuvres – Ouverture pour une comédie chevaleresque, Six chants et danses de Bohème et Passacaglia – composées dans la foulée de l’immense succès rencontré par Schwanda avant l’exil définitif aux Etats-Unis en 1939 (afin d’échapper aux nazis), où l’on retrouve une orchestration colorée et lumineuse dans l’esprit de Smetana et Dvorák, s’appuyant sur des thèmes folkloriques savoureux. Toujours élégant, l’orchestre de l’ancien élève de Reger tisse des délices de raffinement en conservant un langage tonal éloigné de l’avant-garde, tout en se montrant plus aventureux dans la Passacaglia (avec orgue) composée en 1931. Cette œuvre superbe s’inspire nettement en son début de la Sinfonietta de Janácek, avant de s’apaiser et montrer davantage d’intériorité et d’écriture savante – autant dans la passacaille que dans la fugue finale. Un très beau disque qui donne envie de découvrir davantage ce compositeur trop négligé (C5272). FC
Granados s’invite à l’orchestre

Trop tôt disparu à seulement 48 ans, Enrique Granados (1867-1916) reste principalement connu pour ses admirables pièces pour piano, dont sa compatriote Alicia de Larrocha fit tant, à partir des années 1960, pour la renommée. Chef de l’ Orchestre symphonique de Barcelone depuis six ans, Pablo González a choisir de célébrer le centenaire de la mort du compositeur à l’occasion d’une inédite intégrale de ses œuvres symphoniques – dont il s’agit ici du deuxième volume, le tout premier étant sorti en début d’année chez Naxos. On retrouve l’influence des héritiers de Franck (que Granados a côtoyé lors de ses études parisiennes entre 1887 et 1889) à l’écoute de la superbe Nuit du mort composée en 1897 pour ténor, chœur et orchestre et dont les séductions mélancoliques rappellent parfois les œuvres contemporaines de Sibelius. Les amateurs de coloris ibériques préfèreront sans doute les Danse gitane et Danse des yeux verts composées en 1915 et 1916, où le compositeur s’inspire du folklore andalou et gitan, sans jamais tomber dans la facilité. Il est à noter que ces trois œuvres sont toutes enregistrées en première mondiale. Outre le célèbre Intermezzo de l’opéra Goyescas (1915), on s’intéressera à l’ambitieux et wagnérien poème symphonique Dante (1908), où González distille les couleurs de son orchestre en un tempo mesuré, toujours respectueux de l’œuvre. On pourrait imaginer une battue plus nerveuse ici et là, mais l’ensemble se tient et González reste fidèle au texte. De la belle ouvrage qui donne envie d’écouter la suite. Quelques éditeurs auront-ils également l’audace de s’intéresser à l’un de ses opéras? (8.573264) FC
Josef Vlach prend la baguette

On se souvient de Josef Vlach (1923-1988) en tant que premier violon du célèbre Quatuor Vlach – à ne pas confondre, bien sûr, avec le quatuor du même nom, refondé par sa fille Jana Vlachová en 1982 et toujours actif (voir par exemple un concert donné en 2011) – de 1949 à 1975, période pendant laquelle les célèbres solistes se sont adjoint les services de l’Orchestre de chambre tchèque afin d’enregistrer un répertoire plus fourni, proche de celui de Neville Marriner et l’Académie de St Martin in the Fields. On préférera le geste plus léger et bondissant de l’Anglais, là où le Tchèque choisit une stricte fidélité au texte, en des tempi vifs et sans vibrato. Ce sont autant les qualités techniques exceptionnelles de l’ensemble, que le sérieux imperturbable affiché qui ont séduit les puristes pendant les années d’activité de l’ensemble. Intitulé «Legendary Recordings», ce beau coffret de quatre disques bénéficie aussi des excellentes conditions d’enregistrement réalisées par Supraphon à l’époque, même si l’on pourra noter un certain manque de chaleur dans le rendu. La battue un rien sévère de Vlach convient davantage aux œuvres du XXe siècle, telles les superbes versions des Variations sur un thème de Frank Bridge de Britten ou des Oiseaux de Respighi. Ses Mozart en noir et blanc ont trouvé meilleurs interprètes ailleurs (Sándor Végh notamment), tandis que la musique tchèque (présente sur un seul disque) s’épanouit plus harmonieusement, à l’instar des séries de quatuors célébrés par ailleurs. Une somme historique rare et toujours intéressante, même si elle est a été en grande partie dépassée depuis (SU 4203-2). FC
Portrait musical de l’Europe du début du XVIIe siècle

La compilation réalisée dans le cadre de ce disque par l’éditeur Ricercar, enrichie d’une notice explicative richement illustrée et comme d’habitude fourmillant de renseignements (bravo aux plumes de Jérôme Giersé et Jérôme Lejeune!), témoigne une fois de plus du sérieux de cet éditeur et de l’originalité de certaines de ses publications. Avertissement immédiat à l’auditeur: il faut prendre le titre «Rubens and the music of his time» au sens littéral! Evidemment, Pierre Paul Rubens (1577-1640) n’a jamais composé de musique et il n’est pas question ici d’exhumer une éventuelle partition de la main du célèbre peintre. Par ailleurs, les liens entre Rubens et la musique semblent assez ténus, ses toiles ne traitant jamais de la musique à la petite exception des instruments (un luth et un violoncelle) que l’on voit au premier plan du tableau L’Education de Marie de Médicis, exposé aujourd’hui au Louvre. Mais Rubens, outre qu’il a été un peintre de génie, a également exercé une intense activité diplomatique entre 1625 et 1630, lui faisant ainsi parcourir l’Europe entière dans de nouvelles fonctions: et c’est à un semblable voyage musical, des Flandres à l’Italie en passant par la France et l’Espagne que nous invite ce disque. Les divers extraits de ce disque, issus de plusieurs catalogues édités chez Ricercar, Alpha et Arcana, offrent ainsi une diversité musicale impressionnante. Quoi de commun en effet entre la très belle Suzanne un jour de Roland de Lassus (très beau chant qui renvoie encore à la polyphonie de la Renaissance) et le Libera me conclusif de Hayne, choisi pour illustrer la mort de Marie de Médicis? La polyphonie extrêmement prenante du Salve Antwerpia de Tielman Susato doit néanmoins céder le pas au maître Monteverdi, dont l’extrait met en exergue une déclamation puissante, le chant gagnant en ampleur au fur et à mesure de l’avancement du discours. La multiplicité des influences se retrouve dans les accents arabisants de la pièce de Matheo Romero (très belles voix voluptueuses) autant que dans le caractère cette fois-ci assez raide de la marche aux solennelles percussions composée par Praetorius. Même si l’on est ici à mille lieues de la profusion de couleurs dont Rubens était capable dans ses toiles, voici un voyage musical que l’on fait avec plaisir, guidé par le seul esprit de découverte (RIC 352). SGa
Wolf-Ferrari (1): un essai vériste

On ne peut imaginer plus grand contraste entre Il campiello, l’un des tout derniers opéras d’Ermanno Wolf-Ferrari, composé en 1936 dans un esprit de raffinement bouffe en hommage à Mozart, et l’un de ses grands succès de jeunesse, I gioielli della Madonna (1911), d’inspiration vériste. C’est ce que nous permettent de constater deux bons albums récemment édités par Lyrita et Naxos, où s’opposent ces différents styles. On retrouve ici la captation de la production des Joyaux de la Madone donnée à l’Opéra de Bratislava l’an passé, dans sa version italienne. Naxos nous annonce un «premier enregistrement mondial», là où existe une précédente version dirigée par Alberto Erede (BellaVoce, 1976). On ne se plaindra pas cependant de disposer d’une autre version de cette œuvre superbe, dont l’Ouverture dramatique surprend d’emblée par son vacarme impressionnant, proche des explosions orchestrales contemporaines d’un Schreker. Wolf-Ferrari embrasse ensuite davantage le vérisme, sans jamais tomber dans le confort d’un miel trop facile, nous régalant de son imagination mélodique. Spécialiste de Wolf-Ferrari, Friedrich Haider (ancien directeur musical de l’Opéra de Strasbourg) est parfaitement à son aise ici, dirigeant les quarante chanteurs différents réunis dans cette production, tous membres de la troupe de l’Opéra de Bratislava. On ne trouvera certes pas de joyau vocal ici, mais tous les chanteurs offrent un niveau d’une bien belle tenue, permettant de se régaler de cette œuvre injustement méconnue. On trouvera également sur notre site un compte rendu en anglais de cette parution (album de deux disques 8.660386-87). FC
Wolf-Ferrari (2): dernier hommage à Goldoni

C’est toujours avec un grand plaisir que l’on retrouve les ouvrages lyriques d’Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948), éloigné de l’avant-garde musicale pendant toute sa carrière afin d’embrasser une veine légère et savoureuse, bien en phase avec son tempérament. Autour d’une orchestration colorée et subtile, doublée d’une invention mélodique toujours marquante, le compositeur germano-italien s’est principalement épanoui dans le genre comique, portant une admiration sans borne pour son cher Goldoni. On retrouve ici Il campiello (La Petite Place), le tout dernier ouvrage fondé sur un livret de son illustre compatriote, composé en 1936, trente-trois ans après le tout premier d’entre eux, Le donne curieuse (voir la bonne version parue chez CPO l’an passé, en langue allemande). Le double disque proposé par Bongiovanni est manifestement une captation en direct de l’une des soirées consacrées à Il campiello en 2014 à Rovigo et Venise – l’éditeur ayant fait l’impasse sur les dates et lieux d’enregistrement. La Vénétie rend ainsi opportunément hommage à ce natif de la Sérénissime, qui a par ailleurs créé plusieurs de ses opéras dans la lagune. Sur le plan artistique, ce double disque tient la route avec un orchestre à la hauteur, dirigé avec beaucoup de grâce par Stefano Romani, tandis que l’ensemble des chanteurs réunis affichent un niveau d’une belle homogénéité. Seules les faussetés exaspérantes de Max René Cosotti, et dans une moindre mesure le vibrato dans l’aigu de Patrizia Cigna, pourront décevoir (GB 2478/79-2). FC
Wolf-Ferrari (3): une déclaration en forme de concerto

On connaissait l’histoire de Stefi Geyer, inspiratrice du Premier Concerto de Bartók puis du Concerto de Schoeck, séduits autant par la jeune femme que par la violoniste. C’est à la découverte d’une idylle similaire qu’invite un coffret contenant non seulement un disque mais aussi le DVD d’un bref documentaire de 13 minutes intitulé Déclaration d’amour à une violoniste (sous-titré en anglais, italien et japonais). Guila Bustabo (1916-2002), née aux Etats-Unis quelques semaines avant Menuhin (avec lequel elle étudia à la Juilliard School), fut une enfant prodige fortement promue par son père italien et sa mère tchèque (qui mentaient sur sa date de naissance afin de s’assurer encore davantage de l’étonnement du public), suscitant très tôt l’admiration des plus grands, de Kreisler à Sibelius en passant par Furtwängler et Chaliapine. En 1939, elle écrivit à Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948), lui-même de père allemand et de mère italienne, pour lui exprimer l’admiration suscitée par un air de son opéra La dama boba, qui venait d’être créé à la Scala. Le compositeur refusa de se plier à sa demande d’en réaliser une adaptation pour violon, mais au fil de leurs échanges épistolaires, puis de leur rencontre en 1941 à Munich, naquit un Concerto pour violon (1943), qu’elle créa avec le Philharmonique de Munich sous la direction d’Oswald Kabasta en janvier 1944, avant de le donner le mois suivant à Paris avec Willem Mengelberg. En 1946, elle fut sérieusement inquiétée pour ses apparitions en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale (bien qu’elle résidât à Paris à partir de 1942), ce qui mit quasiment fin à sa carrière et la plongea dans l’anonymat. Elle vécut ensuite en Autriche et aux Etats-Unis, ne se produisant plus qu’épisodiquement mais enregistrant néanmoins le Concerto de Wolf-Ferrari avec Rudolf Kempe en novembre 1971 à Munich. Après 1944, la correspondance entre Wolf-Ferrari et Bustabo était devenue beaucoup moins régulière, et il mourut quatre ans plus tard sans avoir pu la revoir: dans le premier mouvement, la citation d’un air de Danilo dans La Veuve joyeuse («Il y avait autrefois un prince et une princesse qui s’aimaient l’un l’autre, je pense! Ils ne pouvaient appartenir l’un à l’autre, comme le raconte un de nos poètes. Mais jamais le prince ne rompit le silence») semble toutefois ne pas laisser de doute sur les sentiments qui les unissaient. Au-delà de ce story telling mis en valeur par une notice (en allemand et en anglais) à la riche iconographie, la musique illustre bien la dualité de Wolf-Ferrari, plus germanique dans le premier mouvement mais d’une italianità quasi rossinienne dans le Rondo final. Prenant son temps – quatre mouvements («Fantasia», «Romanza», «Improvviso», «Rondo») de près de 40 minutes –, l’œuvre chante sans cesse, d’une grâce, d’une sérénité et d’une joie que ne vient perturber aucune des angoisses de l’époque, d’un idéalisme incandescent tel celui que partageaient l’auteur et sa muse. Dans ce ré majeur qui constitue déjà en lui-même tout un hommage au répertoire concertant pour violon, aucune innovation stylistique, on s’en doute: non seulement Wolf-Ferrari réutilise des thèmes conçus un demi-siècle plus tôt, mais son style hors du temps, peut-être plus encore que celui d’un Korngold, n’est pas loin d’évoquer la lumineuse décantation du dernier Strauss. C’est ce que donne à entendre avec un vrai bonheur le violoniste autrichien Benjamin Schmid, accompagné par son compatriote Friedrich Haider, défenseur de longue date du compositeur, à la tête de la Philharmonie d’Oviedo dont il fut le director titular de 2004 à 2011. Cette belle publication de l’éditeur – munichois, bien sûr – Farao Classics n’appelle qu’une réserve: les compléments – des extraits symphoniques (trois ouvertures et un intermezzo) de quatre opéras – renvoient de nouveau Wolf-Ferrari au domaine lyrique, sur lequel sa notoriété se fonde exclusivement encore aujourd’hui. Quelques pages orchestrales (mais aussi chambristes) figurent pourtant à son catalogue, datant pour la plupart de la fin de sa vie: cela aurait donc pu être l’occasion de faire découvrir l’un de ses trois concertinos pour instruments à vent (hautbois, basson, cor anglais) – autant d’associations instrumentales qui font d’ailleurs aussi penser au dernier Strauss – sans compter une Sinfonia brevis et un Concerto pour violoncelle (B 108069). SC
Rumon Gamba revisite le Royaume-Uni

Après son intégrale des enregistrements symphoniques de Vincent d’Indy, dont le tout dernier volume est paru l’an passé, retour à la musique britannique pour Rumon Gamba et l’Orchestre national gallois de la BBC, avec une série d’«ouvertures des îles Britanniques» dont il s’agit déjà du deuxième volume, Chandos ayant publié le premier voilà deux ans. Avec ces compositeurs pour la plupart inconnus du grand public – William Walton, Walter Leigh, York Bowen, Ethel Smyth, John Ansell, Alexander Mackenzie, Eric Coates, Charles Parry, Roger Quilter et John Foulds –, le chef britannique poursuit son exploration du vaste répertoire de son pays par des œuvres courtes (entre cinq et douze minutes), dont l’ordonnancement ne respecte pas forcément l’ordre chronologique. Le disque s’ouvre sur une ouverture pétillante de Walton, le plus connu des compositeurs ici réunis, qui rappelle les œuvres contemporaines de Copland, avant de nous faire découvrir la mélodie entêtante d’une œuvre de Leigh, composée pour l’anniversaire du roi Georges V en 1935. La présence de la féministe Ethel Smyth nous rappelle combien le combat des suffragettes était en avance sur son temps au Royaume-Uni, avec l’Ouverture de son quatrième opéra, The Boatswain’s Mate, réorchestrée en 1930. Si l’ouverture Britannia de Mackenzie pourra être connue des familiers des Proms, le programme de ce disque ajoute astucieusement deux œuvres de Bowen et Ansell qui s’inspirent des mêmes thèmes, faisant également la part belle à la musique légère de Coates ou aux mélodies pour enfants revisitées par Quilter. Familier de ce répertoire qui embrasse les dernières années du XIXe siècle jusqu’en 1945, Gamba affiche un ton équilibré parfaitement adapté à ces petites miniatures plus intéressantes qu’il y paraît (CHAN 10898). FC
A la découverte de Hertel

C’est à un très beau programme consacré à quatre concertos pour violoncelle germaniques du XVIIIe siècle que nous convie Alexander Rudin, également à la tête de son ensemble de chambre moscovite Musica Viva. Avec cette formation dont il est le directeur artistique depuis 1988, Rudin a enregistré de nombreux disques consacrés à des compositeurs sortant des sentiers battus, de Dmitri Bortnianski à Boris Tchaïkovski, en passant par Anton Kraft, Jean Balthasar Tricklir ou Jirí Benda – sans pour autant délaisser les grands noms (voir par exemple ses disques Beethoven et Glinka). Ce tout nouveau disque paru chez Chandos tente de concilier ces deux optiques, en rapprochant les figures respectées de Hasse et C. P. E. Bach, tout en nous faisant découvrir le méconnu Johann Wilhelm Hertel (1727-1789), ancien élève de Franz Benda (frère de Jirí). Les deux concertos enregistrés en première mondiale sont très dissemblables, alors qu’ils ont pourtant été composés à seulement quatre ans d’écart. L’influence du plus célèbre des fils Bach apparaît marquante dans le Concerto en la mineur de 1759, merveille de rythmique virtuose qui fait également penser au Premier Concerto pour violoncelle de Haydn, composé entre 1761 et 1765. On se régalera de la comparaison avec le tout premier Concerto en la mineur de Bach composé en 1750, l’un des chefs-d’œuvre de son auteur dont s’empare Alexander Rudin avec une maestria sans pareille. On est moins convaincu dans le Concerto en la majeur de Hertel, daté de 1755, moins immédiatement accessible mais néanmoins agréable par son ton léger et apaisé, où le soliste russe peine dans les longues lignes mélodiques. Si l’on pourra passer sur la prestation poussive de Rudin dans le Concerto en ré de Hasse, ce disque est néanmoins recommandable pour ces deux raretés exhumées, d’un intérêt musicologique réel (CHAN 0813). FC
Spohr: le retour d’une intégrale

On avait un peu oublié cette intégrale des dix Symphonies de Spohr réalisée dans les années 1990 par le chef autrichien Alfred Walter (1929-2004), ancien assistant de Hans Knappertsbusch et Karl Böhm à Bayreuth. Naxos réédite le tout premier volume de cette série parue en son temps chez Marco Polo, avec deux symphonies aux tons différents, Haydn ayant clairement servi de référence à la Première (1811), tandis que l’esprit aérien de Mendelssohn souffle sur la Cinquième (1837). Aidé par une bonne Philharmonie slovaque, Alfred Walter porte ces œuvres romantiques d’un geste élégant et fluide, sans nuages, en une direction classique et équilibrée. Un beau travail, un rien doucereux ici et là, mais qui rend justice à ces œuvres. Les deux prochains volumes sont d’ores et déjà parus – les deux derniers, consacrés aux Quatrième, Septième et Huitième Symphonies, devraient suivre bientôt (8.555500). FC
Carl Philipp Emanuel Bach peu inspiré

Après un tout premier disque consacré à la figure de la chanteuse italienne Faustina Bordoni (1697-1781), voilà deux ans chez Tactus, Ira Hochman et son ensemble Barockwerk de Hambourg s’intéressent cette fois à Carl Philipp Emanuel Bach, plus célèbre des fils de Jean-Sébastien. Il s’agit manifestement du tout premier enregistrement complet de la Bürgercapitainsmusik, composée en 1780 à l’occasion des festivités annuelles données par le capitaine des gardes civils de Hambourg. On se souvient que Telemann, prédécesseur du fils Bach à la charge de directeur de la musique de Hambourg, avait lui-même écrit de nombreux oratorios et serenatas (cantates pastorales) pour cette même occasion. On n’a malheureusement pas là le meilleur de Carl Philipp Emanuel, empêtré dans une musique de commande trop convenue pour réellement convaincre. Peu aidé par une prise de son trop réverbérée, l’orchestre d’Ira Hochman déçoit quant à lui au niveau des vents, tout en se montrant correct par ailleurs, tandis que les solistes affichent un bon niveau, hormis le mezzo techniquement à la peine d’Agata Bienkowska. Un disque globalement décevant (CPO 555 016-2). FC
La terne carte de visite du Concerto Köln

On connaît bien entendu le Concerto Köln qui, par son dynamisme et son esprit de découverte, a jadis fait les beaux jours de l’éditeur Teldec. Souvenons-nous de ses disques géniaux, le mot n’est pas trop fort, consacrés à des compositeurs alors totalement inconnus comme Eberl, Rosetti, Dussek, Kraus (ce sont eux qui enregistrèrent les premiers sa Symphonie funèbre!), aux compositeurs de la cour de Mannheim entre autres. Le présent disque quitte les rives inconnues de la musique baroque pour, au contraire, musarder dans le plus que très connu: le Cinquième Concerto brandebourgeois et la Première suite pour orchestre de Bach, et la première suite de la Water Music de Händel. Qu’on nous permette d’être assez rapide sur cet album intitulé «Portrait», qui ne rassemble que des extraits de disques tous précédemment commentés dans nos colonnes, qu’il s’agisse de la Water Music, des Suites pour orchestre ou, tout récemment, des Concertos brandebourgeois. Formellement, on ne peut reprocher grand-chose à cet orchestre de talent: fluidité des phrases, sens des contrastes, technique irréprochable, sonorités enivrantes (la Water Music!). Ce sont là des qualités connues et depuis longtemps reconnues! Ce qui déçoit, c’est l’appréhension assez sage de ces œuvres où la concurrence de très haut niveau invité au contraire à tenter quelque chose, à oser quitte à déranger un peu. Or, rien de tout cela ici; comme nous avions déjà eu l’occasion de le signaler, on est au contraire déçu par la sagesse de ces interprétations. Les Bach sont assez transparents, parfois même artificiels (comme le clavecin dans le premier mouvement du Cinquième Brandebourgeois), et ne peuvent rivaliser avec d’autres versions bien plus enthousiasmantes. A la limite (et même si l’on en restera sans hésitation aux Gardiner, Pinnock et autres Savall), c’est la Water Music qui est la plus convaincante ici mais, pour qui voudrait découvrir ce merveilleux orchestre, on conseillera ici de passer son chemin (Berlin Classics 0300786 BC). SGa
Une Saint Matthieu en petite forme

Comme nous l’avions déjà constaté lors de son précédent enregistrement Bach également paru chez Carus l’an passé, Frieder Bernius semble avoir quelque peu perdu le feu intérieur qui faisait le sel de ses interprétations. On retrouve dans ce nouvel enregistrement de la Passion selon saint Matthieu le style habituel du chef allemand, fondé sur des tempi allants, sans vibrato ni pathos, apportant un soyeux enveloppant charmeur dès l’ouverture. On est cependant rapidement déçu par l’entrée molle du Chœur de chambre de Stuttgart, pourtant d’un niveau technique tout aussi excellent qu’à l’habitude, mais trop corseté pour réellement apporter un relief et une ferveur à l’ensemble. Les solistes se montrent d’une belle homogénéité globale, avantageusement menés par la lumineuse Hannah Morrison, mais peinent à se hisser au niveau des noms plus prestigieux qui ont jadis abordé cette œuvre souvent enregistrée. Gageons que Frieder Bernius saura nous convaincre davantage dans son nouveau disque sorti à l’automne autour de la musique religieuse plus méconnue de Louis Spohr (coffret de trois SACD 83.286). FC
La rédaction de ConcertoNet
|