|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de septembre
09/15/2015
Les chroniques du mois
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Le Tsarévitch de Lehár à Mörbisch (2010) Le Tsarévitch de Lehár à Mörbisch (2010)
 Trois ballets français à Covent Garden Trois ballets français à Covent Garden
 John Eliot Gardiner dirige Beethoven John Eliot Gardiner dirige Beethoven
 Le Quatuor Elysée interprète Godard Le Quatuor Elysée interprète Godard
 Le violoniste Stefan Tarara Le violoniste Stefan Tarara
 Le Corsaire à Londres (2014) Le Corsaire à Londres (2014)
 Guillaume Tell à Pesaro (2013) Guillaume Tell à Pesaro (2013)
 Helmuth Rilling dirige la Missa solemnis Helmuth Rilling dirige la Missa solemnis
 Bernard Haitink dirige la Missa solemnis Bernard Haitink dirige la Missa solemnis
  Oui ! Oui !
Emmanuel Krivine dirige Bartók
La violoniste Zhi-Jong Wang
Guillaume Tell à Wildbad (2013)
John Eliot Gardiner dirige la Missa solemnis
Roger Muraro interprète Liszt
Julius Katchen à Berlin (1962-1964)
Enregistrements d’Evgueni Mravinski
Così fan tutte à Salzbourg (1983)
Carmen à Vienne (1978)
Turandot à Vienne (1983)
Guerre et paix au Mariinsky (1991)
Enregistrements de Jean Martinon
Enregistrements d’Igor Markevitch
Le Quatuor Archaeus interprète Bowen
Jenůfa à Berlin (2014)
Tianwa Yang interprète Ysaÿe
 Pourquoi pas? Pourquoi pas?
La Chauve-Souris à Mörbisch
U. Schirmer dirige Paganini de Lehár
Vidéos de Friedrich Gulda à Munich (1982-1995)
Eliza de Cherubini
Félix Ardanaz interprète Liszt
Le Chevalier à la rose à Salzbourg (2004)
Le Chevalier à la rose à Glyndebourne (2014)
Paul Schmitz dirige Tiefland d’E. d’Albert
Pas la peine
Lorin Maazel dirige Mahler
Georg Solti dirige Beethoven
Chao Wang interprète Liszt et Chopin
Don Giovanni à Salzbourg (2014)
L’entretien du mois

Roger Muraro
Les matchs du mois
 
 
Missa solemnis de Beethoven: J. E. Gardiner, B. Haitink, H. Rilling ou G. Solti?
 
 
Sonate en si mineur de Liszt: F. Ardanaz, J. Katchen, R. Muraro ou C. Wang?
 
Guillaume Tell de Rossini à Pesaro ou à Wildbad?
 
Le Chevalier à la rose: Salzbourg 2004 ou Glyndebourne 2014?
En bref
M comme Markevitch
M comme Martinon
M comme Mravinski
Jenůfa pour le chef et les chanteurs
Ysaÿe par Tianwa Yang: une version de caractère
Don Giovanni en son palace
Le Quatuor Archæus et le nouvel essor de York Bowen
Trop rare d’Albert
Les «représentations légendaires» d’Arthaus
M comme Markevitch

Réalisés en studio entre juin 1938 et juin 1969, «The Complete HMV Recordings» d’Igor Markevitch (1912-1983) sont presque entièrement concentrés dans les années 1950, avec le Philharmonia (1949-1959) – on reconnaît de nouveau ici un des choix particulièrement pertinents de Walter Legge – mais aussi avec le National (1954-1957) et l’Orchestre Lamoureux (1957-1958). Initiative bienvenue que cette réédition par Erato (dans sa collection «Icon», qui a déjà précédemment honoré Kubelík, Laskine et Starker) du fonds EMI, à un prix très économique mais de façon tout à fait soignée (pochettes cartonnées, intéressante notice biographique): même s’il a également laissé de nombreux enregistrements chez d’autres éditeurs, notamment Deutsche Grammophon et Philips, ces dix-huit disques (près de 22 heures de musique) donnent un aperçu complet des diverses facettes du prodige russe (né à Kiev), parrainé par Cortot et formé par Nadia Boulanger. C’est ainsi certainement à l’apprentissage avec Scherchen (1934-1936) qu’on doit une orchestration par Markevitch de L’Offrande musicale, au demeurant pas aussi inspirée que celle de son maître et desservie par un style d’interprétation qui a fort mal vieilli. Beaucoup découvriront le compositeur – une activité, il est vrai, qu’il exerça pour l’essentiel avant la Seconde Guerre mondiale – au travers du ballet L’Envol d’Icare (1932) et de la «symphonie concertante» Le Nouvel Age (1937), gravés dès 1938 avec l’Orchestre national de Belgique: la musique porte indéniablement la marque de son époque (Bartók, Hindemith, Honegger, Stravinski), mais elle est suffisamment personnelle pour qu’on pense davantage à un esprit du temps qu’à de véritables influences. Après avoir passé les années de guerre en Italie (il est naturalisé en 1947), il est en poste à Florence, en charge du Mai musical – il s’en souvient sans doute dans un florilège d’ouvertures de Rossini et de Verdi mais aussi dans les Canti di prigionia de Dallapiccolla captés en 1952 à l’Académie Sainte-Cécile. C’est en 1982, un an seulement avant sa mort à Antibes, qu’il sera naturalisé français, mais c’est dès les années 1950 que la carrière de Markevitch retrouve Paris, qu’il avait connu un quart de siècle plus tôt: chef permanent de l’Orchestre Lamoureux (1957-1961), il confère un éphémère statut international à cette formation, avec laquelle il donne le rare Une vie pour le tsar de Glinka (avec Christoff, Stich-Randall et Gedda) mais aussi une vigoureuse Périchole d’Offenbach.
Son répertoire d’élection ressort assez nettement: bien plus que dans le grand répertoire classique et romantique, il s’impose dans la musique du XXe siècle, où son exigence de précision est évidemment bienvenue: de tous les enregistrements avec le National, c’est ainsi la Première Symphonie de Chostakovitch qui ressort le mieux, en comparaison de Haydn (L’Horloge et Cent deuxième) engoncés, d’un Schubert (Inachevée) et d’un Mendelssohn (Italienne) sans grand intérêt, d’un Tchaïkovski (Quatrième) bien étrange et même d’un Strauss (Le Bourgeois gentilhomme) manquant de verve. De ce fait, c’est avec le Philharmonia (et de meilleures prises de son) que l’auditeur se régale, y compris à comparer des doublons: les deux versions (1951 et 1959) aussi captivantes que différentes du Sacre du printemps, mais aussi les incontournables pour le jeune public – Pierre et le Loup de Prokofiev et la Présentation de l’orchestre de Britten, incluant une version tardive (1969) avec le tout jeune Orchestre de Paris – où l’on n’imaginait-pas pouvoir entendre autant de détails insoupçonnés. Et que de bijoux dans les œuvres associées à la danse ou au ballet – Bartók, Berlioz, Borodine, Falla, Prokofiev, Ravel, Saint-Saëns, Satie, Stravinski, Tchaïkovski, Weber! Une baguette précise, certes, mais aussi inspirée, avec ses emballements survoltés, son urgence et sa tension, qui réussissent particulièrement dans la description et la narration: Roméo et Juliette de Tchaïkovski, Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgski, Suite scythe de Prokofiev... Un juste hommage (coffret de dix-huit disques 0825646154937). SC
M comme Martinon

Né deux ans avant Markevitch, Jean Martinon (1910-1976) le précéda à la tête de l’Orchestre Lamoureux: tous deux par ailleurs compositeurs, ils étaient réputés pour leur souci d’exactitude, qui a trouvé à s’illustrer dans la musique de leur temps. Et c’est également la collection «Icon» d’Erato qui, sous le titre «The Late Years. Erato and HMV Recordings 1968-1975», publie des enregistrements du chef français – qui a par ailleurs travaillé pour Deutsche Grammophon et Vox – dans un coffret presque aussi épais (quatorze disques, près de 18 heures de musique) et qui aurait même pu être presque deux fois plus volumineux: en effet, il exclut du legs Pathé-Marconi les intégrales Saint-Saëns (la Troisième Symphonie présentée ici est antérieure de cinq ans), Debussy et Ravel, déjà bien connues et souvent rééditées dans le passé. En revanche, on trouvera un enregistrement antérieur à cette période – la Symphonie espagnole de Lalo avec le Philharmonia et un David Oïstrakh sidérant (novembre 1954) – et trois remarquables inédits extraits de concerts (1970-1972) au Théâtre des Champs-Elysées avec le National (qui rendent d’autant plus regrettable l’absence du chef dans le coffret des quatre-vingts ans de l’Orchestre national récemment édité): la Troisième Symphonie de Roussel, la Suite du Mandarin merveilleux de Bartók et Le Tricorne de Falla. Car à son retour d’un mandat mitigé à Chicago (1963-1968), Martinon prit pour six ans la direction musicale du National, accueilli très favorablement par l’orchestre, qui sortait tout juste de plusieurs années difficiles avec Maurice Le Roux. Et, hormis une brève apparition de l’Orchestre de Paris (avec Perlman dans le Poème de Chausson) et de l’Orchestre mondial des jeunesses musicales (Schumann, Berlioz et Brahms), c’est le National qu’on entend tout au long de ce coffret, qui permet d’en apprécier les qualités – nombreuses – mais parfois aussi les limites.
Au moins autant qu’une réévaluation du chef, cette publication est aussi un formidable plaidoyer pour la musique française. Et, comme le soulignait Didier van Moere, rendant compte pour notre site de la réédition des intégrales Debussy et Ravel voici quelques années, «Martinon, c’est la clarté française, le refus de l’éclat gratuit, la mise en valeur des couleurs et des rythmes. Mais l’équilibre, chez lui, n’est jamais fadeur»: tout est dit, tant le propos paraît parfaitement convenir au présent coffret, presque entièrement consacré aux compositeurs français, dont il met en valeur aussi bien les grands classiques que les œuvres restées dans l’ombre – d’Ibert, par exemple, les Escales mais aussi les rarissimes Tropismes pour des amours imaginaires. Ce coffret est à acquérir ne serait-ce que pour ces perles: l’ouverture Polyeucte de Dukas, les ballets Æneas de Roussel et Cydalise et le chèvre-pied (hélas seulement la Première Suite) de Pierné, la Deuxième Symphonie et le Second Concerto pour piano de Landowski. Franck, Honegger et Poulenc complètent cette anthologie francophone à laquelle Martinon aurait fort bien pu ajouter quelques-unes de ses propres œuvres. Car si, au fil de ces disques, il reste plus que jamais associé à la musique française, il n’est pas moins intéressant lorsqu’il aborde les autres répertoires, où l’on ne conserve malheureusement que peu de témoignages de son art: en l’espèce, il faudra ici se contenter principalement de pages concertantes, le flûtiste Jean-Pierre Rampal (1922-2000) jouant sa propre adaptation du Concerto pour violon de Khatchatourian et la pianiste argentine Sylvia Kersenbaum (née en 1945) donnant un fort bon Deuxième Concerto de Tchaïkovski (coffret de quatorze disques 0825646154975). SC
M comme Mravinski

Pour Evgueni Mravinski (1903-1988), comme pour Markevitch et Martinon, la perfection n’était pas un vain mot et, peut-être encore moins que chez ses deux cadets, n’était pas un synonyme de froideur. La «Special Edition» que publie Melodiya n’apporte certes rien de nouveau à la connaissance de celui qui présida, un demi-siècle durant, à ce qu’on appelait alors la Philharmonie de Leningrad, d’autant que ces cinq disques ne sont accompagnés que d’une très maigre notice, dithyrambe ampoulé signé de sa troisième épouse, la flûtiste Alexandra Vavilina-Mravinskaïa (qu’on entend notamment dans le Prélude à l’après-midi d’un faune). Réécouter ces enregistrements réalisés en studio ou en concert entre 1949 et 1982 stupéfie toutefois comme au premier jour, car dans ces près de six heures et demie de musique, tout se maintient au niveau d’exigence et de tension si caractéristiques de Mravinski et de son orchestre merveilleusement typé, aux cordes somptueuses et cuivres intenses. Le répertoire est relativement étendu – de Mozart à Stravinski – mais même ce qui est loin d’être idiomatique – une Neuvième de Bruckner (1980) surchauffée, entre Tchaïkovski et Mahler, un Boléro de Ravel (1949) à la lenteur maléfique, un Apollon musagète de Stravinski (1965) beaucoup plus néoromantique que néoclassique – force l’admiration: une personnalité fascinante s’impose, dont la rigueur ne bride jamais l’inspiration (à moins que ce ne soit l’inverse). Et quand on aborde Brahms – terrifiante Troisième Symphonie (1972) – et, évidemment, Tchaïkovski – les fameuses Quatrième et Sixième «Pathétique» de 1960 –, on entre dans la légende, tant une parfaite mise en place se conjugue avec une imparable exactitude stylistique. Face à des réalisations aussi denses et visionnaires, on en hésiterait presque à parler de «références», tant le terme recouvre parfois des versions tous publics, autrement plus consensuelles et dépourvues d’audace (coffret MEL CD 10 02 295). SC
Jenůfa pour le chef et les chanteurs

Dans cette Jenůfa berlinoise, Christof Loy se place du point de vue de la Kostelnicka et exploite le procédé du flash-back: dans une cellule de prison, cette dernière se remémore le fil des événements qui l’ont incitée à tuer l’enfant de sa belle-fille. Une direction d’acteur acérée compense une scénographie trop fruste qui confine l’action dans une sorte de boîte à chaussures blanche, pauvrement meublée et s’ouvrant, de temps à autre, sur l’extérieur pour suggérer le changement de saisons. Mais il y a heureusement Donald Runnicles, incompréhensiblement hué par des malotrus, qui dirige un orchestre précis et intense ainsi qu’une distribution de haut vol, même si la Jenůfa de Michaela Kaune paraît presque du même âge que la magistrale et émouvante Kostelnicka de Jennifer Larmore. La mezzo américaine incarne un des rôles les plus valorisants du répertoire tchèque, et qui lui convient parfaitement, en conciliant beauté du chant et engagement théâtral. Si Ladislav Elgr chante un Steva correct mais peu marquant, Will Hartmann interprète un Laca mémorable – à noter, également, la Buryjovka de la vétérane Hanna Schwarz. Pour le chef et les chanteurs, nous aurions bien voulu assister à ce spectacle donné l’an dernier au Deutsche Oper (Arthaus Musik DVD 109 069 ou Blu-ray 109 070). SF
Ysaÿe par Tianwa Yang: une version de caractère

Après Mendelssohn, Piazzolla, Sarasate, Castelnuovo-Tedesco et Rihm, Tianwa Yang (née en 1987) se tourne vers Eugène Ysaÿe et confie à Naxos une très belle version des Six Sonates pour violon seul (1924). Virtuose par définition et marquée par une technique violonistique sûre, sa prestation frappe par sa précision, par sa hauteur de vue, par sa vision intensément engagée et par l’urgence intérieure mise en évidence pour chaque pièce. Une prise de son spacieuse à la limite (non franchie) du réverbéré et la riche beauté sonore de son Pietro Guarneri subliment toute la puissance de son jeu. L’ampleur des attaques allonge légèrement les durées mais la présence vitale de la violoniste n’en semble que plus grande. Les points forts abondent mais on peut trouver impressionnante en particulier sa gestion du tremolando ponticello, fantasmagorique, de la Première Sonate et de la complexité finale des cordes de la Cinquième au départ d’une force lyriquement pondérée. Yang trouve le juste équilibre entre la distance noble et la fougue soutenue de la Deuxième «Obsession» et de la Quatrième tout en sachant accuser l’intense lyrisme acrobatique de la Troisième «Ballade». Dans la Sixième, elle dégage des perspectives au-delà de son caractère plus extérieur. L’Opus 27 d’Ysaÿe, chef-d’œuvre absolu, ouvre le champ interprétatif. Cette version de caractère aura donc toute sa place à côté, par exemple, de la perfection mordante de la récente intégrale de Tedi Papavrami (2014), de la maîtrise incisive de celle de Thomas Zehetmair (2004) ou encore de la générosité lumineuse de celle plus ancienne de Gidon Kremer (1992). Recommandé. (8.572995). CL
Don Giovanni en son palace

Comme dans la mise en scène de Michael Haneke actuellement reprise à l’Opéra Bastille, le Don Giovanni présenté durant l’édition 2014 du festival de Salzbourg prend le parti de la transposition chronologique – aux alentours de 1940 – et du décor unique – un hôtel de grand luxe. De ce point de vue, la mise en scène de Sven-Eric Bechtolf (par ailleurs en charge de la programmation artistique depuis l’automne 2014), assortie de décors et costumes de Rolf et Marianne Glittenberg fort agréables à regarder, se révèle d’une parfaite cohérence, sans posséder toutefois la violence et la profondeur de celle de Haneke. Comme si le metteur en scène allemand, à cent lieues d’une note d’intention (qui fait office de notice) mettant l’accent sur «l’ambivalence de l’interaction entre [les] forces» résultant du «schéma des contraires répression/rébellion», s’était laissé engourdir par le confort du palace, au grand complet avec sa clientèle aisée, ses grooms, ses femmes de chambre, son double escalier, son bar, ses fauteuils profonds, ses chariots de valises, ses cocktails et ses verres de tequila. Tout cela paraît donc bien lisse et, somme toute, assez prévisible; car rendre Donna Anna sensible au charme du séducteur, comme le laisse entendre la dramaturgie pendant que se joue l’Ouverture, ou faire renaître Don Giovanni, après le châtiment infligé par Commandeur, pour mieux reprendre la course effrénée de son désir insatiable, tient désormais presque du poncif. Si le ton de cette production tire souvent vers le giocoso, Christoph Eschenbach, à la tête de la Philharmonie de Vienne, a en revanche la main bien lourde et la battue bien lente. La distribution se montre d’un bon niveau, sans être exceptionnelle, portée par les personnalités d’acteurs d’Ildebrando D’Arcangelo dans le rôle-titre et de Luca Pisaroni en Leporello. Mais le timbre ingrat d’Andrew Staples (Ottavio) pourra poser problème à l’auditeur, les voix féminines étant globalement supérieures, avec un léger avantage à l’Elvira d’Anett Fritsch et à la Zerlina de Valentina Nafornita sur l’Anna de Lenneke Ruiten. Enfin, le vidéospectateur peut choisir à tout moment de quitter le film proprement dit et basculer ainsi en mode «vu des coulisses»: le son de la représentation est conservé mais les images proposent tour à tour des cadrages depuis l’arrière ou les côtés de la scène, des plans des artistes entrant ou sortant du plateau, des interviews (muettes!) dans les loges... Un gadget qui est loin de suffire à rehausser l’intérêt de cette publication (EuroArts album de deux DVD 2072738 ou un Blu-ray 2072734). SC
Le Quatuor Archæus et le nouvel essor de York Bowen

Naxos a entrepris de rééditer le catalogue de la British Music Society, dédié à la préservation et à la promotion d’œuvres de compositeurs d’outre-Manche souvent célèbres de leur vivant mais peut-être méconnus aujourd’hui. Le Quatuor Archæus grava en 2001 un programme consacré à York Bowen (1884-1961), chef d’orchestre, pianiste de renom, organiste, altiste, corniste et à la tête d’un catalogue de près de deux cents œuvres. Très en vue jusques aux années 1930, ses compositions doivent encore beaucoup aux styles «fin de siècle», l’élan romantique, puissant et énergique, les audaces chromatiques teintées d’un impressionnisme à la française, leur ample respiration tout à fait franckiste. Sa musique s’apparente par certains côtés à celle de Silvio Lazzari ou de Guillaume Lekeu. Le Quatuor Archæus met à son beau programme les deux Quatuors édités (un premier est perdu), et, rejoint par Timothy Lines, le Quintette «Phantasy» (1932) pour clarinette basse et quatuor à cordes. La «Phantasy» est encore dans la lignée des fantaisies commandées par Cobbett mais n’a de l’esprit élisabéthain que la liberté de ton des climats contrastés de son mouvement unique. La clarinette basse mêle son timbre boisé au quatuor comme un premier violoncelle de quintette, parfois en dialogue avec les cordes comme les cordes entre elles et avec de rares envolées solistes. Classiquement en trois mouvements, lyriques généreux, aérés et fluides, les deux Quatuors (1918 et 1919) donnent une excellente idée du style du compositeur anglais, le grand souffle du Deuxième (en ré mineur) tout à fait prenant, le Troisième (en sol majeur) un brin plus extérieur. Si Bowen n’a rien du pionnier ou de l’innovateur, sa musique, bien défendue par les Archæus, est néanmoins de facture solide, équilibrée, mélodique, épanouie et belle (8.571366). CL
Trop rare d’Albert

Tout juste après la belle réédition d’œuvres symphoniques parue en début d’été, un nouveau disque remet à l’honneur l’art du trop méconnu Eugen d’Albert (1864-1932). On retrouve cette fois son chef-d’œuvre lyrique Tiefland (1903) dans l’enregistrement réalisé en 1963 avec la Staatskapelle de Dresde par Paul Schmitz (1898-1992), un chef estimable qui a fait l’essentiel de sa carrière en Allemagne. Sa lecture évite tout coloris hispanisant pour se concentrer sur l’expression des timbres, en une vision équilibrée qui ne sacrifie rien aux nécessaires ruptures. Mais c’est surtout la prise de son qui impressionne de bout en bout par les détails révélés et le relief obtenu. Assurément, une des grandes qualités de ce disque, le plateau vocal se montrant quant à lui équilibré, sans véritable star en dehors de Theo Adam (Tommaso), toujours impérial avec sa voix profonde parfaitement posée. A ses côtés, Heinz Hoppe (Pedro) compense un timbre un peu rêche par une incarnation vibrante, très convaincante. Sa partenaire, Hanne-Lore Kuhse (Marta), est toute aussi éloquente autour de sa belle voix de velours, malheureusement en peine dans quelques aigus difficiles. Une réédition à saluer, même si l’on pourra préférer un chef plus imaginatif et audacieux dans le coloris orchestral de cette œuvre superbe, qui oscille entre vérisme et réminiscences wagnériennes. Ainsi du long et puissant duo au II entre les deux héros, superbe de maîtrise, où d’Albert parvient à éviter tout lyrisme ou emphase. Réputé peu novateur, ce compositeur mérite mieux que le respect poli où on le cantonne, tant son art fusionne les différentes influences avec une élégance et une fluidité désarmantes de fraîcheur, rappelant souvent les derniers opéras de Dvorák – sans l’inspiration folklorique cependant (album de deux disques Brilliant Classics 95114). FC
Les «représentations légendaires» d’Arthaus
 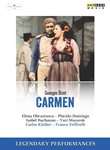
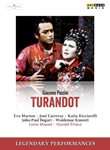 
Arthaus Musik a sélectionné, pour une nouvelle collection au contenu éditorial minimaliste intitulée «Legendary Performances», vingt représentations toutes bien connues et souvent marquantes mais dont peu peuvent toutefois prétendre au qualificatif un peu galvaudé de «légendaires». Avec sept ouvrages (Nabucco, Macbeth, Rigoletto, Simon Boccanegra, Un bal masqué, Aïda, Otello), Verdi se taille la part du lion et le répertoire le plus courant, sans surprise, est également représenté (Les Noces de Figaro, Tannhäuser, Werther, Le Chevalier à la rose) mais quelques volumes sortent un tant soit peu des sentiers battus (Mefistofele, La Gioconda, La Khovantchina, Rusalka, Gloriana). Un coup de projecteur sur quatre de ces parutions confirme le statut de valeur sûre qui peut, à tout le moins, être conféré à cette série.
Ainsi de ce Così fan tutte de Salzbourg (1983), fidèle et solide, un rien démodé, du temps où le festival résistait encore aux relectures et provocations du Regietheater. Mais si la mise en scène de Michael Hampe ainsi que les décors et costumes de Mauro Pagano sont bien sages, dans une esthétique rappelant les grandes années Ponnelle, quelle formidable vitalité dans l’équipe de trentenaires – sinon l’Alfonso de Sesto Bruscantini – aux deux tiers anglo-saxonne réunie sous la baguette vive, énergétique et dramatique de Riccardo Muti (deux DVD 109100 ou Blu-ray 109101)!
Franco Zeffirelli n’est évidemment pas plus audacieux dans sa Carmen à Vienne (1978), qu’il étouffe comme à son habitude dans un excès de réalisme qui n’en devient qu’encore plus fictif, donnant le tournis au spectateur, noyé sous une opulence de détails, un encombrement de figurants et une démesure épuisante – même les chevaux sont de véritables animaux vivants. Mais Zeffirelli le réalisateur est aussi derrière la caméra, qui se promène de façon parfois déroutante sur scène mais qui, surtout, donne à voir Carlos Kleiber dans la fosse. Son génie dramatique revigore sans cesse une partition que chacun croit pourtant bien connaître et même si la distribution est exotique, notamment par sa prononciation, les voix d’Elena Obraztsova et de Plácido Domingo n’en demeurent pas moins impressionnantes (DVD 109096 ou Blu-ray 109097).
Cinq ans plus tard, toujours au Staatsoper de Vienne, Harold Prince a conçu une Turandot (1983) plus moderne et stylisée, mais dont le côté flashy et un peu décalé fleure bon les années 1980. Lorin Maazel en fait des tonnes, mais c’est diablement efficace, surtout que le plateau est sensationnel: Eva Marton en pleine possession de ses moyens, José Carreras trentenaire auquel rien ne résiste, à commencer par les difficultés de son rôle, et Katia Ricciarelli admirable au dernier acte (DVD 109094 ou Blu-ray 109095).
Choix beaucoup plus original, enfin, Guerre et paix de Prokofiev remonte à 1991, dans ce qu’on appelait encore à Saint-Pétersbourg le Kirov, mais déjà avec le jeune Gergiev, qui n’avait pas encore opté pour une barbe de trois jours et une baguette guère plus longue qu’un cure-dents. L’ogre de la direction d’orchestre ne fait qu’une bouchée de l’opéra mythique aux soixante-sept rôles, ici dans une partition restituée sans coupures (4 heures, soit trois quarts d’heure de plus que la version présentée quelques années plus tard à Bastille). Portant fort bien son quart de siècle, la mise en scène de Graham Vick – sans doute plus audacieuse pour le public russe que pour le lyricomane occidental – n’a pas pris une ride, misant – sans doute avec plus de succès dans la première partie («La Paix»), où les grandes cloisons sur lesquelles se découpent portes, fenêtres et autres ouvertures délimitent finement l’espace, que dans la seconde («La Guerre»), où sévissent les incontournables plans inclinés – sur la sobriété du décor, compensée par le soin luxueux apporté aux costumes et accessoires. La distribution est on ne peut plus idiomatique, avec d’excellents rôles principaux, très impliqués – Elena Prokina en Natacha, Alexandre Gergalov en André et Gegam Grigorian en Pierre (deux DVD 109092 ou un Blu-ray 109093). SC
La rédaction de ConcertoNet
|