|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité d’octobre
10/15/2016
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Le pianiste Lucas Debargue Le pianiste Lucas Debargue
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 L’Ensemble Mesostics L’Ensemble Mesostics
 Récital de Youri Egorov Récital de Youri Egorov
 Elizabeth Wallfisch interprète Telemann Elizabeth Wallfisch interprète Telemann
 Fabio Biondi interprète Telemann Fabio Biondi interprète Telemann
  Oui ! Oui !
Seiji Ozawa dirige Berlioz
Seiji Ozawa dirige Ravel
Leif Ove Andsnes interprète Beethoven (documentaire)
Andrés Orozco-Estrada dirige Dvorák
Herbert Kegel dirige La Femme avisée d’Orff
Michael Schønwandt dirige Klenau
La Flûte enchantée à Salzbourg (1982)
David Porcelijn dirige van Gilse
Patrick Davin dirige La Jacquerie de Lalo et Coquard
Pedro Castro dirige L’Angelica de Carvalho
Michael Gielen dirige Brahms
Ronald Brautigam interprète Mozart
Jean-Efflam Bavouzet interprète Mozart
Alfred Brendel interprète Mozart
Tamás Vásáry interprète Mozart
Friedrich Gulda interprète Mozart
Sarah Beth Briggs interprète Mozart et Gál
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Valery Gergiev dirige Berlioz
Le Concerto Köln interprète Bach
Franz Hauk dirige Mayr
Le Sire de Vergy de Terrasse à Angers (2016)
Jacques Lacombe dirige Gisei d’Orff
L’orchestre Les Dissonances interprète Chostakovitch
Olivier Cavé interprète Mozart
Clara Haskil interprète Mozart
Annie Fischer interprète Mozart et Schumann
Alicia de Larrocha interprète Mozart et Beethoven
Leonardo García Alarcón dirige Mozart
Pas la peine
Le Neumeyer Consort interprète Bach
Hans Michael Beuerle dirige Campra
Ingrid Jacoby interprète Mozart
Idil Biret interprète Mozart
Paul Badura-Skoda interprète Mozart
Sophie-Mayuko Vetter interprète Mozart
Danae Dörkens interprète Mozart et Mendelssohn
Hélas !
Grazia Bonasia dirige Piccinni
Hai’ou Zhang interprète Mozart
Le match du mois
 
Concertos brandebourgeois de Bach: Concerto Köln ou Neumeyer Consort?
En bref
Michael Gielen, brahmsien inattendu?
Une Jacquerie à huit mains
Paul von Klenau: résurrection d’une symphonie
L’Angelica, rareté lyrique portugaise
Encore des concertos pour piano de Mozart
Mayr, ce relatif inconnu
Les Dissonances en viennent à Chostakovitch
Van Gilse, un compositeur inégal
Le retour du Sire de Vergy
Campra: Requiem pour un chef
Une Flûte de référence
Orff qui pleure: un opéra de jeunesse
Orff qui rit: réédition de La Femme avisée
Une vaine redécouverte pour Piccinni
Michael Gielen, brahmsien inattendu?

SWR Music poursuit à un rythme soutenu la publication des dix volumes de son édition en l’honneur de Michael Gielen: après un premier volume allant de Bach à Schubert et un deuxième intégralement consacré à Bruckner, le troisième regroupe des enregistrements d’œuvres de Brahms réalisés en studio entre avril 1989 et décembre 2005. Ce n’est pas non plus dans ce répertoire qu’on attend a priori le chef allemand et (feu) son Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg, dont il fut le directeur musical de 1986 à 1999 avant d’en devenir le chef honoraire, mais il se confirme que sa réputation de spécialiste de la musique du XXe siècle a injustement éclipsé ses qualités dans d’autres répertoires. Pourtant, comme le fait apparaître la notice (en allemand et en anglais), Gielen avoue préférer, chez Brahms, sa musique de chambre et pour piano, qu’il juge plus riche en moments «introvertis» (verinnerlicht), à l’image – on n’en sera évidemment pas surpris – de ce Brahms «progressiste» dont Schönberg fit l’éloge. Seuls inédits de ces cinq heures et vingt minutes de musique, un Premier Concerto pour piano (1991) presque plus classique que romantique mais avec Gerhard Oppitz, grand brahmsien s’il en est, poète d’une infinie subtilité, et un Chant du destin (2005) avec le Chœur de la WDR de Cologne, d’une chaleureuse spiritualité qui fait regretter l’absence du Requiem allemand. Mais on découvrira ou redécouvrira avec un même bonheur les quatre autres disques, tout au long desquels il impose une vision cohérente et convaincante, d’une tenue irréprochable: plutôt qu’un Brahms tout en rondeur, en épaisseur et en Gemütlichkeit, il fait primer la rigueur, la clarté, la révélation de certaines voix secondaires. Rien d’excessivement intellectuel, pour autant, dans cette approche, certes plus intransigeante que sensuelle, mais qui manque moins de générosité que, çà et là, de respiration, revers de son souci d’éviter tout alanguissement suspect. Ce n’est certes pas l’orchestre le plus séduisant qui soit, mais aucune faiblesse ne vient réellement ternir ni les quatre Symphonies (dont des Deuxième et Troisième denses et stylées), ni les «compléments» (Variations sur un thème de Haydn, Ouverture tragique). Bien plus, se détachent aussi bien un Double Concerto (1989) confondant de naturel – avec en solistes non pas des stars virtuoses mais de véritables musiciens, Mark Kaplan et David Geringas – qu’une «Cinquième Symphonie» (1991), c’est-à-dire l’orchestration par Schönberg – décidément – du Premier Quatuor avec piano, tout sauf anecdotique ou pesante, d’une vigueur stimulante et irrésistible (coffret de cinq disques SWR19022). SC
Une Jacquerie à huit mains

Lalo n’a pas été très motivé par le travail d’Edouard Blau. Le librettiste prend comme toile de fond le célèbre soulèvement paysan du milieu du XIVe siècle pour développer une banale intrigue amoureuse entre Robert, un révolté, et Blanche, la fille du comte de Sainte-Croix, alors que le compositeur voulait relater plus étroitement ce fait historique, comme Mérimée dans La Jacquerie, scènes féodales. L’auteur de la Symphonie espagnole débute la composition en 1889, au lendemain de la création et des représentations couronnées de succès du Roi d’Ys, mais la mort le rattrapant, il n’achève que le premier acte, pour lequel il puise dans le matériau de son premier opéra, Fiesque, jamais monté de son vivant. Arthur Coquard (1846-1910), un disciple oublié, se charge des trois autres actes, sur un livre complété par Simone Arnaud. La création de cet ouvrage plutôt court – un peu moins de deux heures – en regard d’un tel sujet se déroule à Monte-Carlo en 1895, immédiatement suivie de rares reprises, notamment à l’Opéra-Comique, jusqu’à cette version de concert du 24 juillet 2015 à Montpellier. La Jacquerie présente une légère inégalité d’inspiration, mais de façon inattendue, car si le premier acte suscite un intérêt poli, admiratif que nous sommes du grand savoir-faire de Lalo, les trois autres affichent une tenue, un souffle et des couleurs vraiment épatants, en dépit de pages plus faibles et d’une découpe assez traditionnelle pour une œuvre de cette époque. Voilà donc un bel ouvrage, qui témoigne d’un métier sûr et d’un sens du théâtre certain. Le duo ne livre pas le grand opéra d’exception sur cet épisode majeur, et on se demande, d’ailleurs, ce qu’un Meyerbeer aurait accompli sur ce sujet, mais il devrait intéresser les amateurs du genre, même si La Jacquerie ne n’impose pas avec autant d’évidence que Cinq-Mars, autre rareté enregistrée tout récemment. Ardents et brillants défenseurs de ce répertoire depuis des années, les interprètes lui rendent admirablement justice. Patrick Davin dirige en connaisseur, avec style et enthousiasme, un Orchestre philharmonique de Radio France précis et bien sonnant, auquel s’ajoutent des choristes tout aussi convaincants et consciencieux. Nobles et vaillants, soucieux du phrasé et de l’élocution, les chanteurs appartiennent, pour la plupart d’entre eux, au formidable vivier actuel qui porte haut la bannière du chant français: Véronique Gens (Blanche de Sainte-Croix), Nora Gubisch (Jeanne), Charles Castronovo (Robert), Jean-Sébastien Bou (Comte de Sainte-Croix), Patrick Bolleire (Le sénéchal), Enguerrand de Hys (Baron de Savigny) et Boris Pinkhasovich (Guillaume), encore peu connu, pour le moment, dans ce répertoire. Volume après volume, le Palazzetto Bru Zane édifie, dans cette collection dédiée à l’opéra français, une des entreprises discographiques les plus stimulantes et essentielles du moment (Ediciones Singulares ES 1023). SF
Paul von Klenau: résurrection d’une symphonie

Le nom de Paul von Klenau (1883-1946) est resté attaché à une sympathie sans équivoque pour le IIIe Reich et son idéologie: bien qu’étant un des premiers défenseurs du dodécaphonisme, il préférait en attribuer la parenté à Matthias Hauer et à Alban Berg qui, à la différence de Schönberg, «étaient tous Aryens». En 1940, il épouse Margarethe (divorcée du frère aîné de Gustav Klimt), directrice jusqu’en 1943 de l’office de la mode (Modeamt) de Francfort. Dès lors, si le compositeur danois, comme beaucoup d’autres, revient au pays, c’est non pas en 1938 mais en 1939, et c’est non pas pour fuir le nazisme mais parce que la surdité l’empêche désormais d’exercer ses activités à Vienne. C’est alors qu’il écrit coup sur coup ses cinq dernières symphonies (les quatre premières étaient nées, elles aussi, de façon très rapprochée, entre 1908 et1913). Les deux dernières sont restées inédites jusqu’à la découverte, ces toutes dernières années, d’un grand nombre de manuscrits: c’est donc seulement en mars 2014 que l’ultime symphonie – une Neuvième, comme il se doit –, composée entre décembre 1944 et novembre 1945, a été donnée pour la première fois à Copenhague. Qui dit Neuvième Symphonie dit bien évidemment solistes, chœur et orchestre mais la référence à Beethoven s’arrête là, car les huit mouvements, d’une durée totale de près d’une heure et demie, opèrent une sorte de fusion entre une symphonie et un requiem, les quatre mouvements vocaux étant fondés sur des textes latins (une adaptation de la traditionnelle séquence de la messe des morts ainsi qu’un texte de la main même du compositeur). Dacapo, qui avait déjà édité des enregistrements des Première, Cinquième et Septième voici plus de dix ans, publie la captation de la création de l’œuvre sous la direction de Michael Schønwandt, à la tête des forces de la Radio danoise (Chœur national de concert danois et Orchestre symphonique national danois), sorte de reconnaissance posthume à l’égard de Klenau qui, de son vivant, n’avait guère rencontré de succès au Danemark. Rien à voir, au demeurant, avec les grands symphonistes danois contemporains, Nielsen et Langgaard, et, malgré un dévouement apparemment véritable pour la musique moderne, rien à voir avec Schönberg ou Berg, le caractère sériel ou atonal n’étant pas plus manifeste que dans certaines pages de Liszt ou Strauss. Décrivant une puissante trajectoire des ténèbres («Requiem aeternam») vers l’éclatante lumière conclusive («Stella lucet»), la partition, fondée sur un solide contrepoint et parcourue de vigoureuses implorations de paix («Eternelle contradiction de la vie: en temps de paix, nous nous lassons et, rêvant d’actes héroïques, nous nous ruons pour prendre les armes pour ne désirer, pendant les combats, que la paix» et, bien sûr, «Dona nobis pacem»), s’inscrit résolument dans le postromantisme germanique, celui des grandes fresques de Schmidt et Braunfels (album de deux disques 8.226098-99). SC
L’Angelica, rareté lyrique portugaise

Il existe encore bien peu d’enregistrements permettant de se rendre compte de la qualité du compositeur portugais le plus renommé de son temps, João de Sousa Carvalho (1745-1798), digne successeur de Francisco António de Almeida (1702–1755): on pourra ainsi citer les Vêpres de notre Seigneur (Olivier Schneebeli, Astrée Auvidis, 1997), l’opéra Testoride Argonauta (René Clemencic, Nuova Era, 2002, réédité en 2009), puis un Te Deum (Michel Corboz, Cascavelle, 2009). Le présent enregistrement, réalisé en première mondiale, vient donc s’ajouter à cette liste, avec l’opéra L’Angelica (1778), écrit sur un livret de Métastase d’après l’Orlando furioso de L’Arioste. D’une durée d’un peu moins de deux heures, cette œuvre bénéficie d’une orchestration inventive et variée, en une optique joyeuse et débridée dans l’esprit des opéras comiques de Cimarosa. De la belle ouvrage donc, même si la réalisation technique pourra surprendre d’emblée avec une prise de son inhabituellement acide chez Naxos, ainsi qu’une résonnance notable. Passer outre permettra pour autant de se régaler de cette œuvre délicieuse menée par la rythmique ensorcelante et les attaques tranchantes de Pedro Castro, à la tête d’un bon Concerto Campestre. Autour de lui, le plateau vocal est dominé haut la main par les graves superbes de la mezzo Lídia Vinyes Curtis, qui se joue avec aisance des redoutables vocalises. Assurément une chanteuse à suivre. A ses côtés, l’Angelica de Joana Seara a pour elle de beaux phrasés, exemplaires dans les récitatifs, même si son timbre manque de substance dès lors que le chant s’emporte. Il faut attendre près de trente minutes de musique pour entendre la première et unique voix masculine de l’opéra, incarnée par le ténor Fernando Guimarães – un bon chanteur lui aussi, même si la voix paraît fatiguée çà et là (album de deux disques 8.573554-55). FC
Encore des concertos pour piano de Mozart
Le succès des concertos pour piano de Mozart ne se dément pas: intégrale, séries, versions isolées, rééditions, instruments anciens ou modernes –il y en a pour tous les goûts avec ces dix-sept pianistes. Il est vrai que le corpus est de taille respectable – vingt-et-un concertos (sans compter les sept premiers essais sous forme de «pasticcios» ainsi que les concertos pour deux et trois pianos) – et ne comporte que peu de (relatives) baisses d’inspiration. Comme toujours chez Mozart, la difficulté ne réside pas dans ses exigences techniques mais bien plus, dans le style, les pièges à éviter étant aussi bien une trop grande prudence qu’un excès d’intentions: rien d’exceptionnel, de ce point de vue, dans cette livraison, qui ne remet pas en cause les valeurs confirmées (pour s’en tenir aux intégrales, Anda, Barenboim, Perahia, Zacharias...) mais réserve néanmoins quelques propositions intéressantes, d’autres s’avérant en revanche décevantes, voire exaspérantes.

 
Une intégrale et deux séries
Ronald Brautigam (né en 1954) est sur le point d’achever une intégrale exhaustive, incluant tous les concertos de «jeunesse» et les deux rondos – il ne manque plus aujourd’hui que les quatre premiers ainsi que ceux pour deux et trois pianos – et publiée à rebours de l’ordre chronologique. Les trois derniers volumes parus se révèlent d’ailleurs plus convaincants que celui qui associait les Vingtième et Vingt-septième: ils comprennent respectivement les Quinzième, Seizième et le Rondo K. 382 (décembre 2013), les Huitième «Lützow», Onzième et Treizième (juillet 2014) ainsi que les Cinquième (avec une cadence de Brautigam), Sixième et trois assez brefs «pasticcios» en deux ou trois mouvements d’après des sonates de Jean-Chrétien Bach regroupés par le catalogue Köchel sous le numéro 107 (décembre 2014). Le pianiste néerlandais, resté fidèle aux instruments du facteur américain Paul McNulty, la plupart d’après des pianofortes de Walter (fin XVIIIe-début XIXe), n’a pas peur de cette musique: on trouvera grâce à lui toute l’alacrité et la vie qu’on est en droit d’attendre de nos jours dans ce répertoire, et ce sans excès ni brutalité, avec un souci constant du phrasé et de la couleur, même dans des œuvres qui ne sont pas les plus marquantes de la série. Les mouvements centraux ne traînent pas, au prix d’une certaine raideur métronomique, et les cordes (en petite effectif) de l’Académie de Cologne ne sont sans doute pas très séduisantes, mais, avec son directeur musical, Michael Alexander Willens, l’ensemble allemand fait preuve d’un enthousiasme et d’un peps à l’unisson du soliste, entretenant avec lui un dialogue chambriste (trois SACD séparés Bis BIS-2064, BIS-2074 et BIS-2084).
En quelques mois, Ingrid Jacoby (née en 1959) a réalisé trois disques comprenant successivement les Quatorzième, Vingt-septième et le Rondo K. 382 (juin 2013), les Vingt-et-unième (cadences de Jacoby/Benjamin Kaplin – qui citent la Sonate «Hammerklavier» – et Lipatti), Vingt-troisième et le Rondo K. 386 (cadence de Jacoby) (juin 2014) ainsi que les Premier (cadences de Lili Kraus), Dix-septième et Vingtième (cadences, dans ce dernier, de Badura-Skoda/Jacoby) (novembre 2014). Cette série réserve des versions d’intérêt inégal: la vivacité et l’énergie parviennent par exemple à retenir l’attention dans le Premier, qui n’est évidemment pas le plus captivant du corpus, mais, sans prendre pour autant de grands risques interprétatifs, la pianiste américaine pèche trop souvent par une dureté dans le staccato, une manière trop assertive d’énoncer les thèmes, une tendance à l’affectation. Tout cela ne manque pas toujours d’énergie et regarde volontiers vers Beethoven: rien d’aberrant mais le propos ne s’impose pas vraiment, d’autant qu’il y a plus léger, agréable et déluré que l’Académie de St Martin in the Fields avec le regretté Neville Marriner qui, sans surprise, restent tièdes et fades, bien plus que dans leur intégrale des années 1970 et du début des années 1980 avec Brendel chez Decca (trois disques séparés ICA Classics ICAC 5125, 5135 et 5137).
Après un album consacré à Haydn, Jean-Efflam Bavouzet (né en 1962) retrouve la Camerata de Manchester et Gábor Takács-Nagy, son music director depuis 2011, pour un programme assorti de la mention «volume 1»: s’agit-il du premier volume d’une intégrale ou d’une série, qui serait plus spécialement consacrée aux six concertos de la miraculeuse année 1784 (Quatorzième à Dix-neuvième)? Toujours est-il que dans les Dix-septième (avec, au choix, des cadences de Mozart ou de Bavouzet, celles-ci d’un délicat anachronisme) et Dix-huitième, le pianiste français fait preuve d’une spontanéité et d’une fraîcheur revigorantes. Clarté, allégement, vivacité sont les maîtres mots d’une interprétation où l’accompagnement est parfois réduit à une sorte de «concertino» (en l’occurrence, quatuor) mais qui bute sur l’Andante un poco sostenuto du Dix-huitième. Le chef et l’orchestre font aussi pétiller, en complément, le Divertimento K. 137 (Chandos CHAN 10929).

 
 
Monographies: cinq nouveautés
Parus tout récemment bien qu’enregistrés respectivement en mai 2012 et juillet 2010, les Vingtième (avec les cadences de Beethoven) et Vingt-et-unième (cadences d’András Schiff) de Hai’ou Zhang (né en 1984) agacent par leurs simagrées et leur raideur tout en décevant par leur sonorité terne. Aux côtés de ce piano moderne, Thomas Fey et son Orchestre symphonique de Heidelberg, sur instruments anciens, en rajoutent dans le maniérisme le plus grotesque et caricaturent l’activisme auquel ils nous ont habitués depuis plusieurs années dans leur excellente intégrale Haydn en cours chez le même éditeur (Hänssler Classic HC16037).
Le piano moderne d’Olivier Cavé (né en 1977) se mêle aussi à des instruments anciens, ceux d’un ensemble nommé Divertissement, sous la direction de Rinaldo Alessandrini, pour un enregistrement réalisé en septembre 2014. Après ses réussites, notamment dans Scarlatti et Haydn (voir ici et ici), le pianiste suisse a choisi trois concertos éclatants, les Cinquième, Treizième et Vingt-cinquième (avec, pour deux des cadences, celles de Christian Zacharias). Vif, élégant et dépourvu d’aspérités, le clavier contraste avec l’orchestre, pas étriqué malgré sa petite taille (vingt-et-une cordes), plus enthousiaste mais un peu sec. Une association néanmoins intéressante qu’on aura donc plaisir, le cas échéant, à retrouver dans d’autres concertos (Alpha 243).
Le sixième volume de l’«Edition concertos» d’Idil Biret (née en 1941) est consacré à Mozart, avec les Treizième et Dix-septième, enregistrés en décembre 2014. La pianiste turque ne cherche pas midi à quatorze heures mais ne semble pas avoir grand-chose à dire dans ce répertoire: techniquement impeccable mais sans charme particulier, son Mozart pas trop maniéré, plus prosaïque que probe, manque de conviction et suscite même l’ennui par ses tempi beaucoup trop prudents (les deux Andante – plus de 14 minutes pour celui du Dix-septième). Dirigeant des London Mozart Players aux cordes assez faibles, Patrick Gallois s’accorde avec cette conception: plus souvent éteint que vigoureux, il s’implique de manière variable, desservi en outre par une prise de son avantageant excessivement le basson solo (Idil Biret Archive 8.571306).
Dans un album enregistré en février 2015 et curieusement intitulé «Mozart on the Beach», Paul Badura-Skoda (né en 1927), à 87 ans, remet l’ouvrage sur le métier, avec continuo dans les tutti (et grognements dans les soli). Mais même s’il réussit mieux le Neuvième «Jeunehomme» que le Vingt-et-unième (avec, pour ce dernier, ses propres cadences, remarquables), le pianiste autrichien n’est plus celui qu’on a connu: la frappe est assez dure, les temps forts sont appuyés pour tenter de mener les traits à bon port, le discours manque de tonus. Les doigts ne suivent plus aussi bien, ce qui explique sans doute des tempi trop lents, sauf dans l’Andante du Vingt-et-unième, hélas précipité et martelé. Son compatriote viennois Wolfgang Doerner ne parvient pas à dissimuler les limites de l’Orchestre régional de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont il est le directeur musical depuis 2013. Même dans le court complément («Silence on the Beach»), l’Adagio en ut pour harmonica de verre, on ne reconnaît pas l’immense poète mozartien (Gramola 99067).
Enregistrée en septembre et octobre 2015, Sophie-Mayuko Vetter (née en 1978) déçoit dans le Dix-septième: animée par un véritable esprit poétique et placée très en avant par la prise de son, elle use héla de partis pris trop voyants, minaudant excessivement avec ses notes détachées. La pianiste germano-japonaise sombre dans le Vingt-septième, à la fois soporifique et maniéré, infesté d’ornementations envahissantes et de sautes d’humeur injustifiables. A la tête de l’Orchestre symphonique de Hambourg, Peter Ruzicka s’endort parfois aussi. Deux raretés complètent le programme, avec le violoniste Rainer Kussmaul: un fragment du premier mouvement d’un Concerto pour violon et piano en ré de 1778 (complété par Robert Levin) – qualifié un peu hâtivement par la notice de «tout premier concerto de l’histoire de la musique écrit pour deux instruments» – et une Fantaisie pour violon et piano en ut mineur de 1782 (complétée par Maximilian Stadler, un ami de Mozart), mais ce ne sont que des chutes anecdotiques du catalogue mozartien (Oehms Classics OC 1849).
 
 
Monographies: quatre rééditions
Déjà éditée en 2000 chez Hänssler avec Carl Schuricht en couverture, l’association du Neuvième «Jeunehomme» et du Dix-neuvième sous les doigts de Clara Haskil (1895-1960) reparaît cette fois-ci (après «remastérisation») de façon plus logique avec une photographie de la pianiste suisse d’origine roumaine. Elle se révèle ici égale à sa réputation de mozartienne, d’une sensibilité et d’une expression toujours dépourvues d’excès, d’une évidence et d’une économie de moyens défiant le temps. Schuricht et l’Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart s’engagent à ses côtés en partenaires complices et actifs. Mais le problème est que Haskil a laissé de très nombreux autres témoignages de ces deux concertos: le Neuvième (mai 1952) bénéficie d’une prise de studio tout à fait correcte, mais entre 1952 et 1956, on en dénombre par ailleurs au moins six enregistrements (avec Schuricht, Casals, Ackermann, Jochum, Markevitch et Sacher), tandis que le Dix-neuvième (juillet 1956), également en mono, pâtit d’une captation de concert assez confuse et, ici aussi, souffre de la concurrence de plusieurs autres enregistrements contemporains (avec Fricsay et Desarzens) (SWR Music SWR19013).
Dans sa collection «Remastered Classics» qui, à la faveur du SACD, remet au goût du jour l’expérimentation (sans suite) des enregistrements multipistes par les plus grands éditeurs dans les années 1970 (voir par ailleurs ici, ici, ici, ici et ici), Pentatone Classics restitue deux couplages d’origine. L’un témoigne du tout début (septembre 1970) de l’intégrale d’Alfred Brendel (né en 1931) pour Philips. Dans le Douzième plus que dans le Dix-septième, Marriner et l’Académie de St Martin in the Fields tirent un peu le pianiste autrichien, toujours aussi subtilement inventif, vers quelque chose de plus doucereux, mais ce disque n’en demeure pas moins le témoignage d’un parfait style mozartien, au-delà des époques (SACD PTC 5186 236).
C’est aussi le témoignage, quoique indéniablement plus daté, d’un certain style mozartien que porte Tamás Vásáry (né en 1933), enregistré en octobre 1978 pour Deutsche Grammophon dans les Quatorzième et Vingt-sixième (avec, dans ce dernier, ses propres cadences): se lovant dans l’opulent hédonisme du Philharmonique de Berlin des années Karajan, le pianiste hongrois sourit, non sans rouerie ni parfois même préciosité, et arrondit les angles. Ce Mozart tour à tour grandiose et replet n’est certes plus d’actualité mais ne s’assoupit jamais et conserve un fort pouvoir de séduction (SACD PTC 5186 203).
En septembre 1983, Friedrich Gulda (1930-2000) est associé chez Teldec à Nikolaus Harnoncourt dans les Vingt-troisième et Vingt-sixième (ils enregistrent également au même moment le Dixième avec Chick Corea): précédemment réédité par Apex en 2003, ce couplage n’a pas pris une ride. Le pianiste autrichien n’est certes pas aussi extravagant qu’il a parfois pu l’être, mais conserve une belle dose de fantaisie, de poésie et d’espièglerie. A la tête d’un savoureux Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, Harnoncourt est, lui aussi, moins radical qu’en maintes occasions, même s’il creuse et revisite la partition. La fusion entre les deux artistes est idéale, Gulda accompagnant discrètement l’orchestre (et chantonnant) dans les tutti tandis que dans le Vingt-sixième, les cordes sont réduites à un musicien par pupitre quand elles sont seules à accompagner le soliste (Warner 0825646075959).

 
 
Couplages variés
SWR Music donne à entendre deux grandes dames du piano dans le même concerto, le Vingt-deuxième, à un quart de siècle de distance mais avec le même Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart. En février 1958, Hans Müller-Kray en était le directeur musical et accompagne Annie Fischer (1914-1995) dans une vision puissante, parfois même pesante (début de l’Andante), assurément d’un autre temps, mais sublimée par le jeu plein de santé de la pianiste hongroise, culminant dans la cadence monumentale et jubilatoire de Hummel. C’est énorme, d’un romantisme qui évoque plus Chopin que Mozart, mais formidablement personnel et engagé. Quelques scories laissent supposer que l’enregistrement a été réalisé en concert, comme celui du Concerto de Schumann en février 1959, dans lequel, paradoxalement, elle met moins de passion, en phase avec un Hans Rosbaud bien sérieux à la tête de son Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg (SWR19025).
Le même éditeur propose un enregistrement public de janvier 1986 où Alicia de Larrocha (1923-2009) donne le Vingt-deuxième (avec les cadences de Casadesus), qu’elle devait ensuite graver avec Uri Segal (Decca, 1990) puis Colin Davis (RCA, 1994). Secondée de façon satisfaisante par son compatriote (Luis) García Navarro et l’Orchestre radio-symphonique de la SWR de Stuttgart, la pianiste espagnole échappe à la tentation de faire joli et évite le pathos dans l’Andante central, au point de friser l’indifférence. Equilibré et sans faute de goût, pour ne pas dire lisse, le jeu de Larrocha est assez similaire dans le Troisième Concerto de Beethoven, enregistré en studio en janvier 1977: le volontarisme y est, mais l’approche demeure très classique, apollinienne et rétive au romantisme. Comme dans l’album d’Annie Fischer, l’orchestre accompagnant le «complément» de programme est le Symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg, qui, dirigé cette fois-ci par Ernest Bour, ne s’aventure guère au-delà du minimum syndical (SWR19006).
Danae Dörken (née en 1991) ne convainc pas dans le Vingt-et-unième (cadences d’András Schiff), enregistré en janvier 2014. La pianiste germano-grecque s’enferme dans un jeu trop léché, appuyé, raide et maniéré, tour à tour très détaché et impeccablement perlé. La déception provient aussi de son professeur, Lars Vogt, directeur musical depuis septembre 2015 du Royal Northern Sinfonia (Newcastle), qui apparaît ici bien mat et terne. Cette interprétation artificielle, inutilement compliquée et lestée par trop d’initiatives malencontreuses, est couplée avec le relativement rare Second Concerto de Mendelssohn qui, s’il souffre d’un (mauvais) traitement comparable sous l’effet d’un clavier toujours bien dur et d’une nervosité inutile, résiste mieux que Mozart (SACD Ars Produktion 38 150).
Dans le Vingt-deuxième (cadences de Denis Matthews) enregistré en janvier 2016, la pianiste anglaise Sarah Beth Briggs (née en 1972) ne cherche sans doute pas à aller au-delà du premier degré mais surprend agréablement par son refus de la routine, variant le jeu et témoignant d’un véritable plaisir de faire de la musique, avec le Royal Northern Sinfonia, méconnaissable, très soigné et ne cherchant pas cette fois-ci à imiter vainement les baroqueux. Il faut probablement en faire crédit à la prise de son mais bien plus encore à Kenneth Woods, qui s’est par ailleurs illustré au disque par son intérêt pour le compositeur Hans Gál (1890-1987), dont il a enregistré les quatre Symphonies. Emigré au Royaume-Uni après l’Anschluss, le compositeur autrichien se situe, par son Concerto pour piano (1948), dans la lignée d’un postromantisme évoquant Schmidt ou Schreker, avec un esprit plus ludique et serein, auquel la pianiste et le chef anglais rendent pleinement justice (Avie AV2358).
Reconstituant le programme du concert donné au Burgtheater de Vienne le 23 mars 1783 en présence de l’empereur Joseph II, le double album enregistré en mai 2016 et publié par Ricercar a notamment pour intérêt de remettre à l’esprit le contexte dans lequel Mozart a composé et créé bon nombre de ses concertos pour piano. Cette première «académie» donnée par Mozart dans la ville qu’il vient de rejoindre après avoir quitté avec fracas Salzbourg et l’archevêque Colloredo vise, comme il se doit, à mettre en valeur le compositeur, dans des genres très différents, mais aussi le pianiste et, comme de coutume à l’époque, offre un programme très copieux: une symphonie (la Trente-cinquième «Haffner») dont les mouvements, conformément aux usages du temps, ne sont pas donnés à la suite; deux airs d’opéra (Lucio Silla et Idoménée) et un air de concert (Mia speranza adorata... Ah! non sai quel pena sia) que se partageaient Theresa Teyber et Aloysia Lange (née Weber, sœur de la femme de Mozart, Constance) ; un extrait de sérénade (la Neuvième «Cor de postillon»); une Gigue (postérieure de six ans mais plausible pour rappeler la «fugue» que Mozart a jouée ce jour-là); les Variations sur un air des «Pèlerins de la Mecque» de Gluck. Leonardo García Alarcón dirige l’Orchestre Millenium, formé en 2014, émanation, comme le Chœur de chambre de Namur et l’orchestre Les Agrémens, du Centre d’art vocal et de musique ancienne (CAV&MA) de Namur: si la direction est souvent pêchue, elle tend cependant parfois à fléchir comme dans la Trente-cinquième Symphonie, qui ne tient pas les promesses de son premier mouvement. Sur un instrument de Chris Maene (2006) d’après un Anton Walter de 1795, le pianofortiste allemand Sebastian Wienand (né en 1984) fait preuve de davantage de franchise et d’expressivité que de souplesse tandis que la soprano belge Jodie Devos négocie presque sans encombre des parties sollicitant fortement l’aigu du registre. De manière aussi frustrante que difficile à comprendre, plutôt que de donner le programme entier – il manque en effet un autre concerto, le Cinquième, avec son nouveau rondo (K. 382) final écrit pour l’occasion, un air de concert pour ténor et des variations pour piano sur un air de Paisiello – l’éditeur a préféré compléter le second disque avec les Ouvertures de Don Giovanni et de La Flûte enchantée enregistrées quinze mois plus tôt (deux disques RIC 361). SC
Mayr, ce relatif inconnu

Même si plusieurs enregistrements de ses œuvres existent, on a aujourd’hui presque totalement oublié Johann Simon Mayr (1763-1845) qui, natif de Bavière, fit l’essentiel de sa carrière en Italie. Le présent disque est pourtant le quatrième que l’éditeur Naxos lui consacre avec cette série d’ouvertures d’opéras auxquelles il convient d’ajouter deux brèves Sinfonias. A leur écoute, il serait bien difficile de conférer un style propre à Mayr qui tantôt reste ancré dans le Sturm und Drang de Haydn, tantôt flirte avec Rossini (l’usage parfois des cymbales et de la flûte piccolo rappelant les ouvertures du maître de Pesaro) tout en allant piocher ici ou là dans des mélodies qui évoquent furieusement des ouvertures composées par Cherubini, Cimarosa ou Méhul... Rassemblant donc onze œuvres enregistrées sur une période assez conséquente (septembre 2007 à avril 2014), ce disque peut se résumer en un seul mot: plaisant! Car avec ces ouvertures, on entendra peu de choses véritablement novatrices même si l’intervention de la harpe dans l’Ouverture d’Ercole in Lidia ou le jeu des cors dans celle d’Il segreto, qui rappellent beaucoup, toutes choses égales par ailleurs, les cors de la Trente-et-unième Symphonie «Appel de cors» de Haydn, méritent une oreille attentive. Pour le reste, Mayr semblait apprécier cette alternance classique entre des introductions lentes voire lugubres (Cora ou Ercole in Lidia) et un orchestre ensuite très enjoué, avec de truculentes courses poursuites entre vents et cordes (par exemple dans la deuxième partie de l’Ouverture de Raùl de Créqui). Sous la direction de Franz Hauk, les trois orchestres requis dans ce disque font montre de belles qualités techniques et musicales même s’ils ne parviennent guère à transcender certaines pages à l’intérêt des plus limités (les ouvertures de Gli Americani et de La Passione). Les deux Sinfonias qui concluent le disque font office de curiosité plus qu’autre chose même si la première, en si bémol majeur, rappelle quelque peu le style mozartien (soulignons l’excellence des deux violons solo) que l’on commençait pourtant à oublier à cette époque (Naxos 8.573484). SGa
Les Dissonances en viennent à Chostakovitch
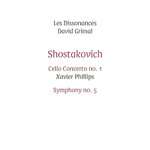
Après Beethoven, Mozart et Brahms, l’orchestre Les Dissonances en vient à Chostakovitch, avec ses deux œuvres orchestrales sans doute les plus célèbres, le Premier Concerto pour violoncelle et la Cinquième Symphonie. Le défi technique va crescendo, mais ne semble toujours pas soulever de problèmes: pas plus que dans les précédents albums, la mise en place et l’équilibre entre les pupitres ne laissent deviner l’absence de chef, alors même que les captations ont été réalisées en public à l’Opéra de Dijon, respectivement en décembre 2014 et en janvier 2016. Cela étant, la musique de chambre «grand format» fonctionne mieux avec l’effectif relativement restreint du concerto, porté par un soliste, Xavier Phillips, qui cumule excellence instrumentale, hauteur de vues et engagement expressif. On perçoit en revanche davantage dans la symphonie les inconvénients d’un manque de conduite: la tension retombe parfois et la raideur de certains phrasés traduit le souci d’un respect collectif de la mesure – toutes choses qui peuvent certes se produire même quand il y a un chef sur le podium... Les Dissonances est son propre éditeur et continue de soigner la présentation de ses publications, sous forme de livre – difficile, par conséquent, à classer et à ranger avec les disques traditionnels – avec une notice (en français, anglais et allemand) comprenant principalement un texte («Slava, une accessible étoile»), où Phillips rend hommage à Rostropovitch, dédicataire et créateur du concerto (même si l’on ne peut dire que leurs interprétations soient stylistiquement proches). Contrairement à de précédents volumes, celui-ci ne contient pas de DVD mais offre néanmoins un «bonus» sous la forme d’un code permettant d’accéder via internet à l’enregistrement du Premier Concerto – théoriquement, toutefois, car l’écran se contente d’afficher que «la vidéo a été supprimée», alors qu’en descendant sur la même page, on découvre quatre vidéos consacrées chacune à l’une des Symphonies de Brahms (LD 009). SC
Van Gilse, un compositeur inégal

Après l’intégrale des quatre Symphonies parue entre 2007 et 2010, l’éditeur CPO, David Porcelijn et l’Orchestre symphonique des Pays-Bas poursuivent leur exploration du répertoire méconnu du compositeur néerlandais Jan van Gilse (1881-1944). Si la Troisième Symphonie (1903) n’a pas laissé un souvenir impérissable (voir ici), on s’intéressera plus volontiers au Concerto pour piano (1926), postérieur à toutes les symphonies, composées entre 1900 et 1915 – la Cinquième étant restée inachevée en 1922. Il est vrai que van Gilse s’est surtout illustré de son vivant en tant que chef d’orchestre, ne parvenant jamais à s’imposer en tant que compositeur. Le concerto révèle pourtant une écriture parvenue à la pleine maturité, même si le langage reste tourné vers la consonance et les postromantiques. Avec des emprunts au jazz et à la danse de salon, on pense ainsi immédiatement à la Valse triste de Sibelius ou aux œuvres populaires de Chostakovitch, telle la Première Suite pour orchestre de variété. Oliver Triendl s’empare de ce concerto volontiers joyeux et espiègle en faisant la part belle aux bois narquois, tout en se régalant des rares dissonances subtiles et lumineuses, dans le style de Prokofiev. Avec les Variations sur un chant de la saint Nicolas (1908), on retrouve malheureusement la première manière de l’ancien élève d’Humperdinck – manifestement englué dans un postromantisme convenu où la seule mélodie domine. Un nouveau disque consacré à van Gilse est d’ores et déjà annoncé par CPO pour la rentrée prochaine, comprenant la cantate Eine Lebensmesse, composée entre 1903 et 1904 (777 934-2). FC
Le retour du Sire de Vergy

Depuis 2005, l’Atelier lyrique angevin fait vivre le répertoire léger: après quelques titres parmi les plus célèbres d’Offenbach et Strauss, la compagnie semble s’être orientée vers d’intéressantes redécouvertes, ce dont témoignent les DVD qu’elle publie sous sa propre étiquette: quatre ans après Chilpéric d’Hervé, voici en effet le premier enregistrement d’un opéra bouffe de Claude Terrasse (1867-1923), pourtant généralement considéré comme le meilleur de son auteur, Le Sire de Vergy (1903). Car le compositeur des musiques de scène pour le cycle Ubu de Jarry (voir ici) s’est surtout fait connaître ensuite par ses opérettes – on a pu entendre ces dernières années en France Chonchette, La Botte secrète, Les Travaux d’Hercule et Au temps des croisades. Avec l’avant-dernier de ces ouvrages, Le Sire de Vergy partage le duo de librettistes (Flers et Caillavet) et, avec le dernier, une manière potache, fantaisiste et anachronique de revisiter un Moyen-âge placé sous le signe de la grivoiserie, du libertinage et de la dérision historique – l’intrigue détourne la fameuse histoire du mari qui fait manger à son épouse le cœur de son amant. Parfois présenté comme le successeur d’Offenbach, Terrasse n’en possède sans doute ni la verve, ni la finesse, mais cet opéra en trois actes n’en témoigne pas moins d’un solide métier et comporte même quelques numéros mémorables. Dans des décors et costumes (délibérément?) pesants et ringards, la mise en scène de Jocelyn Riche met en valeur un livret cocasse et les acteurs, dont la plupart ne manquent pas de vis comica, font rire le public de bon cœur. Toutefois, malgré sa bonne volonté et ses mérites, cette production captée au tout début de 2016 à Angers ne peut prétendre qu’au statut de version d’attente, dans la mesure où elle pèche en qualité tant vocale qu’instrumentale. SC
Campra: Requiem pour un chef

Exhumée dans les années 1980 par la nouvelle génération baroque composée de John Eliot Gardiner ou Philippe Herreweghe, la Messe de Requiem d’André Campra a depuis lors retrouvé sa place parmi les plus grandes œuvres du répertoire du début du XVIIIe siècle. Outre Christophe Rousset en concert, on se souvient d’un disque d’Olivier Schneebeli en 2011 qui avait fait beaucoup parler de lui avec son chœur d’enfants et tout le sérieux apporté par la caution du Centre de musique baroque de Versailles. Son autre réussite récente consacrée à la tragédie lyrique Tancrède (voir ici) a confirmé combien cet intérêt pour Campra n’était pas qu’un feu de paille. C’est outre-Rhin que le grand compositeur français est cette fois à l’honneur avec un disque paru au printemps sous la houlette du méconnu Hans Michael Beuerle (1941-2015) et de son «ensemble3» regroupant des musiciens français, allemand et suisse. Cette version ne bouscule pas la discographie, dominée par Herreweghe, du fait d’un chœur acceptable mais surtout de son plateau vocal de solistes moyens – on notera parmi eux la présence du ténor Benoît Haller, plus connu comme chef et fondateur de La Chapelle Rhénane. La direction de Hans Michael Beuerle, disparu peu de temps après avoir enregistré ce disque, pourra séduire par son parti pris de fusion des timbres qui apporte un climat de douceur et de renoncement, tout en apparaissant frustrante en certains endroits pour son manque de vigueur (Carus 83391). FC
Une Flûte de référence

Dans sa collection économique de rééditions «Legendary Performances», Arthaus publie la captation en 1982 à Salzbourg d’une production de La Flûte enchantée créée quatre ans plus tôt. Pas toujours justifié par les précédents volumes de cette série, le qualificatif de «légendaire» apparaît ici assez peu contestable s’agissant de l’une des mises en scène bien connues de Jean-Pierre Ponnelle (1932-1988), qui tire parti du cadre hors norme de la Felsenreitschule et, sans chercher midi à quatorze heures, privilégie l’humour, la féerie et la poésie sur la métaphysique initiatique. Si le premier degré est pleinement assumé, c’est avec un goût irréprochable, aussi peu trivial que possible, dans un magnifique jeu d’ombres et de lumières d’où se dégage une sorte de sérénité inébranlable et indémodable. Le charme mozartien opère sans doute davantage sur la vaste scène que dans la fosse, où la direction opportunément dramatique de James Levine, qui tient par ailleurs la partie de glockenspiel, a sans doute davantage vieilli avec sa tendance à céder à la lenteur et à l’épaisseur. Cela étant, les voix, d’un format dont on a sans doute perdu l’habitude dans ce répertoire, résistent sans peine à un somptueux Philharmonique de Vienne: point de jeunes premiers pour le duo Tamino-Pamina mais la musicalité de Peter Schreier, au timbre toujours aussi typé, et la grâce d’Ileana Cotrubas, aux côtés de l’impérial Sarastro de Martti Talvela (1935-1989) et de la vertigineuse Reine de la nuit d’Edita Gruberová, tous deux dans l’un de leurs rôles de prédilection, sans oublier Edda Moser et Ann Murray parmi les trois Dames, le splendide Orateur de Walter Berry (1929-2000) et même Kurt Rydl parmi les deux Hommes en armure. Filmé de façon vivante par l’incontournable Brian Large, le spectacle retient une version longue des dialogues parlés, qui permettent de bénéficier pleinement de l’accent délicieusement autrichien du Papageno de Christian Boesch (album de deux DVD 109190 ou Blu-ray 109191). SC
Orff qui pleure: un opéra de jeunesse

On connaît finalement bien mal les compositions de Carl Orff (1895-1982) en dehors de son chef-d’œuvre Carmina Burana (1937), joué à travers le monde avec un grand succès populaire. Si sa renommée a bien entendu souffert de son fatal engagement nazi, les œuvres antérieures à 1937 ont été dénigrées par le compositeur lui-même. La découverte de son tout premier opéra, Gisei (1913), en surprendra plus d’un, tant le langage musical alors évanescent du jeune allemand (il n’a alors que 17 ans) montre l’influence du Pelléas de Debussy, tandis que l’histoire rappelle Maeterlinck par son symbolisme refusant toute dramatisation excessive, au risque d’une action par trop statique. Donné une première fois à Darmstadt en 2010 (on se reportera avec intérêt au DVD de cette production, édité par Wergo en 2012), l’ouvrage a été repris au Deutsche Oper de Berlin en 2012 dans une autre mise en scène, couplé avec l’œuvre jumelle L’Ecole du village de Weingartner (voir ici), qui se fonde sur la même histoire japonaise. Las, si les chanteurs sont globalement d’un bon niveau, le disque pèche encore par la direction pesante et uniforme de Jacques Lacombe, qui cherche une fusion des timbres mal à propos ici: on aurait préféré davantage de contrastes pour réveiller cette musique austère et répétitive (CPO 777 819-2). FC
Orff qui rit: réédition de La Femme avisée

Die Kluge (La Femme avisée) est, avec La Lune, tout juste antérieure, celle des œuvres scéniques d’Orff qui s’est imposée au répertoire. Pour cette «histoire en douze scènes» sous-titrée «L’Histoire du roi et de la femme rusée», le compositeur, auteur du livret, s’est notamment fondé sur un conte des frères Grimm et sur un recueil de comédies populaires. Le roi soumet trois énigmes à la fille d’un paysan qu’il a injustement emprisonné; les ayant résolues, elle libère son père puis épouse le roi mais il ne tarde pas à la renvoyer pour trahison lorsqu’elle s’élève contre une erreur judiciaire qu’il a commise dans un procès farcesque entre un ânier et un muletier. Il l’autorise toutefois à emporter dans un coffre «ce qui lui tient le plus à cœur»: elle l’endort en lui administrant un somnifère et en lui chantant des berceuses et, profitant de son sommeil, le porte dans le coffre, où il se réveille le lendemain matin, subjugué par son épouse. On reconnaît aisément l’auteur des Carmina Burana (l’un des personnages fait d’ailleurs plaisamment allusion à «O Fortuna»), particulièrement de sa deuxième partie («In taberna»), dans ces féroces ostinatos soulignés par les percussions, cette plaisante prosodie, cette modalité archaïsante et ces chansons à couplets d’allure populaire. Mais le langage musical est ici encore plus hybride, avec quelque chose du sillabato et de la luminosité d’un Rossini, mais aussi de la noirceur et de l’ironie du cabaret brechtien. Auteur d’une formidable intégrale des Trionfi quelques années plus tôt (voir ici), Herbert Kegel revient ici avec bonheur à ce compositeur qu’on ne s’attendait pas nécessairement à voir honoré de la sorte en Allemagne de l’Est. Bizarrement étalé en quatre prises effectuées en quatre ans et demi (juin 1976-décembre 1980), peut-être en raison d’une réalisation ultérieure des dialogues parlés, confiés ici à des acteurs, l’enregistrement confirme les qualités du chef allemand dans cette musique – main de fer, direction cinglante et mordante. Les chanteurs sont à l’avenant, avec une diction parfaite, même si l’on regrette, dans le rôle-titre, de ne pas retrouver Elisabeth Schwarzkopf, la vedette de la version Sawallisch (1956, EMI) ou Lucia Popp, qui le chantait sous la direction d’Eichhorn (1970, RCA). Cette réédition offre également l’occasion de relire à plus de trente ans de distance la notice de la première édition (hélas sans le texte du livret), dont l’auteur se livre à un spectaculaire grand écart idéologique, dénonçant «les limites du point de vue bourgeois [en français dans le texte] de Carl Orff» pour mieux décrire ensuite celui qui est souvent considéré comme le «compositeur officiel» du IIIe Reich en dénonciateur, à travers son opéra, créé à Francfort en 1943, du «renversement progressif de toutes les valeurs humaines sous le régime nazi». On attend désormais le retour de La Lune, paru autrefois chez le même éditeur également sous la direction de Kegel (album de deux disques Berlin Classics 0300748BC). SC
Une vaine redécouverte pour Piccinni

Elève de Leonardo Leo et Francesco Durante à Naples, Niccolò Piccinni (1728-1800) fut l’un des compositeurs les plus renommés de son temps, recueillant les faveurs de la reine Marie-Antoinette dans les années 1770, avant que sa querelle perdue face à Gluck ne fasse pâlir peu à peu son image. Avec ses quelques 116 opéras, la production religieuse du Napolitain a été quelque peu éclipsée, à tel point qu’on ne sait à quelle date précise ont été composées les deux compositions réunies sur ce disque, un Pater Noster et un Credo, si ce n’est que la première l’a été «pour la Reine de France et de Navarre Marie-Antoinette». Enregistrée en première mondiale, cette œuvre pâtit d’une interprétation calamiteuse de l’ensemble Il Mondo della Luna, qui joue faux dès les premières mesures, sans parvenir à se rattraper par la suite. On n’est guère plus convaincu par la direction pesante de Grazia Bonasia associée au vibrato envahissant de Vittoria Didonna, qui ne contribuent pas à relever le niveau artistique bien faible, hélas, de ce disque (Digressione Music DIG57). FC
La rédaction de ConcertoNet
|