|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité d’avril
04/15/2014
Les chroniques du mois
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Cédric Pescia interprète Bach Cédric Pescia interprète Bach
 Quatre œuvres de Harrison Birtwistle Quatre œuvres de Harrison Birtwistle
 Le Viol de Lucrèce à Aldeburgh (2001) Le Viol de Lucrèce à Aldeburgh (2001)
 John Storgårds dirige Madetoja John Storgårds dirige Madetoja
 Sarah Lavaud interprète Janácek Sarah Lavaud interprète Janácek
  Oui ! Oui !
Kotaro Fukuma interprète Debussy
Nino Gvetadze interprète Debussy
Le Quatuor Tippett interprète Rózsa
Damian Iorio dirige Casella et Ghedini
Francesco La Vecchia dirige Catalani
Paavali Jumppanen interprète Beethoven
Peter Grimes à Aldeburgh (2013)
Gloriana à Covent Garden (2013)
Dorothee Oberlinger interprète Telemann
Nikolaï Lugansky interprète Chopin
Giuseppe Grazioli dirige N. Rota
«Road 66» avec Shani Diluka
«Ragtime» avec Bruno Fontaine
Neeme Järvi dirige Atterberg
Christian Lindberg dirige Pettersson
Le Quatuor Stenhammar interprète Stenhammar
András Schiff interprète Beethoven
Trois œuvres de Kalevi Aho
John Storgårds dirige Madetoja
Sakari Oramo dirige Nielsen
Musique anglaise des XVIe et XVIIe par John Holloway
Musique de chambre de Klaus Egge
James Levine dirige à Carnegie Hall
Trois opéras de Wagner chez Arthaus
Guillaume Tell de Grétry
Grétry, un «portrait musical»
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Bernhard Klee dirige Les Joyeuses Commères de Windsor
Pascal Gallet interprète Debussy
Yegor Shevtsov interprète Debussy et Boulez
Les Troyens à Covent Garden (2012)
Le Quatuor de Venise interprète Casella et Turchi
Francesco La Vecchia dirige Petrassi
Soo Park interprète Beethoven
Jean-Efflam Bavouzet interprète Beethoven
Christian Thielemann dirige Brahms
Documentaire Carlos Kleiber. I am lost to the world
Héloïse Gaillard interprète Telemann
Nuages gris, le dernier pèlerinage de Franz Liszt
Ouvrage collectif Le Silence d’or des surréalistes
La Techno minimale de Nicolas Guillien
Voces8 et Les Inventions interprètent Purcell
«American Journey» avec Jean-François Heisser
«Impressions espagnoles» avec Carolin Danner
Michael Tilson Thomas dirige à Boston (1970)
Hommage vidéo à Tito Gobbi
Menahem Pressler interprète Schubert et Beethoven
Menahem Pressler interprète Grieg et Mendelssohn
Le Quatuor Nightingale interprète Langgaard
Bo Holten dirige Riisager
Neeme Järvi dirige Svendsen
Rienzi à Toulouse (2012)
Pas la peine
Laurens Patzlaff interprète Debussy
Emy Bernecoli et Massimo Giuseppe Bianchi interprètent Respighi
Alexej Gorlatch interprète Beethoven
Timothy Ehlen interprète Beethoven
Ingrid Fliter interprète Chopin
Gabriel Chodos interprète Beethoven
Alan Gilbert dirige Lindberg
L’entretien du mois

Sarah Lavaud
Le match du mois
 
Fantaisies pour flûte de Telemann: H. Gaillard vs. D. Oberlinger
En bref
Concertos de Chopin: Nikolaï Lugansky vs. Ingrid Fliter
Rien de Tell que Grétry
Pavanes et Fantaisies de Morley et Dowland à Purcell
James Levine is back!
Musiques américaines
Scandinavie 1: Danemark (Langgaard/Nielsen/Riisager)
Scandinavie 2: Finlande (Aho/Lindberg/Madetoja)
Scandinavie 3: Norvège (Egge/Svendsen)
Scandinavie 4: Suède (Atterberg/Pettersson/Stenhammar)
La part méconnue de Nino Rota
Wagner en vidéo... et en vrac
La «Purcell Collection» de Voces 8 et Les Inventions
De nouvelles Diabelli? Schiff plutôt que Chodos
Aedam Musicae à la croisée des genres et des arts
Archives vidéo d’ICA: Tito Gobbi et Michael Tilson Thomas
Liszt sur le divan
Le legs pianistique de Menahem Pressler
Les «Impressions espagnoles» d’une pianiste allemande
Concertos de Chopin: Nikolaï Lugansky vs. Ingrid Fliter
 
Ces deux nouvelles versions des Concertos pour piano de Chopin, si elles ne bouleversent pas la discographie, ne la déparent pas non plus. Enregistrée en juillet 2013, celle de Nikolaï Lugansky (né en 1972) se révèle préférable, non pas tant en raison de l’accompagnement finement attentif mais sans miracles ni grande personnalité d’Alexander Vedernikov (avec le Sinfonia Varsovia) qu’au regard du geste distancié mais incontestable du pianiste russe, à la subtilité sans affectation, à la virtuosité contenue et subtile – plus convaincant dans le fa mineur (qui s’achève sur Allegro vivace déchaîné) que dans le mi mineur, moins exalté (Ambroisie Naïve AM 212). Enregistrée un mois plus tôt, l’interprétation d’Ingrid Fliter (née en 1973) extériorise davantage l’émotion – sans s’abîmer pour autant dans la mièvrerie. Si elle soigne moins le détail des finitions et l’architecture de l’ensemble que Nikolaï Lugansky, la pianiste argentine livre un Chopin certes sans originalité aucune mais qui avance, déterminé et probe. Jun Märkl et l’Orchestre de chambre écossais déçoivent davantage, souvent transparents voire routiniers (Lynn Records CKD 455). GdH
Rien de Tell que Grétry
 
A l’occasion du bicentenaire de la mort de Grétry, l’Opéra royal de Wallonie a représenté le Guillaume Tell de l’enfant du pays en juin dernier. Créé en 1791, ce drame en trois actes partage peu de points commun avec le monument de Rossini: moins de personnages (pas de Mathilde ni d’Arnold), un déroulement différent, une durée inférieure (une heure vingt, avec de nombreux passages parlés). Il n’y a guère de moments exceptionnels mais l’orchestration présente une certaine tenue. Brefs mais bien ficelés, les numéros se succèdent rapidement et avec bonheur. Musique en Wallonie publie un enregistrement de cette production. La prise de son, qui manque de définition, conserve les bruits de plateau, ce qui suscite d’ailleurs le regret de ne pas disposer également d’un DVD pour admirer une mise en scène manifestement épatante à en croire les photographies figurant dans la notice. Néanmoins, cette publication constitue une excellente opportunité de découvrir un bien bel ouvrage, malgré que les chanteurs, belges pour la plupart, et dans l’ensemble estimables (surtout la magnifique Madame Tell d’Anne-Catherine Gillet), adoptent dans les dialogues une diction emphatique assez horripilante. Claudio Scimone dirige un orchestre enthousiasmant et discipliné (MEW 1370). Le même éditeur dresse un «Portrait musical» du compositeur dans un coffret de cinq disques paru simultanément. Il s’agit d’enregistrements précédemment publiés par d’autres labels (Ricercar, EMI, Koch-Schwann) ou par Musique en Wallonie lui-même: des extraits de l’opéra-ballet La Caravane du Caire par Marc Minkowski (1991) et de deux comédies en trois actes mêlées d’ariettes, L’Amant jaloux ou les fausses apparences par Edgard Doneux (1977) et Le Jugement de Midas par Ronald Zollman (1978), et non par Leonhardt, version rééditée naguère par Ricercar couplée avec, justement, La Caravane du Caire par Minkowski. Figurant dans le quatrième disque, les Six Quatuors à cordes opus 3 enregistrés par le Quatuor Haydn (1991), qui ne totalisent même pas une heure de musique, méritent d’être connus. Le dernier disque comporte, quant à lui, des transcriptions et adaptations de pages de Grétry par Boëly, Dussek, Franck, Godefroid, Mozart et Vitzthumb. Doté d’une notice agrémentée de belles illustrations, mais dépourvu des livrets et synopsis des œuvres lyriques, ce coffret permet de découvrir à prix d’ami, et dans de remarquables conditions, ce compositeur dont la statue fait fièrement face à l’Opéra royal de Wallonie (MEW 1371). SF
Pavanes et Fantaisies de Morley et Dowland à Purcell

John Holloway (né en 1948), violoniste baroque basé actuellement à Dresde, célèbre ses origines par un programme entièrement consacré à treize pavanes et fantaisies pour consort de violes à deux, trois ou cinq parties de six compositeurs anglais de Thomas Morley (1557-1602) à Henry Purcell (1659-1695). Il préfère cependant au consort de violes un consort de violons cordés de boyaux et son ensemble se compose de deux violons prenant alto (Holloway, Monika Baer), un violon (Renate Steinmann), un alto (Susanna Hefti) et une basse de violon (Martin Zeller). Le son est plus plein, sans doute plus charnu, peut-être moins intimiste mais la prestation des cinq instrumentistes convainc par ses fines qualités expressives, un contrepoint moelleux et une légèreté de touche qui convient tout aussi bien aux Fantaisies plus dansantes, plus extérieures de John Jenkins et William Lawes qu’à la finesse des sentiments tout à la mélancolie du délicat Lamento, deuxième des huit Fantaisies de Morley. La même finesse irise encore la belle sobriété de la Fantaisie plus tardive de Matthew Locke et la brève mais merveilleuse Fantaisie sur une note (ca.1680) aux épisodes contrastés de Purcell. L’audace de Holloway, que l’on peut apprécier ou non, c’est de faire des Lachrimæ (1604) de John Dowland son fil rouge, chaque «larme» exquise suivie d’une Fantaisie d’une autre main. La septième vient en conclusion du programme établi de manière à varier la nature et le nombre des instruments. Les sept pavanes semper dolens sont autant de variations sur le thème du célèbre air avec luth «Flow my teares» avec, malgré la mélancolie qui domine, deux clins d’œil musicaux en deuxième et cinquième position, dont le sel est un peu perdu dans cette programmation alternée. Comme les autres pièces en majorité, les sept «Larmes» relèvent de la tradition nationale d’avant l’âge baroque marquée par une polyphonie modalement et tonalement ambiguë, aux fausses relations et aux dissonances non résolues. C’est un ensemble qui charme l’oreille sans manquer de profondeur (ECM New Series 481 0430). CL
James Levine is back!

Le 19 mai 2013 au Carnegie Hall de New York et devant son Orchestre du Metropolitan Opera, James Levine (né en 1943) faisait son retour sur scène, après deux ans de retrait pour des motifs de santé qui n’ont pas eu raison – et l’on s’en réjouit – de son énergie musicale (lire notre chronique (en anglais) de ce concert). Un double album se fait l’écho de ce glorieux come back, qui débute par un Wagner luxueux – le «Prélude» du premier acte de Lohengrin – frémissant d’une lumière argentée, en technicolor mais sans une once de vulgarité. Y succèdent, conformément au triptyque traditionnel, un concerto et une symphonie... Une certaine brutalité de la baguette (franchement gênante dans le mouvement central) n’empêche pas Evgueni Kissin (né en 1971) de transformer le Quatrième Concerto de Beethoven en un moment de poésie et de grâce (qui contraste avec la joie enthousiaste du Rondo a capriccio «La Colère pour un sou perdu» donné en bis). On admire la richesse de son toucher et la variété presque infinie des nuances de son jeu, jamais clinquant ni brutal, parfois peu beethovénien mais empreint d’une intériorité touchante. Epatant par sa souplesse (et le choix de tempos nerveux), la Neuvième Symphonie de Schubert est assez irréprochable et conclut brillamment ce qui n’est peut-être pas le «historic live event» qu’annonce la pochette, mais assurément un bel et émouvant concert (double album Deutsche Grammophon 0289 481 0553 3). GdH
Musiques américaines

 
Mirare publie deux disques qui s’inscrivent dans la thématique de la précédente édition de la Folle Journée de Nantes consacrée à la musique américaine. A la tête d’un Orchestre Poitou-Charentes pas exceptionnel mais néanmoins compétent, Jean-François Heisser interprète un programme plutôt inédit. Cet «American Journey» commence avec la Sérénade pour violon, harpe, cordes et percussion (d’après Le Banquet de Platon) de Bernstein, qui déçoit, certains mouvements, particulièrement le dernier, s’avérant plus réussis que d’autres. La prestation de Tai Murray (née en 1982) au violon présente peu d’attraits (phrasés parfois relâchés, intonation pas toujours juste, sonorité modérément attrayante) et les cordes manquent d’étoffe. La mise en place s’avère toutefois suffisamment précise, le rythme est assez entrainant mais le dialogue entre l’orchestre et la soliste soutient peu l’intérêt. Suivent le sempiternel Adagio de Barber, émouvant comme d’habitude, une haletante Suite de Psychose de B. Herrmann, les Trois Préludes pour piano de Gershwin, interprétés par Heisser himself, et une Unanswered question d’Ives nimbée de mystère (MIR 244).
L’autre enregistrement de Mirare en rapport avec la thématique de la précédente édition de la Folle Journée – le disque «officiel» de la manifestation – s’avère plus abouti et, surtout, plus personnel. Dans ce programme judicieusement agencé et intitulé «Road 66», Shani Diluka (née en 1976) associe chacune des dix-huit pièces qui le compose à des extraits de Sur la route de Kerouac afin de constituer une sorte de parcours initiatique. L’écoute en continu, probablement la meilleure manière d’apprécier ce disque, provoque divers sentiments, comme la nostalgie et la tristesse, et plonge dans un état d’esprit propice à la médiation et à l’évasion. L’enchaînement naturel des pièces donne l’impression qu’il s’agit de la même œuvre, ce qui est assez troublant. Pourtant, l’interprète a puisé dans le catalogue de pas moins de quatorze compositeurs, plus (Adams, Barber, Bernstein) ou moins (Amy Beach, Hyung-Ki Joo) connus et évoluant dans des registres différents (Copland, Bill Evans, Keith Jarrett). Prises individuellement, la plupart des pièces présentent un intérêt relatif mais c’est l’ensemble qui prévaut. Natalie Dessay participe à ce projet qui sort de l’ordinaire en interprétant What is the thing called love de Cole Porter arrangé par Raphaël Merlin (violoncelliste du Quatuor Ebène). L’interprétation de la pianiste d’origine sri-lankaise est magnifique mais il ne faudrait pas conclure trop hâtivement que ce disque reflète la diversité et la complexité de la musique américaine (MIR 239).
Bruno Fontaine (né en 1957) nous entraîne lui aussi à sa façon aux Etats-Unis, pays d’origine du ragtime. Le pianiste, par ailleurs arrangeur, chef d’orchestre et compositeur, a sélectionné dix-huit pièces appartenant à ce genre précurseur du jazz, certaines conçues par lui-même. Il a arrangé chacun d’elles, sauf «Golliwog’s Cakewalk» de Debussy sur lequel débute ce disque. Le programme se poursuit avec des pages de Thomas «Fats» Waller, Scott Joplin (principal représentant du genre), Tom Turpin, Joseph Lamb, James Scott, Joseph M. Daly et s’achève sur Ragtime Parade de Satie. Ces 80 minutes s’écoulent avec plaisir et constituent une bonne introduction à cette musique (Aparté APR063). SF
Scandinavie 1: Danemark (Langgaard/Nielsen/Riisager)

 
L’actualité discographique réunit la musique de plusieurs grands compositeurs scandinaves aujourd’hui encore presque entièrement méconnus dans notre pays: c’est le cas de ces trois Danois du XXe siècle mis à l’honneur par des éditeurs nordiques.
Quantitativement l’égal, dans cette génération, d’un Milhaud, d’un Martinů ou d’un Villa-Lobos, Rued Langgaard (1893-1952) laisse une œuvre colossale, d’où émergent notamment seize étonnantes Symphonies dont le mélange très personnel de tradition et d’innovation n’est pas sans évoquer Ives. Le Quatuor Nightingale, constitué en 2007, a entrepris chez Dacapo une intégrale de son œuvre pour quatuor à cordes: huit partitions (dont six Quatuors numérotés) écrites en à peine dix ans au tournant des années 1910 et 1920 et, pour la plupart, tout récemment éditées. Cinq d’entre elles sont marquées par les deux mois durant lesquels le compositeur, alors âgé de 20 ans, séjourna en Suède avec ses parents dans une demeure dénommée «La Roseraie» et tomba amoureux d’une certaine Dora: c’est le cas des œuvres, datant toutes trois de 1918, présentées dans le deuxième volume – imprévisible Langgaard, tant il est fascinant de penser qu’elles non seulement signées par l’auteur de la révolutionnaire Musique des sphères mais qu’elles en sont très exactement contemporaines! Car les quatre pièces du Jeu de la roseraie (1918) – une première au disque, l’intégrale du Quatuor Kontra (RCA/Dacapo), voici près de trente ans, les ayant omises – surprennent par leur climat tour à tour tendre («Intérieur»), frais («Mozart»), mélancolique («Une goutte qui tombe») et élégant («Rococo»). Encore plus anachronique, le Quatuor en la bémol, créé en 1993, tient davantage du pastiche, quelque part entre Mendelssohn et Dvorák. Le Quatrième Quatuor «Jours d’été», initialement sous-titré «Lacrimetta», résulte, pour ses deux mouvements extrêmes, d’un recyclage, treize ans plus tard, de deux des pièces du Jeu de la roseraie mais aussi du premier mouvement de son Premier Quatuor, tandis que le bref mouvement central reprend le thème d’une mélodie sur un poème de Goethe. Délicieusement suranné (6.220576).
Même s’il n’apparaît guère à l’affiche des concerts dans nos contrées, Carl Nielsen (1865-1931) est heureusement fort bien servi au disque, notamment au travers de nombreuses intégrales de ses six Symphonies, depuis Schmidt (Unicorn) jusqu’à Vänskä (Bis), en passant par Blomstedt (Decca), Schønwandt (Dacapo) et C. Davis (LSO Live). Celle qu’engagent chez Bis l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm et Sakari Oramo (né en 1965), chefdirigent et conseiller artistique depuis 2008, avec les deux plus célèbres d’entre elles, la Quatrième «L’Inextinguible» (1916) et la Cinquième (1922), est bien partie, si elle se maintient à ce niveau, pour rejoindre les meilleures et rendre admirablement justice à ce symphoniste capital: direction intense et spectaculaire raffinée, orchestre superbement mis en valeur par la prise de son. Le résultat en deviendrait presque trop somptueux pour la rude Cinquième (SACD BIS-2088).
Bo Holten (né en 1948) et le vaillant Orchestre symphonique d’Aarhus poursuivent chez Dacapo l’édition qu’ils consacrent à Knudåge Riisager (1897-1974). Après un intéressant deuxième volume, la totalité du programme du troisième est constituée de premières au disque et montre le visage très assagi de celui qui avait été un trublion de la vie musicale danoise au début des années 1920. Il s’agit principalement de ses deux dernières symphonies (non numérotées mais de fait les Quatrième et Cinquième): la Sinfonia gaia (1940), qui n’avait pas été jouée depuis sa création, au message énergique et positif (non sans évoquer «L’Inextinguible», elle aussi en complet décalage avec les tragédies de son temps), et la Sinfonia serena (1950) pour cordes et timbales, plus élancée par son instrumentation mais pas moins revigorante, évoquant la virtuosité des œuvres pour cordes de Britten dans les années 1930. On découvrira aussi une brève Sinfonia concertante per strumenti ad arco (1937) en cinq mouvements dans le même esprit néoclassique franc et chaleureux puis une assez irrésistible Rhapsodie estivale (1943) sur des mélodies populaires danoises (8.226148). SC
Scandinavie 2: Finlande (Aho/Lindberg/Madetoja)

 
Trois échos récents d’une nation de très vivace tradition musicale, avec deux contemporains et un grand ancien.
Dans la continuité de Rautavaara (dont il fut l’élève), Kalevi Aho (né en 1949) s’est affirmé comme l’un des grands symphonistes de son pays, ne serait-ce que quantitativement, ayant publié à ce jour seize symphonies (mais aussi trois symphonies de chambre, vingt concertos, cinq opéras...). Dima Slobodeniouk dirige la Quinzième (2010): créée par Juanjo Mena à Manchester, elle se présente en quatre mouvements (enchaînés deux à deux) à l’orchestration recherchée (flügelhorn, heckelphone...) et aux titres (en italien) intrigants: «Brouillard» pas si vaporeux avec ses oppositions de blocs instrumentaux, «Musique bizarre» à tonalité vaguement orientalisante sur fond de percussions exotiques (bongos, congos, darbouka, djembé), énigmatique «Interlude» doux carillon du célesta, du glockenspiel et des percussions métalliques et «Musique étrange», nouvelle danse, beaucoup plus développée et affirmative que la précédente, brillante et dynamique. On retrouve l’Orchestre symphonique de Lahti, dont Aho est le «compositeur honoraire» (après y avoir été en résidence de 1992 à 2011!), mais cette fois-ci avec son ancien directeur artistique et désormais chef honoraire, Osmo Vänskä, dans une pièce commandée par son Orchestre du Minnesota, Minea (2008): de facture plus traditionnelle quoiqu’inspirées par les râgas indiens mais aussi par les musiques traditionnelles japonaise et arabe, ces 20 minutes méritent bien leur sous-titre de «musique concertante», véritable concerto pour orchestre sous la forme d’un formidable crescendo virtuose et rythmé. Enfin, au genre assez peu fourni du concerto pour contrebasse, Aho – qui, après avoir écrit des concertos pour tuba, contrebasson, theremin ou quatuor de saxophones, n’en est pas à son premier défi – a apporté en 2005 une contribution en cinq mouvements (donc deux cadences, la première avec harpe, la seconde avec percussions tintinnabulantes) de nature assez rhapsodique, dont la conclusion est inspirée de façon un peu trop évidente de celle de la Quinzième Symphonie de Chostakovitch. Mais les interprètes de la création, l’Orchestre de Lahti (sous la direction de Jaakko Kuusisto) et son premier contrebassiste, Eero Munter, mettent bien en valeur les différentes facettes (brio, poésie, finesse d’écriture) de la partition (SACD Bis BIS-1886).
Tout aussi prolifique mais plus jeune et plus connu sous nos latitudes, où sa musique a été popularisée par ses compatriotes Salonen et Saraste, Magnus Lindberg (né en 1958) a été le premier titulaire, entre 2009 et 2012, de la fonction de compositeur en résidence créée par son nouveau directeur musical, Alan Gilbert (né en 1967). Rassemblées sur cet album qui témoigne de leur création à l’Avery Fisher Hall (voir ici, ici et ici), les trois œuvres écrites dans ce cadre montrent que le Finlandais reste fidèle à sa manière désormais un peu systématique de faire alterner agitation frénétique et chorals, mais – influence de l’Amérique comme le dernier Bartók? – dans les 10 minutes d’EXPO (2009), le traitement luxuriant de l’orchestre – on pense par exemple à Debussy, Ravel, Martinů ou Britten – est bien moins aventureux qu’il y a dix ou vingt ans et Al largo (2010), deux fois plus développé, a un parfum plus hollywoodien que nordique... tout en citant brièvement Ma Mère l’Oye et La Nuit transfigurée. Destiné à l’athlétique Yefim Bronfman (né en 1958), le Second Concerto pour piano (2012), inspiré par le Concerto pour la main gauche, succède à un précédent concerto qui s’était placé, quant à lui, dans la descendance du Concerto en sol (voir ici): dans le moule classique en trois mouvements (avec cadence) et bien loin du subtil second degré que Ravel savait conférer à ses allusions ou emprunts, ce sont malheureusement, sous les oripeaux contemporains, les mauvais côtés d’un Grieg, d’un Rachmaninov ou d’un Gershwin qui affleurent dans une compilation de formules empruntées au dernier siècle et demi de l’histoire de la musique, où le décousu le dispute à l’hétéroclite (Dacapo 8.226076).
Soixante-dix ans avant Lindberg, venu en 1981 travailler avec Globokar et Grisey, Leevi Madetoja (1887-1947), après l’enseignement de Sibelius et avant d’aller recueillir à Vienne celui de Fuchs, était lui aussi passé par Paris, afin d’étudier avec d’Indy. Eclipsé par la figure de son maître et compatriote, il laisse trois Symphonies que les chefs de son pays – Panula, Saraste, Segerstam – se sont déjà attachés à défendre au disque (Finlandia). Après un premier album notamment consacré à la Deuxième, contemporaine de la guerre et de l’indépendance finlandaise et dont le début – magique – servait d’intermède, voici une vingtaine d’années, sur France Musique, l’Orchestre philharmonique d’Helsinki et John Storgårds (né en 1963), chef principal depuis 2008, achèvent chez Ondine leur intégrale de ce triptyque. La concision de la Première (1916), en trois mouvements, n’exclut nullement le charme mélodique et la puissance poétique, comme en écho aux deux premières symphonies de Sibelius et avec une discrète coloration nationale. L’idiome reste traditionnel dans la Troisième (1926), qui n’explore pas les voies plus abruptes ouvertes au même moment par l’ultime Septième de Sibelius, mais ce classicisme serein n’est pas uniment lisse – à l’exemple de ces timbales qui concluent à découvert le troisième mouvement. Bien que tout à fait contemporaine, la Suite – la seule menée à bien par le compositeur, qui en avait envisagé deux autres – enchaînant quatre courts extraits du ballet pantomime Okon Fuoko (1927) montre un visage assez différent de Madetoja, au-delà de l’exotisme même du sujet (un marionnettiste japonais), plus riche de couleurs orchestrales et aux harmonies davantage dans l’air du temps (ODE 1211-2). SC
Scandinavie 3: Norvège (Egge/Svendsen)
 
Peut-être encore plus dans l’ombre que les autres pays scandinaves, notre horizon n’allant généralement guère plus loin que quelques tubes de Grieg, la Norvège reste un territoire musical dont l’essentiel reste à découvrir.
A la différence de son maître Fartein Valen, Klaus Egge (1906-1979), n’évolua vers le dodécaphonisme que plus tardivement, dans les années 1960. Mais sa première manière n’en fait en rien un succédané de Grieg, comme permet d’en juger un album qui améliore considérablement la connaissance d’un compositeur dont divers éditeurs (Aurora, Naxos, Simax) avaient publié jusqu’à présent trois de ses cinq Symphonies, deux de ses cinq Concertos, son Quatuor à cordes ainsi que sa musique pour piano. Dense par son contrepoint et raffinée par ses harmonies, la Sonate pour violon et piano (1934), quoique discrètement teintée de folklore, évoque moins un ancrage national que le «pastoralisme» anglais ou l’«impressionisme» français de ce temps, que l’interprétation de Tor Johan Bøen (né en 1971) et Einard Henning Smebye (né en 1950) met bien en valeur. Ils sont rejoints par Johannes Martens (né en 1977) dans le Trio avec piano (1940), précédemment enregistré par le Trio Valen (Lawo Classics), de tonalité générale moins élégiaque et plus vigoureuse. C’est en revanche la première discographique du Duo concertante (1959) pour violon et alto, où Bøen est associé à Bénédicte Royer (née en 1987): plus tardif mais débuté dès 1945, il diffère des deux autres œuvres par sa netteté néoclassique, entre légèreté, profondeur (superbe Adagio molto espressivo) et âpreté: une belle réussite – servie par des musiciens remarquables – dans un genre difficile que Martinů illustra admirablement (et par deux fois) à la même époque (Simax Classics PSC1193).
L’infatigable Neeme Järvi (né en 1937) en est parvenu chez Chandos au troisième volume de la série qu’il consacre avec l’Orchestre philharmonique de Bergen à Johan Svendsen (1840-1911). Pur produit de l’école de Leipzig, où il fut l’élève de Reinecke, ce natif d’Oslo fit l’essentiel de sa carrière à Copenhague, après un passage par Paris à la fin des années 1860, durant lequel il rencontra sa première femme et les deux dernières de ses quatre Rhapsodies norvégiennes furent créées. Relégué dans l’ombre par Grieg, son cadet de trois ans, il demeure plus conventionnel et s’inspire moins explicitement de la musique populaire de son pays: déjà connues au disque, notamment chez le même éditeur sous la baguette de Thomas Dausgaard pour le même éditeur, les deux Symphonies ne réservent pas de grandes surprises, mais la Première (1866), composée à Leipzig, s’inscrit cependant avec finesse et sensibilité dans la tradition de Mendelssohn et Gade. Interprété par Marianne Thorsen (née en 1972), le Concerto pour violon (1870), dédié à F. David, professeur de Svendsen et créateur du Second Concerto de Mendelssohn, et écrit en grande partie à Paris, reste dans le même esprit. Les deux brèves Mélodies islandaises (1874) pour orchestre à cordes sont en revanche beaucoup plus proches de la manière folklorique de Grieg. Le chef estonien, qui dirige avec bonheur l’ensemble du programme, avait donné à l’Orchestre de Paris en janvier 2009 Carnaval à Paris mais c’est ici le Carnaval norvégien des artistes (1874), mêlant joyeusement springar norvégien et chanson napolitaine (CHAN 10766). SC
Scandinavie 4: Suède (Atterberg/Pettersson/Stenhammar)
 
 
Si le mélomane peut encore spontanément associer à la Norvège ne serait-ce qu’un nom, celui de Grieg, tel n’est même pas le cas de la Suède, pourtant riche de personnalités tout à fait remarquables, à commencer par les trois que l’actualité récente met à l’honneur.
Violoncelliste et ingénieur de formation (il exerça jusqu’en 1968 des fonctions au sein de l’office des brevets), Kurt Atterberg (1887-1974), s’il étudia la composition avec Andreas Hallén, fut essentiellement un autodidacte. Il laisse notamment neuf Symphonies (la dernière, comme il se doit, avec solistes et chœur), corpus déjà enregistré par Ari Rasilainen (cpo) mais à l’assaut duquel c’est l’incontournable Neeme Järvi (né en 1937) qui se lance avec l’Orchestre symphonique de Göteborg, dont il est le chefdirigent honoraire après en avoir été le chefdirigent de 1982 à 2004. Du même intérêt que le premier, le suivant propose la Deuxième (1913), dont Stenhammar (cf. infra), lors de la création, tint au pied levé la partie de piano: en trois mouvements (deux seulement, à l’origine), le deuxième mouvement, comme celui de la Symphonie de Franck, tenant à la fois lieu de mouvement lent et de scherzo, elle avance avec brio et entrain, dans un postromantisme radieux et chaleureux. Entre générosité à la Dvorák et solennité façon Elgar, dans une orchestration efficace sans céder à la mode straussienne, ce langage a toutefois pris un coup de vieux trente ans plus tard: la Huitième (1944), fondée, comme la Quatrième, sur des motifs populaires suédois et saluée, lors de sa création à Helsinki, par Sibelius («Merci pour votre symphonie merveilleusement convaincante»), ne s’en révèle pas moins d’une écoute aussi séduisante (SACD CHSA 5133).
Difficile de concevoir un univers plus différent de celui d’Atterberg que celui d’Allan Pettersson (1911-1980). Après une enfance marquée par la pauvreté et un père alcoolique, il fut altiste au sein du Philharmonique de Stockholm, tout en étudiant avec Blomdahl et Olsson, puis, à Paris, après-guerre, avec Leibowitz et Honegger. Frappé à son retour par une polyarthrite, il n’en composa pas moins en à peine trente ans dix-sept Symphonies (la première et la dernière étant restées inachevées), dont cpo a déjà réalisé une intégrale dirigée par plusieurs chefs. Défendu, y compris au disque, par des chefs tels qu’Antal Doráti ou Sergiu Comissiona, il a acquis une haute réputation au sein d’un cercle de connaisseurs principalement anglo-saxons ou germaniques – en témoignent les sites qui lui sont consacrés en Suède, Allemagne ou aux Etats-Unis. L’Orchestre symphonique de Norrköping a entrepris de publier à l’horizon 2018 une intégrale des Symphonies (complétée par trois documentaires) incluant quatre volumes déjà réalisés par Moshe Atzmon (avec le Symphonique de Malmö) et Leif Segerstam entre 1990 et 1997 mais dont les suivants, depuis 2011, ont été confiés à Christian Lindberg (né en 1958), lui-même compositeur (et auteur de versions achevées de la Première et de la Dix-septième) – une initiative tout à fait bienvenue, à en juger par la redoutable Neuvième (1970). D’une durée de 70 minutes (2146 mesures) et d’un seul tenant, dédiée à l’Orchestre symphonique et à Comissiona, qui en assurèrent la création (en plus de 85 minutes), elle fut pourtant écrite à l’hôpital par un compositeur qui, affaibli par une maladie rénale, luttait entre la vie et la mort: cauchemar sombre, grinçant, torturé, lancinant et obsessionnel, mais débordant aussi d’une folle énergie vitale ou ménageant des instants d’apaisement d’autant plus inattendus dans cette protestation démesurée et pourtant tellement humaine, elle évoque parfois Mahler, Nielsen ou Chostakovitch, dans un langage plus ou moins lointainement tonal, mais demeure profondément originale par son défi aux lois de la construction, son orchestration délibérément peu flatteuse et son refus des compromis, offrant une expérience musicale et même extramusicale sans véritable équivalent (SACD BIS-2038).
On retourne en terrain plus familier et policé avec Wilhelm Stenhammar (1871-1927), qu’une brillante carrière de pianiste et de chef (de l’Orchestre de Göteborg entre 1907 et 1922) n’empêcha pas d’écrire deux opéras, deux Symphonies, deux Concertos pour piano mais aussi, sans doute pour partie en raison de sa proximité avec le Quatuor Aulin, sept Quatuors (dont six numérotés). Le Quatuor Stenhammar, constitué en 1995, en donne une intégrale chez Bis, dont les deux premiers volumes sont déjà parus, au moment même où Musica Sveciae réédite les gravures des Quatuors Fresk, Gotland et de Copenhague parues en 33 tours au début des années 1980. Le Troisième (1900) s’ouvre sur une forme sonate, conclut par une fugue chromatique et très développée, avec retour du thème du premier mouvement, et démontre une parfaite connaissance des romantiques (Beethoven, surtout, mais aussi Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Tchaïkovski et Dvorák) pour en réaliser une solide synthèse... à l’heure où Debussy a déjà publié son unique Quatuor et où Ravel s’apprête à écrire le sien. Mais le Quatrième (1909), dédié à Sibelius – qui, quinze ans, plus tard, lui dédia à son tour sa Sixième Symphonie –, fait preuve de davantage d’audace; cela étant, contemporaine du Deuxième de Schönberg et du Premier de Bartók, l’œuvre demeure fortement marquée par le modèle beethovénien (Scherzo) ou par une nostalgie bien brahmsienne (superbe Adagio), tandis que le long finale prend la forme d’un thème (la chanson populaire Et le chevalier parla à la jeune Hillevi) suivi de onze ingénieuses variations, qu’un Reger n’aurait sans doute pas reniées. Ce premier volume est complété par deux extraits de la musique de scène (1919) pour la «comédie romantique» Lodolezzi chante de Hjalmar Bergman: une «Elégie» (tenant lieu d’ouverture) et un «Intermezzo» (pastiche de récitatif et d’air d’opéra du XIXe), nullement anecdotiques (SACD BIS-1659). Changement de cap avec la Sérénade en ut majeur (Cinquième Quatuor) de 1910, qui marque un de ces tendres retours au classicisme qu’affectionnaient Brahms et Reger: le ciel légèrement voilé de la «Ballata», fondée sur la chanson humoristique du chevalier Finn Komfusenfej, de caractère plaisamment archaïsant, s’éclaircit en un tourbillonnant Scherzo puis un Finale en forme de mouvement perpétuel mêlant irrésistiblement fugato et rusticité. Le Sixième (1916) traduit une nouvelle avancée vers quelques harmonies plus novatrices, mais le climat reste essentiellement brahmsien. Ce deuxième volume comprend par ailleurs une première au disque, un Quatuor en fa mineur (1897) de nouveau dans l’orbite de Brahms et Dvorák, composé entre le Deuxième et le Troisième mais que le compositeur, mécontent d’un Finale qu’il songea vingt ans durant à retravailler, ne publia jamais (SACD BIS-1659). SC
La part méconnue de Nino Rota
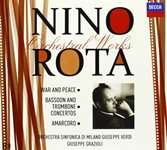
Le deuxième double album que Decca consacre à l’œuvre pour orchestre de Nino Rota (1911-1979) comporte bien sûr de la musique de film (Guerre et paix, Amarcord, Les Nuits de Cabiria) mais, surtout, des pièces destinées au concert. Là réside l’intérêt de cette publication puisqu’elle révèle une part méconnue du compositeur. Parmi les pages les plus intéressantes figurent le Concerto pour trombone (1966), qui rappelle Hindemith, le Concerto pour basson (1974-1975), brillant et limpide, l’ouverture La Foire de Bari (1963), qui ressemble à du Bernstein et à du Gershwin, et qui nécessite pas moins de cinq saxophones et cinq trombones, et L’Ecole de Guida (1959), sorte de courte comédie musicale de 10 minutes pour deux chanteurs. Castel del Monte (1974), pour cor et orchestre, En regardant le Fujiyama, composé en 1976 à l’occasion d’une tournée au Japon, et l’Andante sostenuto, destiné à compléter le Premier Concerto pour cor de Mozart, présentent une importance moindre. A la tête d’un Orchestre symphonique de Milan «Giuseppe Verdi» affûté et convaincant, Giuseppe Grazioli interprète consciencieusement cette musique plaisante mais pas toujours mémorable. La notice de cette nouveauté produite par la branche italienne de Decca comporte une traduction en anglais seulement (481 0394). SF
Wagner en vidéo... et en vrac
 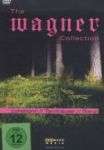
Les opéras de Richard Wagner sont, depuis l’après-guerre et singulièrement à partir des années 1970, une matière de prédilection pour les mises en scène expérimentales. Loin du Regietheater, un coffret économique réunit trois autres visions, bien moins radicales. Réédition de spectacles déjà connus, à commencer par le Lohengrin de Wolfgang Weber (Vienne, 1990) – conventionnel et daté – où la chaleur de la voix de Plácido Domingo et la direction absolument exceptionnelle de Claudio Abbado (Wiener Staatsoper) rayonnent toujours autant. Nikolaus Lehnhoff (Baden-Baden, 2008) livre un Tannhäuser stylisé mais décalé et froid, dans lequel la Bacchanale prend la forme d’un ballet de larves géantes (qui ressemblent plus à des spermatozoïdes) sacrifiant un taureau noir et qui évolue du music-hall au concours de variété, le tout autour d’un escalier massif en forme d’hélice d’ADN. Filmé de manière trop intrusive, le DVD vaut davantage pour la baguette sans complexe de Philippe Jordan (Deutsches Symphonie-Orchester) que par une distribution solide mais sans émotion (Gambill, Nylund, Meier, Trekel). Surtout, le coffret reprend le magistral Rienzi monté au Deutsche Oper par Philipp Stölzl (Berlin, 2010): un spectacle corrosif dominé par un Torsten Kerl déchaîné. Abandonnant le XIVe siècle au profit d’une transcription en forme de «parabole de l’ascension politique d’Hitler», cette mise en scène émeut par sa cohérence – à la fois tragique et pathétique, burlesque et implacable, inquiétante de réalisme. La distribution est digne de louages (notamment l’Adriano de Kate Aldrich). Un «Must» (coffret de six DVD Arthaus Musik 107 527). Un bonheur ne venant jamais seul, Torsten Kerl est à l’affiche d’un autre Rienzi – celui de Jorge Lavelli (Toulouse, 2012) – dans une version vingt minutes plus longue. Dans «un cadre architectural évocateur d’une société industrielle déjà en décadence» et une réalisation vidéo entrecoupée d’images d’archives ou d’actualités (montrant guerres et révolutions réelles, d’Europe ou d’Amérique, d’Afrique ou d’Asie), la scénographie est habile et intelligente, mais se fait moins homogène qu’à Berlin. Et le plateau (avec une distribution convenable) est parfois statique (... malgré la présence d’un vrai cheval). Belle performance, en revanche, des musiciens du Capitole conduits par la baguette experte de Pinchas Steinberg (Opus Arte Blu-ray DVD OA BD7125 D ou DVD OA 1110 D). GdH
La «Purcell Collection» de Voces 8 et Les Inventions

L’ensemble instrumental Les Inventions, fondé en 2005, spécialisé en musique ancienne et baroque, rejoint l’ensemble vocal Voces8, au répertoire plus étendu, pour proposer un florilège d’œuvres sacrées et profanes de Purcell, toutes composées entre 1680 et 1695. L’objectif, c’est de faire montre en un seul programme de la grande diversité du catalogue de Purcell, qui a touché à tous les genres. La formation des membres de Voces8 a commencé dès l’enfance dans des chorales de renom de l’Eglise anglicane, et cette expérience hautement professionnelle est un atout pour la musique raffinée de Purcell, qui composait pour la voix en tenant compte de la sonorité et des rythmes de la langue. Bien mise en valeur par une prise de son ample et claire, l’interprétation, énergique, rythmée et à tout point de vue pleine et correcte, reste un peu extérieure, peut-être, à l’exception de «Bid the Virtues» et «Thou knowest, Lord», extraits respectivement des odes composées pour l’anniversaire et l’enterrement de la Reine Mary en 1694. La belle voix claire de la soprano Emily Dickens, la perfection du chœur et le soin délicat des instrumentistes y contribuent le supplément d’âme nécessaire. Le phrasé particulier de l’air «What power», le célèbre chant du froid de King Arthur, marque aussi sa différence mais c’est ici un peu lourd. Il lui manque l’humour et l’effet glacé et grelottant qui lui donnent son sel. Bien que l’instrumentation soit variée et malgré les volontés interprétatives, le piège d’un programme hétéroclite n’est pas déjoué. Il s’installe une couleur dominante qui donne une certaine uniformité à l’ensemble, reliant les extraits de Didon et Enée et des semi-opéras King Arthur, Dioclesian, et The Tempest à l’ode Hail Bright Cecilia, aux odes pour les anniversaires de la reine Mary et jusques aux Anthems sacrés. Toutefois, l’engagement des interprètes n’est pas à mettre en doute. (Signum Classics SIGCD375). CL
De nouvelles Diabelli? Schiff plutôt que Chodos
 
Ces nouvelles interprétations des Variations Diabelli ne seront pas au goût de tout le monde. Les deux premières sont dues au même interprète – l’inclassable András Schiff (né en 1953) – et figurent sur le même album. L’une est exécuté sur un piano Bechstein de 1921, l’autre sur un pianoforte Franz Brodmann. Si l’esthétique de ces deux instruments pourra rebuter, la comparaison tient ses promesses... et tourne à l’avantage du second («l’instrument préféré de Wilhelm Backhaus et Artur Schnabel et celui dans lequel Schiff retrouve pour sa part un idéal sonore aujourd’hui en partie perdu»), enfermant les Diabelli dans une sonorité trop étouffée, un entre-deux qui fait regretter l’absence d’un piano plus épanoui dans les résonnances. Bien qu’elle oblige le pianiste hongrois à ralentir la cadence (2 minutes de plus qu’avec le Bechstein), la charpente du Hammerflügel apporte, en revanche, une touche de fantaisie espiègle aux Diabelli, un grain de folie qui enrichit l’interprétation implacable et sérieuse de l’artiste hongrois. En complément (ou plutôt en immédiat écho), une Trente-deuxième Sonate (sur Bechstein) et des Bagatelles opus 126 (sur Brodmann) baignés d’évidence et de musicalité (double album ECM New Series 481 0446). A l’inverse, les Diabelli signées par Gabriel Chodos (né en 1939) – au jeu intègre mais aux moyens ordinaires – n’apportent pas grand-chose à la discographie de l’œuvre. Ainsi la Cinquième variation manque-t-elle de mordant alors que la Sixième pèche en virtuosité, la Septième en vélocité, la Huitième en opulence sonore, la Neuvième en inventivité, la Dixième en évanescence... Et quand arrive la stratosphérique Quatorzième, plombée par un tempo immobile d’où rien ne se dégage (ni puissance ni abattement, ni méditation ni rêverie), on comprend que le pianiste américain n’offre qu’une vision sobrement scolaire de l’Opus 120 de Beethoven. A dire vrai seule la Trente-et-unième variation apporte enfin de l’éloquence à ce piano affligé de trop d’à-coups et de beaucoup de temps morts. A mille lieux de la grandeur d’un Pollini (DG), de l’opulence d’un Brendel (Philips) ou du génie d’un Kovacevich (Philips et Onyx). Un disque aux bonnes intentions («it seems to me that the variation form is a metaphor of the life of an individual human being: there is constant change, but the core identity remains the same»), mais au contenu bien inutile (Fleur de son Classics FDS 58017). GdH
Aedam Musicae à la croisée des genres et des arts
 
Aedam Musicae édite deux livres à la croisée des arts pour l’un et des genres pour l’autre. Ouvrage collectif dirigé par Sébastien Arfouilloux et complémentaire de la version remaniée de la thèse de ce dernier chez Fayard (Que la nuit tombe sur l’orchestre), Le Silence d’or des surréalistes aborde le rapport mêlé d’attraction et de répulsion que les surréalistes entretiennent avec la musique. Comme Henri Béhar l’écrit pertinemment dans la préface, la musique surréaliste se résume à une «peau de chagrin», André Breton, théoricien de ce mouvement, privilégiant la peinture et la littérature. Cette contribution scientifique permet d’en savoir plus (312 pages, 22 euros). Dans La Techno minimale, rédigé d’une plume fluide et précise, Mathieu Guillien s’intéresse quant à lui à la techno, qu’il étudie en prenant comme point de départ le minimalisme dont il retient quatre des principaux représentants, Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley et La Monte Young. Une contribution inattendue qui prouve que la musicologie, malgré le manque de recul historique, s’intéresse quand même à ce genre pas toujours bien perçu (272 pages, 22 euros). SF
Dans les archives vidéo d’ICA: Tito Gobbi et Michael Tilson Thomas
 
ICA Classics poursuit son exhumation d’archives vidéo en sommeil. Michael Tilson Thomas (né en 1944) – brun et sans lunettes – ressemble à un gamin face au Symphonique de Boston en 1970. Le geste est néanmoins très sûr et le jeune chef fait montre d’une grande cohérence de style, établissant d’intéressantes connexions entre les compositeurs. Malgré une image très vieillie et un son compact, le génie de Charles Ives transparaît ainsi pleinement de la direction attentive et convaincue du chef américain, qui garde toujours le contrôle face aux Three Places in New England. La Quatrième Symphonie de Sibelius est interprétée avec rythme et pudeur – avec parfois trop de lumière et de légèreté aussi. Enfin, un décousu «Lever du jour et voyage de Siegfried sur le Rhin» (tiré du Crépuscule des dieux de Wagner) dévoile un MTT plus sonore, dont une demi-heure d’interviews (filmées en 1970 et 2013 sans sous-titres) complètent habilement le portrait (ICAD 5111). Un hommage est également rendu à Tito Gobbi (1913-1984), l’un des plus exceptionnels barytons de l’histoire du chant – Scarpia devant l’Eternel. Les extraits de Tosca retenus ici ne sont pas ceux – légendaires – avec Maria Callas, mais proviennent d’une réalisation cinématographiée de 1965 dans les studios de la BBC – terriblement démodée. Face à la Floria anonyme de Marie Collier, le génie interprétatif du chanteur italien transpire de partout: le regard, l’attitude et bien sûr la voix. Des extraits de Gianni Schicchi et Rigoletto (avec Renata Scotto) montrent également Gobbi au sommet de son art – dans des réalisations TV (1966) malheureusement hors d’âge. A écouter les yeux fermés (ICAD 5118). GdH
Liszt sur le divan

Aux éditions Le Passeur, dans la collection «Sursum corda» dirigée par Jean-Yves Clément, Philippe André consacre un essai aux ultimes pièces pour piano de Liszt, qui forment un corpus insondable et isolé. L’auteur les examine sous un angle psychanalytique en évoquant le contexte de la conception de chacune d’elles et en se reposant sur des éléments biographiques, comme la correspondance et des témoignages. Il examine également la nature des relations que le musicien entretien avec son entourage, notamment Wagner. Nuages gris, le dernier pèlerinage de Franz Liszt permet de mieux comprendre ces pièces et de cerner plus intimement la personnalité du compositeur. Malgré une syntaxe parfois relâchée et un recours fréquent à des termes abscons («phusis maternel»), le texte se lit sans trop se prendre la tête entre les mains. Chacun jugera de la pertinence de cette analyse mais elle a le mérite d’exister (168 pages, 16,90 euros). SF
Le legs pianistique de Menahem Pressler
 
Parvenu à l’automne de sa vie d’artiste, Menahem Pressler (né en 1923) fait l’objet d’un engouement – sinon d’un culte – ... au plus grand plaisir des discophiles. En témoignent cette nouveauté (un enregistrement de mai 2013) et cette réédition (des prises de novembre 1965 et juin 1966), qui apportent des bonheurs divers. Plutôt fascinante, la première n’est pas à mettre dans toutes les oreilles... Dans l’immensité de la Sonate en sol majeur de Schubert (trois quarts d’heure de «danse libre, qui fait aussi référence au chant, à l’art du lied»), la chaleur du toucher et le calme de la construction s’adaptent autant à des moyens diminués (un Andante laborieux) qu’à une conception sereine et optimiste du message de l’œuvre, s’achevant sur un Allegretto presque maniéré: le magnétisme n’opère toutefois pas autant que chez Richter, Brendel, Lupu ou Sokolov. Regorgeant d’humanité, le Rondo en la mineur de Mozart évoque parfois le style tardif d’Arrau. Les Bagatelles opus 126 de Beethoven souffrent, en revanche, d’un traitement qui les ramollit outre-mesure (La dolce volta LDV 12). La seconde parution réédite des enregistrements réalisés un demi-siècle auparavant. Interprétations sensibles et subtiles, mais sans exceptionnelle valeur ajoutée... ne serait-ce qu’en raison de la tiédeur de l’accompagnement (celui de Jean-Marie Auberson – avec l’Orchestre du Festival de Vienne dans le Concerto de Grieg – plutôt que de Hans Swarowsky – avec l’Orchestre de l’Opéra de Vienne dans le Premier Concerto de Mendelssohn) et d’une prise de son assez épouvantable. La hauteur de vue de Pressler n’en apporte pas moins aux longueurs mendelssohniennes une émotion d’une touchante sincérité (Doron DRC 4020). GdH
Les «Impressions espagnoles» d’une pianiste allemande

Par ailleurs diplômée en physique, Carolin Danner (née en 1981) consacre son premier disque à des pages de compositeurs espagnols ou inspirées par la péninsule ibérique. Dans ce programme, intitulé «Impressions espagnoles», qui comporte essentiellement des pièces connues, la pianiste trouve matière à exprimer sa sensibilité et à démontrer sa maîtrise de l’instrument. Elle adopte le style qui convient, développe un toucher net et articule rigoureusement, ce qui profite à la Fantaisie bétique de Falla, à «Andaluza» des Danses espagnoles de Granados, élancée, fiévreuse, poétique, ainsi qu’à «Asturias» de la Suite espagnole d’Albéniz, d’un lyrisme brûlant. «La Sérénade interrompue» et «La Soirée dans Grenade» de Debussy, de même que la Pavane pour une infante défunte de Ravel, séduisent moins – de toute façon, la concurrence est rude dans ces pages. Le disque comporte une œuvre plus récente, Pequenos Nocturnos (1997) de José Zárate (née en 1972): musique méditative et suggestive d’assez belle facture que la jeune femme interprète avec profondeur et simplicité. Quatre Sonates (K. 132, 487, 1 et 141) de Scarlatti complètent le programme. Peut-être à cause de l’acoustique de la Steinway Haus de Munich, la sonorité s’avère assez sèche mais cela convient à cette musique. Réalisée avec sérieux, cette carte de visite ne présente toutefois pas suffisamment d’attraits pour donner envie d’être réécoutée (Animato ACD6141). SF
La rédaction de ConcertoNet
|