|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de janvier
01/15/2014
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Théories de la composition musicale au XXe Théories de la composition musicale au XXe
 Poulenc: créations et inédits Poulenc: créations et inédits
 Airs pour Caffarelli par Franco Fagioli Airs pour Caffarelli par Franco Fagioli
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Gerd Schaller dirige Suppé Gerd Schaller dirige Suppé
 Airs pour Farinelli par Philippe Jaroussky Airs pour Farinelli par Philippe Jaroussky
  Oui! Oui!
Edward Gardner dirige Szymanowski
Stanislaw Skrowaczewski dirige à Sarrebruck (1991-2011)
Musique de chambre de Lindberg
Le Quatuor Pacifica interprète Chostakovitch et Schnittke
Max Emanuel Cencic chante des airs d’opéras vénitiens
«Concertos Parlando» avec Philippe Graffin
Les Noces de Figaro à Paris (2006)
La Petite Renarde rusée à Florence (2009)
Documentaire Sergiu Celibidache. Agitateur et philosophe
La Somnambule à La Fenice (2012)
Neeme Järvi dirige La Belle au bois dormant
Friedrich Gulda interprète Mozart
Antonio Pappano dirige Britten
Musique de chambre de Fauré autour d’Eric Le Sage
Hans Rosbaud dirige Debussy et Sibelius
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Marek Janowski dirige Siegfried
Don Giovanni à Madrid (2005)
Les Quatuors Arranoa et Debussy
Andris Nelsons dirige Dvorák
Neeme Järvi dirige Le Lac des cygnes
Lucio Dosso interprète Scarlatti
Thibault Cauvin interprète Scarlatti
Pierné par Sabine Revault d’Allonnes et Thomas Dolié
Pas la peine
Neal Stulberg dirige Zeisl
Lavinia Meijer interprète Einaudi
Marin Alsop dirige Prokofiev
Voix et désir. Eros et opéra de Michel Schneider
Patrick Gallois dirige Cimarosa
Robert Spano dirige Sibelius
Christian Pollack dirige J. Strauss père
Guennadi Rojdestvenski dirige Tchaïkovski et Janácek
Hélas!
Christophe Giovaninetti et Izumiko Aoyagi
John Barbirolli dirige Haydn et Berlioz
L’entretien du mois

Philippe Graffin
Le match du mois
  
Contre-ténors: Cencic, Fagioli et Jaroussky
En bref
La Petite Renarde rusée: émotion, humour et... Ozawa
Inédits de Barbirolli, Rojdestvenski et Rosbaud chez ICA
War Requiem: après Jansons et McCreesh, Pappano
Celibidache, un musicien à nul autre pareil
Nelsons en héros dans Dvorák
Neeme Järvi, maître de ballet dans Tchaïkovski
Marin Alsop et le retour de L’Enfant prodigue
Jessica Pratt, la prochaine Stupenda?
Le Mozart jubilatoire de Gulda
Scarlatti à la guitare: deux approches très différentes
Fauré servi par Eric Le Sage et ses amis
Mozart dans la collection «Essential Opera» d’Opus Arte
Cimarosa trop banal
Pierné mélodiste
Meijer que de la musique d’ambiance
Pas de Nouvel An pour Johann Strauss (père)
Sibelius à Atlanta: rien de nouveau sous le soleil
4 + 4 = Octuorissimo
L’opéra sur le divan de Michel Schneider
Décevantes sonates françaises pour violon et piano
La Petite Renarde rusée: émotion, humour et... Ozawa

Laurent Pelly a mis en scène La Petite Renarde rusée de Janácek au Mai musical florentin en 2009: sans surprise, il y a de l’émotion, de l’humour et de jolies images grâce au décor bien pensé de Barbara de Limbourg et aux costumes, certains amusants, du metteur en scène. Au sein d’une remarquable distribution se détachent le Garde-chasse de Quinn Kelsey et la Renarde d’Isabel Bayrakdarian – le public les applaudit chaleureusement. Seiji Ozawa dirige merveilleusement un orchestre vigilant et subtil. Le voir dans la fosse puis sur scène lors des saluts est touchant, compte tenu des aléas de santé qui raréfient depuis lors ses apparitions (Arthaus 101697 ou Blu-ray 108094). SF
Inédits de Barbirolli, Rojdestvenski et Rosbaud chez ICA

 
Fidèle à sa politique d’édition d’enregistrements radio à partir des bandes originales, ICA Classics offre trois premières parutions au disque, toutes prometteuses car présentant des chefs à la forte personnalité. L’une des qualités de John Barbirolli (1899-1970) était la générosité, qui caractérise également le minutage (plus d’une heure vingt) d’un album associant deux œuvres qu’il avait déjà précédemment enregistrées avec son Orchestre Hallé (Dutton, The Barbirolli Society): la Quatre-vingt-troisième Symphonie «La Poule» de Haydn, de facture assez traditionnelle, impeccablement stylée mais au quant-à-soi désormais un peu daté, et la Symphonie fantastique de Berlioz, également captée en studio en février 1969, qui, même si elle permet d’entendre le chef anglais exprimer par des grognements sa passion coutumière, pâtit d’un assoupissement généralisé (avec une durée totale de plus de 55 minutes) et de choix interprétatifs contestables, pour ne pas dire rédhibitoires, couronnés, dans le «Songe d’une nuit de sabbat» par des cloches qu’un piano vient fâcheusement doubler (ICAC 5105). Barbirolli était pour l’occasion à la tête de l’Orchestre de la Südwestfunk de Baden-Baden – au demeurant pas exceptionnel – et dans le studio portant le nom de celui qui en avait été le directeur musical de 1948 à 1962, Hans Rosbaud (1895-1962), dont ICA publie par ailleurs des enregistrements d’œuvres de Debussy et Sibelius avec l’Orchestre symphonique (et le Chœur) de la Radio de Cologne. Le mozartien du festival d’Aix est passé à la postérité, mais c’est un autre aspect de sa personnalité artistique, le défenseur de la musique de son temps, que rappellent ces bandes réalisées en studio entre 1952 et 1955. Mais s’il fut notamment l’un des plus fidèles interprètes de la Seconde Ecole de Vienne et, après-guerre, l’une des figures de Donaueschingen et Darmstadt, le chef allemand aborde ici des compositeurs auxquels on a moins l’habitude de l’associer. L’un des modèles de direction d’orchestre pour le jeune Boulez, Rosbaud se montre plus vibrant et expressif que précis et conceptuel dans les Nocturnes et, plus encore, dans Jeux, dont la dimension chorégraphique et même dramatique est rarement autant mise en valeur. Nonobstant les condamnations aussi célèbres que définitives (et imbéciles) d’Adorno et Leibowitz à l’égard de Sibelius, l’intérêt de Rosbaud pour le compositeur finlandais fut aussi précoce que constant, déjà illustré par un très bel album avec le Philharmonique de Berlin, réalisé en novembre 1954 et mars 1957 pour Deutsche Grammophon: cette Sixième Symphonie d’avril 1952 à Cologne en constituera désormais un complément indispensable, car elle se révèle tout aussi formidable d’intensité et d’empathie avec l’univers sibélien (ICAC 5109). D’une tout autre génération, Guennadi Rojdestvenski (né en 1931), fut notamment chief conductor de l’Orchestre symphonique de la BBC de 1978 à 1981, succédant à Rudolf Kempe (qui n’exerça ces fonctions que durant les cinq derniers mois de sa vie) et précédant John Pritchard: un album Holst et Britten publié en 2012, lui aussi chez ICA et tiré des archives de la radio britannique, témoignait déjà de cette collaboration. En septembre 1978 durant le festival de Flandre, la Cinquième Symphonie de Tchaïkovski bénéficie d’un orchestre gonflé à bloc (quoique pas irréprochable) mais souffre d’un document d’assez piètre qualité pour l’époque (souffle important, micros privilégiant excessivement certains pupitres, telles les trompettes) ainsi que d’un lieu à l’écho incommodant (la cathédrale de Malines). Dommage, car Rojdestvenski, rapide, tranchant et sans sentimentalisme, loin de la lenteur exploratrice qui est souvent sa marque distinctive, se situe avec bonheur dans la lignée de ses compatriotes Mravinski et Svetlanov. Trois ans plus tard aux Proms, Tarass Boulba de Janácek ne se différencie ni par ses qualités – énergie, sens épique – ni par ses défauts – réverbération (due cette fois-ci au Royal Albert Hall) et mise en place perfectible (ICAC 5116). SC
War Requiem: après Jansons et McCreesh, Pappano

Le centenaire Britten a suscité un renouveau d’intérêt, en particulier pour son impressionnant War Requiem aux forces et à la charge émotionnelle inégalées dans son œuvre, sans doute dues aux circonstances dramatiques de sa composition et à aux convictions profondément pacifistes de son auteur. Ecrit pour la cérémonie de consécration de la nouvelle cathédrale de Coventry, dressée à côté des ruines tragiques de l’ancienne détruite lors d’un bombardement cataclysmique qui rasa la ville en 1940, c’est un cri de souffrance et de révolte et un profond appel à l’apaisement qui confrontent le texte liturgique latin aux paroles terribles s’élevant des tranchées du poète William Owen tombé à la guerre en 1918. Après Mariss Jansons et Paul McCreesh au printemps, Antonio Pappano à la tête du Chœur mixte, du Chœur d’enfants et de l’Orchestre de l’Académie nationale de Sainte Cécile de Rome réunit en juin trois solistes de renom: Anna Netrebko, Ian Bostridge et Thomas Hampson. Plus opératique que la version saisissante, de Jansons qui atteint le parfait équilibre entre drame et spiritualité, plus impétueuse que le raffinement limpide et la justesse des sentiments de celle de McCreesh, sa direction vive marque les rythmes et les résonances martiales autant par le relief donné au petit ensemble au premier plan que dans l’ampleur du grand orchestre au deuxième. Sa conception appuie le caractère verdien du chœur, dont il obtient une plénitude féroce et des bruissements d’effroi à la limite de l’audible comme il obtient du chœur d’enfants au troisième plan la lumineuse distance céleste requise malgré des alti opaques. Le ténor et le baryton au premier plan, le plan de la fraternité et de la souffrance humaine, servent correctement les textes d’Owen mais la fine voix poétique de Bostridge s’altère lors de voyelles ouvertes et Hampson, qui manque souvent de substance, semble peiner à retrouver le phrasé particulier des lignes vocales de Britten. La voix magnifique de Netrebko plaide en sa faveur malgré une interprétation opératique et charnelle du texte liturgique. Les trois sont au meilleur de leur forme lors du «Libera me» final opposé au beau «Strange Meeting» d’Owen. In fine, les deux textes se mêlent intimement, les voix, les chœurs et l’orchestre au diapason d’un apaisement bouleversant mais serein (Warner Classics 50999 6 15448 26). CL
Celibidache, un musicien à nul autre pareil
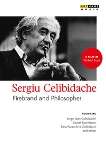
Sergiu Celibidache. Agitateur et philosophe, documentaire de Norbert Busè, retrace le parcours du chef roumain (1912-1996): à l’aide de nombreuses images d’archives, il évoque sa jeunesse, insiste sur ses débuts fulgurants à l’Orchestre philharmonique de Berlin, qui lui a préféré Karajan pour succéder à Furtwängler (la plus grande déception de sa vie), rappelle son séjour en Italie et insiste sur son mandat, le plus significatif sans doute de sa carrière, à Munich. Le film montre en outre qu’il a longtemps enseigné, non seulement la direction d’orchestre mais aussi son approche de la musique – la fameuse «phénoménologie». Les témoignages de Daniel Barenboim ainsi que de la sœur du maestro et de son fils apportent un éclairage bienvenu sur la personnalité de ce musicien généreux, intransigeant et épris de spiritualité. En bonus, l’Ouverture d’Egmont de Beethoven à Berlin témoigne de la «force animale» qui animait Sergiu Celibidache durant sa jeunesse. Un film utile pour mieux connaître ce chef hors norme mais trop court puisqu’il évoque à peine son répertoire de prédilection et qu’il passe rapidement sur sa carrière itinérante entre l’Italie et le chapitre munichois de son existence – rappelons par exemple qu’il a été premier chef invité de l’Orchestre national de France de 1973 à 1975 (Arthaus 101661). SF
Andris Nelsons en héros dans Dvorák

On ne présente plus Andris Nelsons qui, à tout juste 35 ans, est depuis quelques années déjà l’un des chefs d’orchestre les plus demandés à travers la planète. Bien qu’ayant, comme son aîné (sic) Sir Simon Rattle, planté sa tente à Birmingham, il ne néglige pas pour autant les multiples invitations que lui font les plus prestigieuses phalanges comme, pour le présent disque, le bel Orchestre de la Radio bavaroise dans un programme tout entier consacré à Dvorák avec, au menu, deux œuvres enregistrées en concert respectivement en décembre 2010 et avril 2012. Excellente idée que d’associer à la célébrissime Neuvième Symphonie «Du nouveau monde» (1893) le très rare Chant du héros (1897), poème symphonique d’une formidable virtuosité. La symphonie bénéficie d’un orchestre absolument irréprochable qui répond au doigt et à l’œil d’un chef non avare de quelques effets superflus. Si le premier mouvement, dans lequel Nelsons effectue la reprise, s’avère d’emblée plus que convaincant – quelle fluidité chez les cordes! –, on sera un peu plus sceptique à l’égard du deuxième mouvement, assez artificiel dans l’émotion en dépit d’un cor anglais idéal, et surtout dans le Scherzo, pris trop rapidement: la démonstration orchestrale finit par l’emporter sur le discours musical. Le célèbre Allegro con fuoco conclut néanmoins de la plus belle manière ce qui a dû être un superbe concert mais qui, à nos yeux et au sein d’une discographie pléthorique, cède le pas devant les références plus anciennes signées notamment par Reiner, Kubelík, Ancerl ou Fricsay. L’intérêt majeur de ce disque réside sans nul doute dans une interprétation de haut vol du Chant du héros, qui mériterait de figurer parmi les chevaux de bataille de tout grand orchestre symphonique. Les accents que l’on peut entendre habituellement chez Dvorák, que ce soit dans ses symphonies ou, par exemple, dans son ouverture Carnaval, se retrouvent ici grâce à des bois et des cuivres absolument enthousiasmants. Aucune difficulté pour le jeune chef letton à surclasser les pourtant bien belles gravures données par Antoni Wit (Naxos) et Neeme Järvi (Chandos). Un excellent disque donc, mais surtout pour son œuvre la plus méconnue (BR Klassik 900116). SG
Neeme Järvi, maître de ballet dans Tchaïkovski
 
L’infatigable et jamais routinier Neeme Järvi (né en 1937) dirige le Philharmonique de Bergen dans deux partitions de Tchaïkovski, leur apportant une chaleur que l’arrivée de l’hiver rend encore plus séduisante... La participation du violoniste canadien James Ehnes – marginale mais incontestablement épatante (comme dans l’«Entracte» du deuxième acte de La Belle au bois dormant, où l’on se délecte du toucher de velours du soliste canadien, ou dans la virtuosité aristocratique de la «Danse russe» du troisième acte du Lac des cygnes, qu’on a rarement entendu sonner aussi impeccablement) – est le signe d’un luxe et d’un soin tout particuliers. Si les autres interventions individuelles sont de qualité (à commencer par celles du violoncelliste américain Robert deMaine et du harpiste norvégien Johannes Wik), c’est bien la direction de Neeme Järvi qui assure la réussite de ces deux albums qui bénéficient du confort sonore d’une prise de son SACD. La Belle au bois dormant brille plus spécialement sous l’éclairage en technicolor qu’allume la baguette du chef estonien. Manquant d’une dose de fébrilité et d’angoisse pour conquérir pleinement, le Lac des cygnes s’empâte par instants dans ses plumes... conservant toutefois une nervosité propre à dessiner de belles couleurs vif-argent. En maître de la danse, Neeme Järvi tient les lignes, tend les cordes, polit les cuivres, maîtrise les émotions, n’oubliant jamais d’accélérer quand le discours émotionnel le requiert et de ralentir la cadence avec la force tranquille des vieux routiers de la fosse. Du grand art… qui donne envie d’entendre Casse-Noisette (deux doubles albums SACD hybrides Chandos CHSA 5113(2) [La Belle] et 5124(2) [Le Lac]). GdH
Marin Alsop et le retour de L’Enfant prodigue

Après la Cinquième Symphonie, Marin Alsop et son Orchestre symphonique de l’Etat de São Paulo, dont elle est regente titular depuis 2012, en viennent à la Quatrième (1930) de Prokofiev. Peu connue et peu souvent à l’affiche des concerts, bien qu’existant en deux versions, suite à la révision assez substantielle opérée en 1947 par le compositeur (et choisie par les interprètes de cet album), cette symphonie, écrite à la demande de Koussevitzky pour le cinquantième anniversaire de son Symphonique de Boston, est fondée sur L’Enfant prodigue (1929), non moins rare ballet de Kochno (livet), Balanchine (chorégraphie) et Rouault (décors et costumes), commandé par Diaghilev pour ses Ballets russes, qui complète opportunément cette publication au minutage généreux, dont on trouvera par ailleurs dans nos colonnes un compte rendu en anglais. Malgré la battue ferme et robuste, dynamique et narrative de la chef américaine, à la tête d’une solide formation, l’intérêt n’est pas toujours soutenu, car ce n’est pas ici le meilleur de Prokofiev, que ce soit en symphonie ou en ballet (Naxos 8.573186 ou Blu-ray Audio NBD0038). SC
Jessica Pratt, la prochaine Stupenda?

Jessica Pratt est-elle la nouvelle Sutherland? L’avenir le confirmera mais le formidable Ciro in Babilonia, paru récemment, et cette sympathique Somnambule captée en 2012 à La Fenice incitent à le croire. Le reste de la distribution ne se hisse pas au niveau de la belle et talentueuse soprano mais Shalva Mukeria (Elvino) s’impose en fin styliste et en technicien chevronné. La mise en scène de Bepi Morassi transpose judicieusement l’action dans une station de sports d’hiver bon chic bon genre de l’entre-deux-guerres. Grâce au maestro Gabriele Ferro, la musique progresse à vive allure et dans la bonne direction. Cette production bien ficelée permet de passer un agréable moment (C Major DVD 713908 ou Blu-ray 714004). SF
Le Mozart jubilatoire de Gulda

L’ambiance est décontractée à ce concert de Friedrich Gulda (1930-2000) à la Philharmonie de Munich en 1986: les musiciens tombent la veste – l’un d’eux retrousse même ses manches – et le public y assiste en tenue de tous les jours. Le pianiste dirige l’Orchestre philharmonique de Munich debout, en passant parfois la langue, s’installe ensuite au piano puis se relève pour conduire ses troupes. En voilà un qui ne faisait décidément rien comme les autres. Le Vingtième Concerto – Gulda apparait vêtu d’un pull noir – et le Vingt-sixième – Gulda revient en blanc – procurent du plaisir: difficile de résister à tant de vitalité et d’inventivité (Arthaus 101 673). SF
Scarlatti à la guitare: deux approches très différentes
 
Parmi les nombreux (pas si mauvais) traitements infligés aux Sonates de Scarlatti, leur transcription pour guitare a attiré de longue date les plus grands instrumentistes et apparaît d’autant plus appropriée que certaines d’entre elles, du fait des séjours ibériques du compositeur, possèdent un parfum indéniablement hispanisant. En voici vingt-et-une, souvent très célèbres (et quelquefois transposées), au fil des albums récemment publiés par deux guitaristes. C’est ici le quatrième disque de Lucio Dosso, vainqueur du premier concours Andrés Segovia de l’Escorial (1989): il a choisi douze sonates, dont dix transcrites (et parfois transposées) par ses soins, les deux autres respectivement par Barrueco et Segovia. Le résultat est assez déroutant, moins par l’omission systématique de la seconde reprise que par le tempo, souvent trop lent et parfois trop précautionneux, et, surtout, par le style, très personnel, volontiers archaïsant, prenant des libertés pas toujours opportunes avec l’original. Cela étant, malgré la prise de son, à la fois excessivement réverbérée et beaucoup trop proche de l’instrument, le bruit de l’instrument devenant franchement gênant, la souplesse de phrasé et la fantaisie de l’interprète peuvent néanmoins inciter l’auditeur à prêter une oreille neuve à cette musique (Bongiovanni GB 5176-2). Si son aîné se pose volontiers en poète, le titre du septième album de Thibault Cauvin (né en 1984), «Danse avec Scarlatti», annonce clairement la couleur: sans surprise, les pages vives sont largement majoritaires, mais le merveilleux cantabile scarlattien trouve néanmoins à s’exprimer (K. 208, K. 213). Lui aussi couronnée par le premier prix d’un concours portant le nom de Segovia, celui de Linares (2004), le jeune Français a retenu quatorze sonates, le(s) auteur(s) des transcriptions n’étant malheureusement pas précisés. Cinq d’entre elles sont également jouées par Dosso, la comparaison tournant à l’avantage de Cauvin, grâce à une prise de son plus mate, à une approche plus rapide et affirmative ainsi qu’au respect intégral des reprises. Revers de la médaille, toutefois, derrière cette séduction plus immédiate, l’esprit est moins inventif et le jeu, sans être certes métronomique, plus rigide (Vogue/Sony 88883725222). SC
Fauré servi par Eric Le Sage et ses amis

L’intégrale de la musique de chambre avec piano de Fauré par Eric Le Sage s’enrichit d’un quatrième volume qui comporte assez étonnamment des pièces pour piano à quatre mains: Dolly et Masques et bergamasques, bien sûr, mais aussi les rares et amusants Souvenirs de Bayreuth (coécrits avec Messager), réminiscences de pages célèbres de Wagner, que cet excellent pianiste interprète avec le non moins remarquable Alexandre Tharaud. L’entreprise réunit depuis le début la crème des musiciens français, comme, pour la première fois, Emmanuel Pahud (Fantaisie, Morceau de concours, Sicilienne), François Salque (Après un rêve, Sicilienne, de nouveau, mais dans la version pour violoncelle) ainsi que deux membres du Quatuor Ebène, Pierre Colombet et Raphaël Merlin, pour un Trio qui accuse par moments des passages un peu trop modérés et pas toujours pleinement habités – la version pour clarinette figure dans le premier volume. Malgré ces réserves minimes, ce disque confirme la haute tenue de cette intégrale qui, dans la plupart des œuvres, atteint la perfection. Le cinquième – et probablement dernier – volume, qui sortira bientôt, contiendra logiquement les Sonates pour violon (Alpha 603). SF
Mozart dans la collection «Essential Opera» d’Opus Arte
 
Dans son «Essential Opera Collection» (voir par ailleurs ici), Opus Arte a retenu deux des ouvrages formant la «trilogie Da Ponte» de Mozart. Pour Les Noces de Figaro, l’éditeur a choisi l’Opéra national de Paris, mais plutôt que de jouer la sécurité avec la production légendaire de Strehler, il a préféré celle, autrement plus iconoclaste et controversée, de Christoph Marthaler, créée à Salzbourg en 2001, présentée à Garnier en 2006 – un des plus beaux scandales de l’ère Mortier – et reprise à Nanterre en 2008. Tant bien que mal, les caméras de Thomas Grimm s’efforcent de saisir l’humour décalé et dérisoire du metteur en scène suisse, les chorégraphies loufoques de Thomas Stache, le bureau de mariage, le fauteuil électrique et les costumes contemporains d’Anna Viebrock mais aussi le sarcastique et omniprésent «récitativiste» (Jürg Kienberger) avec ses instruments inattendus. Si le théâtre a conservé toute sa fraîcheur décapante, la musique est hélas moins stimulante: la direction de Sylvain Cambreling tend trop souvent à la lenteur et à la raideur, tandis que la distribution vocale, si elle ne déçoit pas franchement, ne suscite pas non plus l’enthousiasme, hormis le comte souverain de Peter Mattei, le Chérubin plus vrai que nature de Christine Schäfer et, à un moindre degré, le Figaro de Lorenzo Regazzo (OA MO 6004 D). Egalement capté en public (en octobre 2005), c’est du Teatro Real que provient Don Giovanni. Lluis Pasqual y procède dans même esprit que Marthaler – transposer pour mieux parler au public actuel – mais s’il affirme avoir souhaité conserver une certaine distance par rapport à notre époque, le choix de l’Espagne franquiste des années 1940 n’en demeure pas moins audacieux à Madrid, où toutes les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Sous les caméras impeccablement réglées par Robin Lough, la reconstitution est luxueusement fignolée, depuis les personnages et nombreux figurants richement habillés par Franca Squarciapino jusqu’au décor (tournant), volontiers imposant, d’Ezio Frigerio, complété par des automobiles grandeur nature et bicyclettes. Dans ce cadre somme toute assez oppressant, Don Giovanni est bien ce grand seigneur méchant homme, ce «gentilhomme andalou» prompt à jouer du couteau mais sachant aussi, maître de l’illusion dans une sorte de parc d’attractions (manège, autos tamponneuses) ou dans un bal costumé XVIIIe, faire rêver ses proies. Peu de «critique sociale et politique», par conséquent, de l’aveu même du metteur en scène catalan, même si la dernière minute du second acte se déroule sur fond d’actualités cinématographiques d’époque célébrant l’Eglise, avant qu’un Don Giovanni espiègle ne vienne donner lui-même le clap final. Ayant déjà endossé le rôle-titre en 1999 à l’Opéra de Vienne sous la direction de Muti (Arthaus), Carlos Alvarez, plus terne, antipathique et sinistre que flamboyant, semble ménager sa voix. A ses côtés, Lorenzo Regazzo, qui était Masetto à Vienne, a pris du galon en Leporello, toujours de bon aloi. María Bayo (Anna), Sonia Ganassi (Elvira) et José Bros (Ottavio) se fourvoient stylistiquement, tentent parfois de passer en force et connaissent des fortunes vocales diverses, alors que le duo des paysans (José Antonio López et María José Moreno) est satisfaisant. Il faut en revanche déplorer la direction continûment prosaïque, sèche et alambiquée, encombrée de tics baroques, de Víctor Pablo Pérez (OA MO 6003 D). Outre un synopsis illustré, chacun de ces doubles DVD est complété par respectivement 60 minutes et 28 minutes d’entretiens avec le metteur en scène, le directeur musical et les chanteurs, entrecoupés de (longs) extraits du spectacle et présentés, pour Les Noces, sous la forme d’un documentaire de Reiner E. Moritz, Un jour de véritable folie. SC
Cimarosa trop banal

Célèbre auteur d’opéras (parmi les soixante-cinq composés, on connaît évidemment son fameux Mariage secret), Domenico Cimarosa (1749-1801) a su développer un style divertissant entre tous qui a fait l’admiration de toute l’Europe, à commencer par Stendhal, qui lui a d’ailleurs consacré une belle biographie. Le présent disque est le troisième que Naxos consacre à ses ouvertures d’opéras après un premier disque réalisé par le Nicolaus Estherázy Sinfonia sous la baguette d’Alessandro Amoretti et un deuxième interprété par le Toronto Chamber Orchestra sous la baguette de Kevin Mallon. Patrick Gallois et le Sinfonia Jyväskylä, dont il a été le chef principal de 2003 à 2012, nous livrent donc ici neuf nouvelles ouvertures, enregistrées en juin 2011, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles suscitent une assez grande indifférence. Tout en étant plaisant à l’oreille, le style est toujours le même: des cordes sautillantes, une assez grande importance donnée aux bois, et tout particulièrement à la clarinette (que ce soit dans l’ouverture d’Artemisia, regina di Caria ou, surtout, dans celle d’I nemici generosi), des échanges entre pupitres assez convenus, des cors à qui l’on confie des notes tenues sans grand éclat... Les interprètes ne sont nullement en cause; bien au contraire, ils y croient et jouent ces pièces avec un entrain indubitable. Pour autant, le mélomane trouvera là un objet de curiosité qui s’écoute avec distraction et nonchalance: rien d’essentiel bien évidemment (8.572734). SG
Pierné mélodiste

Pour son huitième album monographique consacré à Gabriel Pierné (1863-1937), Timpani, après notamment sa passionnante musique pour piano et son chef-d’œuvre chorégraphique Cydalise et le chèvre-pied, propose une sélection de ses mélodies. Tirées pour la plupart d’un recueil de vingt paru en 1890 chez Leduc mais sans doute écrites pour la plupart entre 1879 et 1885, elle révèlent un choix d’auteurs passablement éclectique – Gautier, Hugo, Musset, puis les contemporains Coppée, Mendès, Richepin, Silvestre et Willy. La musique, sacrifiant parfois au pastiche archaïsant (Chanson de berger, Villanelle, Les Deux Roses), est toujours impeccablement écrite et souvent réussie (Les Filles de Cadix soutient la comparaison avec la version réalisée peu après par Delibes), mais elle n’a pas l’ambition d’un Fauré, d’un Duparc ou d’un Debussy et ne réserve guère de surprises. D’une tout autre portée sont en revanche les beaucoup plus tardives Six Ballades françaises (1921) sur des textes en prose de Paul Fort, plus sombres, intenses et dépouillées. Tant Sabine Revault d’Allonnes, qui a précédemment enregistré Massenet pour le même éditeur, que Thomas Dolié (né en 1979) peuvent être crédités d’une diction soignée, mais la soprano rencontre davantage de difficultés vocales que le baryton. Le pianiste et chef d’orchestre Samuel Jean (né en 1973) les accompagne tous deux à la perfection (1C1209). SC
Meijer que de la musique d’ambiance

Ce n’est pas de la musique classique, ce n’est pas du jazz, ce n’est pas de la variété mais c’est mieux que de la musique d’ambiance: la harpiste néerlandaise Lavinia Meijer interprète onze pièces du compositeur italien Ludovico Einaudi (né en 1955). A écouter si vous n’avez rien de mieux à faire (Sony 88883784082). SF
Pas de Nouvel An pour Johann Strauss (père)
 
Chez Marco Polo, le Neujahrskonzert n’est pas réservé au seul 1er janvier: il dure toute l’année, et même durant plusieurs années. Après des intégrales Johann Strauss fils et Josef Straus (son frère cadet), respectivement en cinquante-deux et vingt-sept volumes, l’éditeur s’est en effet lancé dans celle de Johann Strauss père (1804-1849), qui, parvenue à ses vingt-quatrième et vingt-cinquième volumes, touche désormais à sa fin. A raison de tranches chronologiques de dix opus par album (auquel s’ajoutent, le cas échéant, les œuvres hors catalogue), cette vaste entreprise en terrain assez largement inconnu, au-delà de l’incontournable de Marche de Radetzky, n’a rien laissé rien au hasard et – c’est la loi du genre – réserve quelques surprises. Au fil de ces deux derniers volumes, on découvre ainsi deux Marches pour la garde noble royale d’Espagne, un Quadrille sans titre posthume ainsi qu’un fragment d’une Marche pour le banquet de Radetzky restée inachevée. Ainsi que le laissent apparaître les commentaires experts du Dr. Thomas Aigner, de l’Institut viennois de recherches straussiennes, le directeur de la musique des bals de la cour royale et impériale continue inlassablement de répondre à la demande d’un public enthousiaste, jusque dans ses derniers mois, marqués par les soubresauts de la révolution de 1848 (Marche de la garde nationale de Brno, valse Couleurs nationales mais aussi Marche de Jelacic, sans doute sa dernière pièce achevée, en l’honneur du ban de Croatie qui avait contribué à écraser l’insurrection viennoise) et par un voyage à Londres avec son orchestre d’avril à juin 1849 (Polka d’Alice, Quadrille d’Almack, Polka d’Exeter, Polka de Frederica) via l’Allemagne (valse Sons joyeux d’Allemagne) et précédé de la valse L’Adieu du voyageur. Mais force est de constater que son fils aîné Johann, qui se pose déjà en rival, ne tardera pas à porter ces différents genres (valses, polkas, marches, quadrilles) à un tout autre niveau. On a pris de bien mauvaises habitudes avec le Philharmonique de Vienne dans ce répertoire qu’il sert comme personne et qu’il ne devrait pas se contenter de défendre par bribes une fois l’an. Il faut donc se contenter ici du Sinfonietta slovaque de Zilina (cinquième ville du pays, à l’ouest des Tatras), sous la direction de son premier chef invité depuis 2002, le Viennois Christian Pollack (né en 1946): sonorité sèche, baguette raide, la désillusion est grande et l’on se trouve plus souvent dans le kiosque d’une station thermale que dans la salle dorée du Musikverein. Marco Polo ne manquant généralement ni d’appétit ni d’ambition, il lui reste encore à honorer Eduard Strauss, le plus jeune frère de Johann et Josef, ou bien l’inventeur de la valse, Joseph Lanner (8.225344 et 8.225345). SC
Sibelius à Atlanta: rien de nouveau sous le soleil

Voici un disque fort inutile. Entendons-nous bien, l’Orchestre symphonique d’Atlanta est une formation de grande qualité qui livre une exécution professionnelle et brillante – très américaine (dans les couleurs comme les dynamiques). Mais ce Sibelius s’écoule avec une bonne dose de fadeur sous la baguette du chef américain Robert Spano (né en 1961), qui lisse le discours au point de lui enlever toute personnalité – quitte à abuser des fortissimos parfaits mais inoffensifs et finalement inodores (les cuivres notamment). La Sixième Symphonie est uniformément trop nette et trop brillante à la fois. Quel contraste avec les clairs-obscurs d’un Osmo Vänskä (Bis) ou les subtilités d’un Karajan (DG)... Le pire est certainement atteint par le Poco vivace, qui paraît confondre Sibelius avec Bizet. Par-delà une cohésion d’ensemble de haute tenue, on pourrait assimiler la lecture très terre-à-terre de la Septième Symphonie – dont le langage musical se prête à l’abstraction formelle – à la recherche d’une neutralité objective... si l’on ne s’y ennuyait pas à ce point. Malgré une réalisation plutôt tapageuse et quelques coquetteries difficiles à comprendre, Tapiola déroule une forêt de cordes qui séduit davantage. Ce disque (enregistré en janvier 2013) ne semble pas mériter pour autant une diffusion dépassant le marché local géorgien (ASO Media CD-1004). GdH
4 + 4 = Octuorissimo

Dans le cadre du projet «Le maître et l’élève» du festival 1001 Notes en Limousin (voir par ailleurs ici, ici et ici), le Quatuor Arranoa, formé en 2009, a enregistré en septembre dernier un disque avec Quatuor Debussy auprès duquel il se perfectionne. Les deux formations exécutent ensemble Last Round (avec le contrebassiste Simon Luce) d’Osvaldo Golijov, dont la rythmique et la mélancolie évoquent l’Argentine, les Deux Pièces pour octuor de Chostakovitch et Octet de Marc Mellits, musique dans le sillage de Steve Reich et de Philip Glass saupoudrée de rock et de pop – cela se laisse écouter. Les «maîtres» interprètent de leur côté les Deux Pièces pour quatuor de Chostakovitch et les «élèves» Tango Ballet de Piazzolla. Les jeunes femmes et leurs aînés livrent des prestations suffisamment engagées et imaginatives. Espérons qu’un éditeur offrira aux Arranoa la possibilité d’enregistrer une carte de visite plus significative (1001 Notes 04). SF
L’opéra sur le divan de Michel Schneider

Ecrivain, magistrat financier et ancien directeur de la musique au ministère de la culture, mais aussi psychanalyste et mélomane, Michel Schneider (né en 1944) a déjà publié de nombreux livres au confluent de ses deux passions (La Tombée du jour. Schumann, Prima donna. Opéra et inconscient). Voix et désir. Eros et opéra, dont la couverture reproduit – forcément – une photographie de Maria Callas, poursuit dans cette veine, en analysant, à tous les sens du terme, quatorze ouvrages, d’Orphée et Eurydice de Gluck à La Petite Fille aux allumettes de Lachenmann, ordonnés successivement selon les trois éléments du triptyque freudien formé par la mère, l’amante et la mort, et fonctionnant volontiers par parallèles, attendus (Faust et Don Juan) ou non (Kátia Kabanová et Marylin Monroe). Le ton est stimulant et l’auteur visiblement convaincu de son propos, mais davantage que des approximations (musicales) somme toute mineures (le Quatuor «Voces intimæ» de Sibelius daté de 1889 au lieu de 1909, Kabanicka et Irrewohe au lieu Kabanicha et Irrelohe), la faculté – certes intrinsèque à cette grille de (re)lecture des œuvres, en l’occurrence des livrets – à sembler pouvoir démontrer tout et son contraire en fonction du résultat recherché finit par agacer (Buchet Chastel, 234 pages, 20 euros). SC
Décevantes sonates françaises pour violon et piano

Christophe Giovaninetti, ancien membre des Quatuors Ysaÿe et Elysée, et Izumiko Aoyagi inspirent bien peu d’enthousiasme dans les Sonates pour violon et piano de Pierné et de Debussy ainsi que dans la Première de Fauré. La pianiste joue convenablement mais le violoniste déçoit: phrasés souvent grossiers, vibrato pas toujours agréable, sonorité généralement quelconque, traits régulièrement imprécis. Charpentées et volontaires, les interprétations manquent de finesse, de souplesse, et accusent quelques passages à vide. De surcroît, la prise de ton ne met pas bien en valeur les musiciens. Encore un disque qui tombera dans l’oubli (Continuo Classics CC777.705). SF
La rédaction de ConcertoNet
|