|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité d’octobre
10/15/2013
Les chroniques du mois
    Must de ConcertoNet Must de ConcertoNet
 Mariss Jansons et le Philharmonique de Vienne Mariss Jansons et le Philharmonique de Vienne
 Adam Laloum interprète Schumann Adam Laloum interprète Schumann
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Le Quatuor Arditti interprète Gerhard Le Quatuor Arditti interprète Gerhard
 Christian Thielemann et Renée Fleming Christian Thielemann et Renée Fleming
 William Wolfram interprète Liszt William Wolfram interprète Liszt
 Joaquín Achúcarro interprète Schumann Joaquín Achúcarro interprète Schumann
  Oui! Oui!
Dionysos de Rihm à Salzbourg (2010)
Thomas Fey dirige Haydn (vol. 19)
Emmanuel Pahud et Christian Rivet
Stanislaw Skrowaczewski dirige Brahms
Le violoncelliste Valentin Radutiu
Jean-Christophe Revel interprète Lenot
Hannu Lintu dirige Ligeti
Claudio Abbado dirige le Requiem de Mozart
Le SpiriTango Quartet interprète Piazzolla
Clara Haskil et Robert Casadesus à Lucerne
Litanies pour Ronchamp d’Amy
Œuvres pour ensemble vocal et viole de gambe d’Hersant
Christof Perick dirige Notre Dame de Schmidt
Lorin Maazel dirige Beethoven et Bartók
Concert champêtre de Jacques Borsarello
Jacqueline Du Pré et Bruno Leonardo Gelber
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Imogen Cooper interprète Schumann
Cecile Licad interprète Schumann
Tristan du Deutsche Oper avec R. Kollo et G. Jones
Jukka-Pekka Saraste dirige Brahms
Martha Argerich et ses amis à Lugano
L’altiste Andra Darzins et le pianiste Ventis Zilberts
François-Frédéric Guy interprète Beethoven
Günter Wand dirige Schumann et Mozart
Julien Martineau interprète Calace
Pas la peine
Annika Treutler interprète Schumann
Simone Young dirige Brahms
Œuvres pour orgue de Thomas Lacôte
Musique instrumentale de Fasch
Eduardo Fernández interprète Brahms
Alexander Ivashkin interprète Chostakovitch
Le Quatuor (de guitares) Eclisses
Hélas!
L’œuvre symphonique de María Teresa Prieto
L’entretien du mois

Emmanuel Pahud
En bref
Un Requiem de Mozart presque parfait
Lintu/Ligeti, une heureuse rencontre
Ensembles vocaux d’aujourd’hui: Amy et Hersant
Orgue d’aujourd’hui: Thomas Lacôte et Jacques Lenot
Live from Lugano 2012: Argerich & Co
Des nouvelles de l’altiste
Impressions lettones pour alto et piano
Du Pré, Gelber: une même passion fougueuse
Et encore des Symphonies de Brahms
Haskil et Casadesus à Lucerne: l’âge d’or des Fifties
Cordes pincées: le Quatuor Eclisses et Julien Martineau
Le geste auguste de Wand dans Schumann et Mozart
Le retour de Notre Dame de Schmidt
Valentin Radutiu et le violoncelle français
La niaque de SpiriTango
François-Frédéric Guy: un Beethoven libre et sans pathos
Le jeune Maazel: déjà imprévisible
Redécouverte de Fasch: on a fait mieux depuis
Le Brahms alangui d’Eduardo Fernández
Chostakovitch par Ivashkin: minimum syndical
La naïveté de María Teresa Prieto
Un Requiem de Mozart presque parfait

Aérien, lumineux, spirituel, ce Requiem de Mozart enregistré à Lucerne en août 2012 marque le public à en juger par le silence lourd de signification que Claudio Abbado obtient de lui avant les applaudissements – ce long moment de recueillement constitue désormais la marque de fabrique du maestro. Dirigeant un Orchestre du festival du Lucerne ultra précis (Sabine Meyer au cor de basset) et face à un double chœur (Radios bavaroise et suédoise) fabuleux de netteté et d’homogénéité, le chef opte pour le juste milieu: ni alanguie ni expédiée, cette interprétation empreinte de ferveur et d’émotion trouve un terrain d’entente idéal entre exaltation et profondeur. Le quatuor de solistes dispense des bonheurs divers: à côté d’une Sara Mingardo estimable, d’un Maximilian Schmitt presque idéal, d’un René Pape digne de son rang, Anna Prohaska déteint sur l’ensemble à cause d’un timbre peu amène et d’un chant ténu. Dommage que l’éditeur n’ait pas jugé nécessaire de compléter ce DVD trop bref par le reste du concert (Accentus Music ACC20258 ou Blu-ray ACC10258). SF
Lintu/Ligeti, une heureuse rencontre

Hannu Lintu (né en 1967) tient son orchestre dans le creux de la main. L’Orchestre philharmonique de la Radio finlandaise s’engage totalement dans une vision commune de la musique de Ligeti et de la nature subtile de son évolution sur une trentaine d’années, d’Atmosphères (1961), où le relief orchestral, les dynamiques et les timbres se gomment dans un tuilage micropolyphonique serré pour devenir une texture unique s’épaississant ou s’affinant au cours de l’œuvre, à l’extrême relief du Concerto pour violon (1989-1993) qu’annonçaient les différences soudaines d’attaque de dynamique, de rythme et de timbre de San Francisco Polyphony (1974). Le magnifique Lontano (1967), qui vient à égale distance des deux autres pages pour grand orchestre, témoigne des nuances organiques d’une étape intermédiaire. La prestation des Finlandais est une démonstration magistrale de la subtile beauté originale des orchestrations somptueuses de Ligeti qui, sous une allure de statisme instable, maintiennent une tension dramatique intense. Soliste du Concerto, le violoniste viennois Benjamin Schmid (né en 1968), dans un même esprit, varie l’expression, les traits d’archet et la sonorité de son instrument, jouant sur les contrastes d’un son sec qui claque au moelleux sonore de son large vibrato. On n’en oublie pas la belle prestation nuancée de Frank Peter Zimmermann (Teldec) ou celle par moments rhapsodique de Patricia Kopatchinskaja (Naïve), mais le contrôle, le calme lumineux et les instants fantasques de l’interprétation de Schmid portent la preuve de la plasticité d’une partition pourtant rigoureusement guidée par les indications de son auteur. La valeur du programme orchestral n’efface en rien la valeur parallèle de la version des Berliner Philharmoniker dirigés par Jonathan Nott (Teldec), par exemple, mais le soin minutieux du travail porté sur le relief orchestral, sur les sonorités individuelles et sur la nature des attaques, de leur absence totale à leur variation et à leur accentuation, rend un bel hommage à la fascinante esthétique évolutive du compositeur. Bravo (Ondine OCE 1213-2). CL
Ensembles vocaux d’aujourd’hui: Amy et Hersant
 
A l’occasion du cinquantenaire de la reconstruction de la chapelle Notre-Dame-du-Haut par Le Corbusier, Gilbert Amy (né en 1936) a conçu des Litanies pour Ronchamp (2005) pour deux chantres solistes (Dominique Vellard et Emmanuel Virstorsky), ensemble vocal (Rachid Safir à la tête de huit de ses Solistes XXI), quatuor à cordes (le Quatuor Parisii) et percussion (Abel Billard). Le projet se caractérise par ses dimensions (plus de 80 minutes) et, surtout, par sa forte ambition syncrétique. Les textes – non reproduits dans le livret mais accessibles sur Internet – alternent ainsi latin (Litanies à la Vierge du XVIIe), français (extraits de L’Ecclésiastique, Je vous salue Marie) et grec (hymne byzantine). La musique, plus encore, revendique le grand écart chronologique: dans la première partie, les pages – dont certaines purement instrumentales – écrites par le compositeur, qui puise parfois dans sa Missa cum jubilo de 1983, cohabitent avec le plain-chant, et la seconde partie est introduite par l’Adagio du Quinzième Quatuor de Beethoven, «chant de reconnaissance» dans le mode (myxo)lydien rappelant le grégorien. De même que l’architecte a combiné avec succès des matériaux représentatifs d’époques différentes (bois, pierre, bronze, fer, béton), Amy assemble le tout sans véritable solution de continuité et invite non pas à une célébration compassée mais à une spiritualité en harmonie avec la luminosité et la grâce du lieu (album de deux disques Soupir Editions S224). La référence au passé surprend moins de la part de Philippe Hersant (né en 1948), qui avoue notamment une prédilection pour l’association de la viole de gambe à un petit ensemble vocal. Voici donc réunies les quatre œuvres qu’il a destinées à cette «formation assez inhabituelle»: le Psaume CXXX (requérant en outre un orgue positif), pour Michel Laplénie (1994), le Stabat Mater, pour Geoffroy Jourdain (2002), Falling Star (2005), pour Bernard Tétu et ses Solistes de Lyon, de même que Clair Obscur (2008), qui donne son titre à l’album. Se fondant sur des textes d’une grande diversité (intégralement reproduits et traduits) – successivement l’Ancien Testament (le De profundis dans la version de Luther), la célèbre séquence médiévale, deux poètes anglais du XVIIe (John Donne et Henry King) et trois mystiques germaniques du XVIIe (Catharina Regina von Greiffenberg, Quirinus Kuhlmann et Angelus Silesius), Hersant évite tout hiatus entre l’instrument baroque, admirablement tenu par la gambiste Christine Plubeau, et le traitement plus moderne des voix de l’ensemble Sequenza 9.3, dirigé par sa fondatrice, Catherine Simonpietri. Cultivant les allusions et les affinités avec le passé bien plus que l’imitation ou la citation, il ne renonce que rarement à sa belle mélancolie coutumière, mais c’est alors pour l’éclat de «Sur la joyeuse résurrection du Christ» ou la douce lumière de certaines pages du Psaume CXXX et du Stabat Mater (Decca 481 0486). SC
Orgue d’aujourd’hui: Thomas Lacôte et Jacques Lenot
 
Thomas Lacôte (né en 1982), titulaire du grand orgue de la cathédrale de Bourges (2002-2011), est désormais titulaire-adjoint du Cavaillé-Coll de la Trinité, avec Jean-François Hatton et aux côtés du titulaire, Loïc Mallié. Auteur de plusieurs articles consacrés à celui qui en fut, durant soixante ans, le titulaire le plus illustre, Olivier Messiaen, il prépare actuellement un ouvrage sur ses techniques d’écriture. Cette longue fréquentation se ressent nettement dans sa propre musique, comme le montre un album monographique enregistré (avec une trop forte réverbération) à la Trinité et intitulé «The Fifth Hammer», du nom d’une étude pour orgue à quatre mains. Ghislain Leroy, Martin Tembremande, Angèle Dionnau-Kasser et le compositeur se partagent treize pièces, dont quatre récentes improvisations, qui donnent malheureusement trop souvent le sentiment de demeurer excessivement épigonales et de ne pas se dégager d’un respect excessif du style – pour ne pas dire des procédés d’écriture – de Messiaen, même quand vient s’y associer de façon assez inattendue, dans Cristal de temps, le saxophone (soprano) d’Antonino Mollica (Hortus 106). Faut-il en jouer soi-même si l’on veut (bien) écrire pour l’orgue? Bien que la réponse à cette question soit souvent positive, Jacques Lenot (né en 1945), qui n’est pas organiste, n’en a pas moins édifié depuis plus de trente ans un important corpus, comprenant notamment trois Livres d’orgue (1982-1995). Intrada, où est notamment déjà paru son œuvre pour piano, publie un nouveau recueil de grandes dimensions, par l’interprète – Jean-Christophe Revel (né en 1970) – et sur l’instrument – celui de la cathédrale Saint-François de Sales de Chambéry – de la création. Ces Suppliques (2010), comme l’indique Revel dans une passionnante notice en forme de «journal de création», sont fondées sur le matériau d’une œuvre – les onze «répliques» O vos omnes (2007) – qu’il a également créée et qui sont étendues à de beaucoup plus larges proportions (près d’une heure et dix minutes). A la différence de Lacôte, l’influence de Messiaen, si elle est perceptible, n’occulte pas l’expression d’une personnalité et, plus encore, d’une sensibilité qui, comme Le Tombeau de Szymanowski et Le Tombeau d’Henri Ledroit, voici vingt-cinq ans, s’attachent à évoquer la mémoire d’un être disparu, en l’espèce d’une amie, la traductrice Anne Deren (1943-2009). Car si l’interprète y entend la succession de figures de la rhétorique latine («Exorde», «Narratio», «Refutatio», «Digressio», «Transitio», «Confirmatio», «Peroratio»), le propos se place moins sur le terrain de la conviction que sur celui de l’expression ou, plus exactement, de l’empathie: on ne trouvera ici ni rugissements de douleur, ni larmes de déploration, ni même affectation de dignité, mais une méditation à la fois sobre et fervente, souvent lumineuse et apaisée, où le sentiment d’éternité que procurent de longues notes tenues n’est que rarement perturbé par des événements sonores plus animés (INTRA056). SC
Live from Lugano 2012: Argerich & Co

La ficelle est désormais un peu usée, mais la dernière cuvée du «Martha Argerich and friends» reste l’occasion d’écouter (pendant 3 heures et 45 minutes) de la musique de chambre interprétée par des musiciens heureux de jouer ensemble. Captées en juin 2012 lors du festival de Lugano, ces bandes n’en constituent pas moins un insolite patchwork. Certes, réunir Martha Argerich et Maria João Pires devant le même clavier permet d’entendre un Mozart (Sonate K. 381) équilibré et sensible – à la différence de l’accompagnement faible et poussif qu’offrent l’Orchestre de la Suisse italienne et Jacek Kaspszyk à la pianiste argentine (dans un Vingt-cinquième Concerto de peu d’ampleur). L’associer aux frères Capuçon dans des univers où elle excelle – Schumann (Cinq Pièces dans le style populaire) avec l’archet léger mais touchant de Gautier, Prokofiev (Seconde Sonate pour violon) avec le toucher moelleux mais piquant de Renaud – permet de (ré)entendre ce piano au naturel galopant, qui n’oublie jamais de s’arrondir. Si l’on ne sent pas beaucoup de conviction dans le Brahms (Variations sur un thème de Haydn) d’Argerich et Nicholas Angelich (... la première ne pouvant être tenue – quoiqu’en dise David Threasher dans la notice – pour une grande brahmsienne), on retrouve l’électricité de la «lionne» du clavier dans des œuvres pour deux pianos mais huit mains de Smetana (Mouvement de sonate en mi mineur, Rondo en do majeur) – bien entourée par Lilya Zilberstein, Anton et Daniel Gerzenberg. Parmi les œuvres où Martha ne joue pas (cinq sur treize), on relève une curiosité pour trois pianos (la probante transcription de La Mer de Debussy par Carlo Maria Griguoli), ainsi qu’un étrange Quatuor avec pianode Mahler par la famille Maisky (Mischa, Lily, Sascha… avec l’alto de Lyda Chen, la fille de Martha) – onctueux mais bien trop liquide. Mais, si de l’ordinaire se glisse parfois dans l’interprétation de certaines pages, l’osmose et l’enthousiasme de la pianiste Polina Leschenko, du violoniste Ilya Gringolts, de l’altiste Nathan Braude et du violoncelliste Torleif Thedéen font que le point fort du coffret réside, en définitive, dans un Second Quatuor avec piano de Dvorák qui transpire la passion et respire la fougue (coffret de trois disques Warner 7 21119 2). GdH
Des nouvelles de l’altiste

Sept ans après Réaltor B, Jacques Borsarello publie – toujours chez Symétrie, mais cette fois-ci au format de poche – un recueil de quinze nouvelles inspirées par son parcours de musicien. Comme dans son précédent ouvrage, expériences vécues – le protagoniste est souvent, comme l’auteur, un altiste – et fiction se mêlent en effet de manière troublante: on n’aura ainsi pas de mal à «reconnaître» par exemple qui sont (ou pourraient être) le plaisamment nommé Cimenti, «directeur général» de l’Opéra national de Paris, et Ana, chef d’orchestre scandinave qui dirige un ensemble français spécialisé dans la musique contemporaine («Cinq jours à New York»). Mais ce n’est pas le plus important, tant s’en faut, car ce qui fait le prix de cet ouvrage, c’est l’hommage sensible, complice et attendri à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, gravitent dans l’univers de la musique, à cette passion dont ils vivent, qu’ils font vivre aux autres mais qui, aussi et surtout, est leur vie même. Le propos pourrait se limiter aux artistes, bien sûr – célèbres ou anonymes – et à ces quelques aperçus du métier au quotidien – enseignant («Prof»), musicien d’orchestre en tournée («Vol AF 128»). Mais la découverte de l’envers du décor s’étend aussi au luthier («Le bois de Markneukirchen»), au régisseur («Régie») et aux personnages, souvent inattendus, qui hantent les coulisses des salles de concert – vendeuse de vêtements («La Dame aux papillons»), figurante («Figuration»), spectateur assidu («Le Fils de l’habilleuse»). Même les objets qu’on pense inanimés – le bois dont on a fait l’alto («Essarts»), le métronome («Marguerite») – ont une âme et prennent la parole pour narrer leur existence. Nullement blasé, toujours disposé à se laisser surprendre par l’irruption d’un moment de poésie («Concert champêtre», qui donne son titre au recueil), Borsarello, dans un style sans fioritures, laissant néanmoins affleurer l’ironie aussi bien que le dépit ou la nostalgie («Piano-bar»), est le démiurge d’un univers personnel et attachant qu’on retrouve toujours avec plaisir et souvent avec émotion (192 pages, 12,50 euros). SC
Impressions lettones pour alto et piano
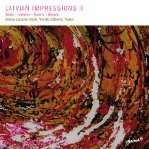
Andra Darzins et Ventis Zilberts proposent avec talent leur deuxième récital de musique lettonne écrite ou transcrite pour alto et piano. Y figurent dix compositeurs lettons, dont certains de renommée internationale tels le symphoniste Janis Ivanovs (1906-1983), l’excellent Talivaldis Kenins (1919-2008) et Peteris Vasks (né en 1946), stylistiquement protéiforme. Pour la plupart mélodiques et d’une respiration aérée, souvent romantique ou imprégnée de fragrances nationales, les pièces ne manquent ni de tenue ni de caractère. Vasks fait un délicieux retour sur ses origines pour le charmant Little Summer Music en six volets. La Sonatine de Helmers Pavasars (1903-1998) frôle la respiration franckiste comme le font Dramatic Moments de Lucija Garuta (1902-1977), sombre et beau, et les lyriques Portraits d’Olgerts Gravitis (né en 1926), des rythmes et modes lettons animant la partie centrale. Le Poema capriccioso d’Ivanovs, plus aventureux, laisse deviner ses talents d’orchestrateur alors que La Jeune Fille de Janis Kepitis (1908-1989) dresse un délicat portrait frémissant d’une personnalité complexe. Cauchemar de Lauma Reinholde (1906-1986) est une adroite évocation écrite en arche, sans fracas, sans fureur, mais aux climats subtilement tendus. D’une autre envergure vient la pièce de Kenins, Elégie et Rondo (1979), la force d’une sombre plaidoirie nostalgique s’étirant vers le silence avant l’éclat d’un Rondo énergique plus expressionniste, souvent percussif, rythmique, presque motorique, la seule composition de l’album à exploiter des techniques et modes d’écriture plus avancés. Selga Mence (né en 1953) et Imants Zemzaris (né en 1951), plutôt postmodernes, offrent la première un lancinant Inquieto agité et le second deux miniatures mélodieuses, l’une une esquisse tragique des relations tendues des Macbeth, l’autre une illustration doucement ironique du consumérisme, par Mozart interposé. Le piano de Zilberts est partout efficace, et on apprécie les sonorités rondes, et richement chaleureuses de l’alto de Darzins, autrefois élève de Kim Kashkashian (Animato ACD6138). CL
Du Pré, Gelber: une même passion fougueuse

5 mars 1963: deux solistes prometteurs font leurs débuts concertants à Berlin, sous la baguette jamais paresseuse de Gerd Albrecht. Alors âgée de dix-huit ans, Jacqueline Du Pré (1945-1987) dévore, d’une part, le Concerto pour violoncelle de Schumann de toute sa fougue et, disons-le sans ambages, de son génie d’interprète. Un vrai live qui ne dissimule pas quelques défauts dans l’exécution (un coup d’archet parfois râpeux, quelques notes à la justesse contestable, de menus décalages avec l’orchestre) mais qui révèle surtout un geste d’une passion aussi consommée que consumée (la cadence de feu du Sehr lebhaft!), infiniment généreux. Un lyrisme rendu possible par l’épatante domination d’une partition que certains mettent une vie à pénétrer. C’est, d’autre part, un Bruno Leonardo Gelber (né en 1941) de vingt-deux ans qui s’attaque sans trembler au Premier Concerto de Brahms, dont il révèle le plan d’ensemble avec une clarté d’expression et une maîtrise technique assez exceptionnelles pour un artiste aussi jeune, dominant l’intimidant premier mouvement avec tout le poids attendu dans le toucher. On suit le fil magnétique du doigté dans un Adagio sculpté par le pianiste argentin comme s’il parcourait le mouvement central de l’Opus 58 de Beethoven. L’œuvre s’achève dans un tourbillon de rythmes, presque violent mais d’une fougue rafraîchissante (Audite 95.622). GdH
Et encore des Symphonies de Brahms

 
Brahms encore, Brahms toujours: trois récentes parutions permettent d’entendre des orchestres allemands en concert, sous la baguette de leurs directeurs musicaux respectifs – ou tout comme, s’agissant de Stanislaw Skrowaczewski, premier chef invité de la Philharmonie allemande de la radio de Sarrebruck et Kaiserslautern depuis 1994. Le chef polonais, qui vient de fêter ses 90 ans, achève son intégrale des Symphonies chez Oehms Classics avec la Quatrième, captée à Sarrebruck en mars 2011. Cet album ridiculement bref (41 minutes) offre une vision assez sombre de l’œuvre, volontiers ample, parfois jusqu’à l’emphase, mais qui sait aussi se faire mordante, notamment dans un formidable Scherzo. Comme dans les Deuxième et Troisième, l’orchestre se montre convenable à défaut d’être très séduisant et la lenteur frise parfois le risque d’endormissement, mais elle est compensée par un geste puissant – on entend d’ailleurs le chef encourager les musiciens de la voix – et l’expression à la fois d’une grande tradition immémoriale et d’une forte personnalité (OC 410). Une autre intégrale s’achève chez le même éditeur, mais après le Brahms hautain et prométhéen de son aîné, Simone Young (née en 1961), avec le Philharmonique de Hambourg, où elle est Generalmusikdirektorin depuis 2005 (fonctions qu’elle exercera jusqu’en 2015), peine à attirer l’attention. Enregistrées en octobre 2009, les Troisième et Quatrième ne déméritent certes pas, bénéficiant en outre d’un orchestre de qualité équivalente et d’une prise de son moins clinquante. Mais la chef australienne, quand elle ne cède pas à quelques tournures un peu affectées, ne parvient guère à susciter l’intérêt (OC 677). Il y a fort à parier que l’album de Jukka-Pekka Saraste (né en 1956), enregistré en janvier 2013 avec l’Orchestre symphonique de la WDR de Cologne, dont il est le Chefdirigent depuis 2010, constitue le premier volume d’une intégrale. L’entreprise démarre sous de bons auspices, avec une phalange plus confortable que ses homologues rhénano-sarroise et hanséatique et une Première dynamique, où le sens de la construction ne bride pas l’inspiration. Dans la Troisième, en revanche, revient l’image d’une chef qui, comme dans son concert beethovénien le mois dernier à Pleyel, ne semble pas être à son meilleur dans le répertoire romantique, accomplissant son travail avec sérieux, mais apparaissant presque distant voire peu intéressé par ce qui se passe (Profil PH13028). SC
Haskil et Casadesus à Lucerne: l’âge d’or des Fifties

Audite lance une nouvelle collection consacrée aux archives du festival de Lucerne. Le disque inaugural de ces «Lucerne Festival Historic Performances» réunit deux concertos, le Vingtième de Mozart et le Cinquième de Beethoven. Le premier permet d’entendre Clara Haskil (dans son répertoire de prédilection) accompagnée par Otto Klemperer et le Philharmonia, le 8 septembre 1959. Avantageant le clavier, la prise de son – claire et ample – sent quand même son âge. Mais elle restitue pleinement une vision noire mais pas dépressive dans le premier mouvement, méditative mais pas sentimentaliste dans le deuxième, alerte mais pas joyeuse dans le dernier. Avec son sens épatant de la rythmique mozartienne, sa propre cadence dans l’Allegro initial et malgré quelques accrocs, Clara Haskil reste d’une simplicité sereine et d’une lumineuse précision dans le Concerto en ré mineur. Klemperer ne laisse rien au hasard, prodiguant un accompagnement attentif voire sévère – un peu lointain par moments et d’une lenteur qui pourra en rebuter certains. Mais, contrairement à ce que la photographie de couverture de la pochette cherche à nous faire croire, le trésor de ce disque réside dans L’Empereur donné deux ans plus tôt (le 1er septembre 1957) par Robert Casadesus et Dimitri Mitropoulos, deux ans après leur enregistrement «officiel» à Paris avec le Philharmonique de New York (Naxos, d’origine Columbia). On fond devant l’approche implacable mais jamais hautaine du pianiste français, sa grâce aristocratique et la vivacité chevaleresque de son toucher, l’infinie tendresse du mouvement lent comme l’approche naturelle et fougueuse du dernier mouvement, qui respire la force et le bonheur de vivre. Dirigeant un Philharmonique de Vienne bouillonnant pour sa première invitation à Lucerne, Mitropoulos cherche à l’évidence à en découdre, imprimant aux cordes des coups d’archet d’une précision diabolique, leur imposant des pizzicatos s’abattant tels des boulets de canon, prenant un malin plaisir à rechercher la surprise dans son accompagnement. Un début en fanfare pour cette série (95.623). GdH
Cordes pincées: le Quatuor Eclisses et Julien Martineau
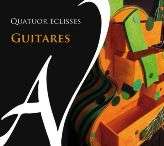 
Dans l’univers un peu à l’écart – comme celui de l’orgue – qui est celui de la guitare, voici deux nouveautés sortant des sentiers battus. Certes, de même que les violoncelles se regroupent volontiers par huit, on sait, depuis les frères Romero et le Quatuor de Los Angeles, que les guitares vont avec bonheur par quatre, mais le Quatuor Eclisses, constitué l’an passé, offre un album au titre («Guitares») bien moins original que son programme, mêlant transcriptions (attribuées, respectivement, collectivement au quatuor et à l’un de ses membres, Gabriel Bianco) – le Quatrième Concerto brandebourgeois et l’Ouverture du Siège de Corinthe – et œuvres originales – les huit brèves Estampes (1976) de l’Espagnol Federico Moreno Torroba (1891-1982), La Relève de la garde (1994) du Russe Nikita Koshkin (né en 1956) et Gris et soleils (1995) de l’Argentin Máximo Diego Pujol (né en 1957). Les quatre jeunes musiciens, qui mènent déjà chacun de brillantes carrières individuelles, placent très haut la barre technique mais l’intérêt musical des pièces modernes demeure relativement faible tandis le Bach et le Rossini auraient gagné à une plus grande implication (Ad Vitam AV 130715). Julien Martineau (né en 1978) enregistre dix Préludes (1905-1932) de Raffaele Calace (1863-1934) – une intégrale, bien que quatre d’entre eux portent un numéro supérieur à dix et que l’un, l’ultime Grand Prélude, ne soit pas numéroté. Si leur dénomination peut évoquer Chopin, la plupart de ces pièces, par leur durée, s’apparentent moins à un Prélude qu’à une Ballade, le plus souvent de forme rondo ou lied. Si son écriture paraît extérieurement peu spectaculaire, le «Paganini de la mandoline», dont l’abondant catalogue comprend 180 opus, n’en pose pas moins des exigences redoutablement virtuoses, point tant par la vitesse d’exécution requise que par un tissage de différentes voix dont ne pensait pas que l’instrument fût capable. Ce n’est ici ni la mandoline «parisienne», à la manière de Picasso ou Braque, ni une mandoline «viennoise», dans la lignée de l’usage qu’en ont fait Mahler puis, surtout, Webern, mais une mandoline clairement napolitaine – il y est né dans une famille de luthiers dont son petit-fils et son arrière-petite-fille perpétuent aujourd’hui le nom: musique de caractère toujours belcantiste, un tantinet nostalgique, généralement dans un tempo modéré, harmoniquement peu ambitieuse, mais au charme étonnamment attachant – la parfaite musicalité du mandoliniste français y est certainement pour quelque chose (Muse 0101). SC
Le geste auguste de Günter Wand dans Schumann et Mozart

Dans la (colossale) série que l’éditeur allemand consacre à Günter Wand (1912-2002), Profil publie ces bandes de la NDR qui donnent à entendre un orchestre à la sonorité professionnelle mais assez ordinaire dans le Concerto pour piano de Schumann (capté le 21 mars 1983). On peut y trouver vraiment trop lente la baguette léchée du chef allemand, qui plonge l’Allegro affettuoso dans le statisme et empêche d’apprécier les vertus de la lenteur imposée à l’Intermezzo central (pourtant marqué Andantino). Enlevé mais presque brutal, l’Allegro vivace sonne comme de la musique de ballet à force de rechercher (et de trouver) la régularité dans la rythmique et la précision dans les lignes musicales. Le piano très propre de Gerhard Oppitz (né en 1953) offre beaucoup d’éclat mais peu d’émotion – avec une cadence du premier mouvement charpentée avec tant de méthode qu’elle en deviendrait presque mécanique ou... classique. Et c’est bien ce qui manque à cette interprétation anguleuse: le grand frisson romantique! Il va de soi que la même approche permet à Wand de construire un Mozart infiniment plus captivant. Enregistrée le 17 décembre 1990, la Quarantième Symphonie fourmille de détails, grâce à une construction implacable et riche en contrastes de nuances, fuyant la spontanéité au bénéfice de l’équilibre de l’architecture d’ensemble. Certains pourront néanmoins sentir poindre l’ennui dans le Molto allegro initial, alors que l’Andante paraît s’embourber dans un tempo vraiment lent... Mais tous retrouveront leurs marques avec un Menuetto pleinement convaincant et un Allegro assai incontestable (PH13030).GdH
Le retour de Notre Dame de Schmidt

Comme les excellents Schreker dirigés par Gerd Albrecht (voir ici), Capriccio réédite le rare Notre Dame, «opéra romantique» en deux actes de Franz Schmidt (1874-1939), enregistré en août 1988 à Berlin sous la direction de Christof Perick (né en 1946). Achevé en 1906, l’ouvrage dut attendre huit ans pour être créé à l’Opéra de Vienne: le compositeur, violoncelle solo à la Philharmonie jusqu’en 1911 et à l’Opéra jusqu’en 1914, était alors dans sa quarantième année, mais Hofmannsthal, écrivant à Strauss, le présente comme «inconnu à ce jour». Le succès fut cependant au rendez-vous, mais ne survécut guère à l’après-1945: son sort demeure certes meilleur que celui du second opéra de Schmidt, Fredigundis, car il a un peu survécu au concert et au disque grâce à certains de ses extraits symphoniques; cela étant, malgré quelques reprises comme à Dresde en 2010 avec l’inévitable Albrecht, il n’en est pas moins devenu l’une des raretés de nature à susciter la louable curiosité d’un Leon Botstein (voir ici) et n’a pas droit à une notice dans les Mille et un opéras de Kaminski (Fayard), indice souvent révélateur, compte tenu de l’exhaustivité et du sérieux de cet ouvrage. Ce destin est en grande partie injuste: sur un livret qui ne trahit guère le roman d’Hugo, la musique tient son rang dans la proximité de Wagner, Strauss et Pfitzner davantage que dans les sortilèges capiteux de Schreker et Korngold. Les chanteurs sont parfois bien fatigués, mais un James King (1925-2005) et une Gwyneth Jones (née en 1936) fatigués n’en demeurent pas moins un James King et une Gwyneth Jones, tandis que Kurt Moll (né en 1938) reste égal à lui-même. A côté de ces gloires wagnériennes, Horst R. Laubenthal (né en 1939) et, plus encore, dans le rôle de l’archidiacre (Frollo), Hartmut Welker (né en 1941) ne pâlissent nullement. Cette version s’impose d’autant plus qu’il n’existe face à elle qu’un live antédiluvien et sa réédition à prix économique – mais sans le texte du livret – est donc très opportune (C 5181). SC
Valentin Radutiu et le violoncelle français

Deux jeunes musiciens de grand talent portent haut les couleurs du répertoire français à travers trois pièces représentatives de ce répertoire et pourtant, pour deux d’entre elles, peu présentes au disque. Ce beau programme fait appel à trois compositeurs de formation différente et s’étend de 1856 à 1927. Valentin Radutiu (né en 1986), violoncelliste allemand de belle promesse et de grande envergure, s’associe au brillant pianiste suédois Per Rundberg (né en 1971) pour interpréter la Sonate de Lalo, la Sonate (1910) de Magnard et, transcrite par Radutiu, la Seconde Sonate pour violon et piano (1923-1927) de Ravel. La grande surprise vient de la dernière. Malgré la réticence d’une première écoute au cours de laquelle on peut trouver pesante la transcription au violoncelle comparée au violon d’origine, force est ensuite de constater que celle de Radutiu se défend et que sa prestation convainc. L’interprétation de Rundberg, de haute volée, s’impose parmi les meilleures par un phrasé impeccable, différencié comme il se doit, des traits percussifs aux mille nuances et des accents jazziques d’un naturel confondant. Ainsi admirablement soutenu, Radutiu révèle son grand talent. Si les pizzicati manquent d’un brin de subtilité, ses glissandi sont magnifiquement chaloupés, il file des aigus d’une pureté exquise et son «Perpetuum mobile» fuse de manière étourdissante. Son style fougueux, lyrique, fluide et sombrement romantique sied bien à la pièce de Lalo qui y gagne ses lettres de noblesse. Son expressivité alliée à une précision rigoureuse et une agilité sans faille met en belle lumière les adresses et les humeurs changeantes de l’exaltante Sonate de Magnard, œuvre remarquable qui annonce les futures aventures d’un Roussel. Rundberg assure avec brio la partie de piano, véritable morceau de bravoure. La voix particulière du violoncelle de Radutiu (Francesco Ruggieri, 1685) garde son corps, son caractère sans rondeur mais sans sècheresse et son timbre vibrant et équilibré dans tous les registres. Recommandé (Hänssler Classic CD 98.654). CL
La niaque de SpiriTango

Piazzolla ne se démode pas, mais sa musique sert trop souvent de prétexte à des musiciens de formation classique désireux de s’encanailler à peu de frais avec cet élève de Nadia Boulanger. Dans ce paysage discographique, le premier album du Spiritango Quartet, constitué en 2010 par des élèves de la classe d’Ami Flammer et Jean-Noël Crocq au CNSM, n’en ressort qu’avec davantage d’éclat. Intitulé «Rage», il comprend neuf des pages les plus célèbres du fondateur du tango nuevo, qui aurait déclaré «Le tango, c’est la rage». De fait, le disque frappe par sa formidable niaque, mais ce n’est heureusement pas sa seule dimension, grâce à l’accordéon tantôt agile, tantôt goguenard de Thomas Chedal, au violon tantôt crissant, tantôt charmeur de Fanny Gallois, au piano tantôt mordant, tantôt sensible de Fanny Azzuro, à la contrebasse tantôt rythmique, tantôt lyrique de Benoît Levesque, tour à tour mis en valeur par les arrangements. Est déjà annoncé un deuxième album «mêlant plusieurs univers»: il est attendu avec impatience, en espérant toutefois qu’il ne se contentera pas, comme celui-ci, d’une texte de présentation aussi sommaire (Polymnie POL 480 494). SC
François-Frédéric Guy: un Beethoven libre et sans pathos

On avait rendu compte de chacune des étapes de cette intégrale des trente-deux Sonates de Beethoven par François-Frédéric Guy (né en 1969), décrivant un geste «tout en douceur, serein et même lumineux par moments, qui questionne le texte en multipliant les arrêts sur image et en canalisant les aspérités» dans le premier volume, confirmant une «approche remplie de fraîcheur et de liberté» dans le deuxième, saluant un Beethoven «serein et doux, frais et indépendant» dans le dernier. Captés en concert (à l’Arsenal de Metz) entre décembre 2009 et avril 2012, ces enregistrements d’une fluidité instinctive au risque de l’instabilité, marqués par la recherche d’une éloquence sans pathos, la clarté des dynamiques et une tendance à retenir et même brider le tempo comme pour mieux forcer l’attention... se perdent parfois dans l’alanguissement du rythme – qui devient souvent mollesse. L’approche – globalement enlevée et joyeuse – aboutit à regretter la noirceur et la gravité d’un Gilels (DG), la lenteur et le poids d’un Arrau (Decca), la folie et le caractère d’un Gulda (Brilliant), le jusqu’auboutisme et le génie d’un Richter, la lumière et l’évidence d’un Kovacevich (EMI)... un Beethoven «à la française» – moins attachant que l’admirable intégrale de Georges Pludermacher (Transart), également captée sur le vif (coffret de neuf disques Zig-Zag Territoires ZZT 333). GdH
Le jeune Maazel: déjà imprévisible

Hänssler Classic continue de puiser parmi les nombreuses richesses que recèlent les enregistrements de concerts archivés par la Südwestrundkunk: ainsi des débuts, le 3 décembre 1958, de Lorin Maazel à la tête de l’Orchestre radio-symphonique de Stuttgart – rencontre qui devait néanmoins rester sans lendemain. A 28 ans, le prodige américain avait déjà une assez longue carrière de chef invité à son actif et l’entendre, quelques années avant ses premiers disques légendaires, tels ses Ravel chez Deutsche Grammophon, est captivant, car on retrouve, dans une fort belle prise de son pour l’époque, à la fois tout ce qui, chez lui, force souvent l’admiration et suscite parfois l’agacement – quoique sans doute à un moindre degré, les qualités l’emportant ici largement sur les défauts. C’est le cas dans Beethoven: après une Ouverture Coriolan où le classicisme prend le pas sur le romantisme, il fait merveille dans la rare et difficile Deuxième Symphonie, d’une splendide vitalité (à l’exception d’un Larghetto très alangui mais somptueux), presque parfaite, hormis un tempo excessivement retenu dans le Trio du Scherzo. De même, le Concerto pour orchestre de Bartók frappe par la qualité de la mise en place – il faut conserver à l’esprit que l’œuvre n’avait été créée que quatorze ans (et deux jours) plus tôt, ce que traduisent quelques difficultés instrumentales – et par une combinaison de souplesse, d’impulsions de génie et de force expressive – l’intensité de l’«Elégie» – hélas gâchées ici ou là par quelques initiatives intempestives ou excès sentimentaux (CD 94.224). SC
Redécouverte de Fasch: on a fait mieux depuis

Depuis plusieurs années maintenant, Johann Friedrich Fasch (1688-1758) fait l’objet d’une belle redécouverte, le disque permettant l’exhumation de ses concertos ou de ses sonates, pour le plus grand bonheur des amateurs du genre (voir ici, ici et ici). La réédition de ces deux disques vient nous rappeler que les premiers enregistrements de l’œuvre du compositeur dresdois sont néanmoins relativement anciens puisque remontant, en l’espèce, aux mois de novembre 1986 et mai 1987. Ce ne sont certes pas les premiers enregistrements de pièces de Fasch, le trompettiste Adolf Scherbaum ayant par exemple gravé un concerto pour Deutsche Grammophon dès 1963! En l’espèce, le trompettiste Ludwig Güttler, qui a notamment enregistré ce même concerto en 1974 chez Eterna, dirige les Virtuosi Saxoniae dans deux ouvertures et un concerto (destiné cette fois-ci à deux cors de chasse, deux hautbois, un basson et une basse continue). A l’écoute de ce premier disque, on est frappé par un style fortement daté, se caractérisant par une emphase plutôt hors de propos, par une certaine lourdeur aussi et un rythme très raide qui ennuient très rapidement l’auditeur, chaque phrase devenant ainsi totalement prévisible alors que la musique baroque se caractérise au contraire par une grande liberté pleine de spontanéité et de surprises. Quant aux sonorités, elles trahissent également une esthétique qui fait aujourd’hui figure de véritable curiosité (les corni da caccia dans l’Allegro initial du concerto). Le second disque rassemble pour sa part six sonates destinées principalement à deux hautbois et un ou deux bassons, qui ont été enregistrées cette fois-ci aux mois de janvier et de mai 1987. L’ensemble est très bien fait mais manque cruellement de caractérisation, le jeu des musiciens étant là aussi d’une assez grande platitude. On passera donc rapidement sur ces deux disques qui sont désormais largement dépassés par des interprétations plus récentes dont la séduction et l’imagination sont bien plus enthousiasmantes (album de deux disques Brilliant Classics 94673). SGa
Le Brahms alangui d’Eduardo Fernández

Le récital madrilène enregistré en studio (en avril 2012) par le pianiste espagnol Eduardo Fernández (né en 1981) propose des pièces tardives de Brahms, principalement des Intermezzos. Ceux de l’Opus 117, alanguis, confondent malheureusement ces concentrés d’humanité avec des comptines pour enfant. Aucun sfumato ne se dégage, du reste, de ce toucher à la clarté presque crue et à la lenteur désossée. La mayonnaise prend seulement avec l’Opus 118 – qui offre des Intermezzos un peu plus animés – mais la frappe reste trop légère, jusque dans une «Romanze» plutôt apathique. L’Opus 119 présente enfin de la densité et même, dans la «Rhapsodie», une certaine fantaisie. Mais par comparaison avec les Wilhelm Kempff, Yves Nat, Radu Lupu, Philippe Cassard..., ces Klavierstücke de Brahms paraîtront assoupies sinon anesthésiées (Centaur Records CRC 3274). GdH
Chostakovitch par Ivashkin: minimum syndical

Alexander Ivashkin (né en 1948) rencontre plus ou moins les exigences des Concertos pour violoncelle de Chostakovitch: de l’angoisse et de la tension, certes, il y en a, mais cet enregistrement de 1997 accuse des baisses de régime, notamment dans les cadences. Sans démériter, cette version déçoit à cause de son manque d’intensité, comme dans la montée en puissance de l’Allegretto du Second, de mordant, de contraste, de fulgurance. L’Orchestre symphonique de Moscou dirigé par Valery Polyansky ne démérite pas mais les cuivres affichent quelques insuffisances. Rostropovitch (chez divers éditeurs) reste indétrônable (Brilliant Classics 9413). SF
La naïveté de María Teresa Prieto

Avec María Teresa Prieto (1896-1982), comment ne pas être attiré par la perspective de découvrir un compositeur au parcours original et dont la vie et l’œuvre, à ce jour, ne demeurent éclairés que par de rares sources documentaires? Née à Oviedo, formée dans le culte de Bach, elle étudie à Madrid mais, dès le déclenchement de la guerre civile, émigre au Mexique, où réside son frère. Elle y reçoit des leçons de Ponce et Chávez, qui créa bon nombre de ses œuvres, se rend à Mills College pour bénéficier de l’enseignement de Milhaud et rencontre Stravinski. Hormis une visite-éclair en 1958, elle ne retourna pas dans son pays, même après l’avènement de la démocratie, mais ses partitions, ne serait-ce que par leurs titres, traduisent la nostalgie de son pays natal. Faut-il en attendre pour autant un magnifique chant d’exil, à l’image, par exemple de celui d’un Martinů? Enregistré en 2005 et 2006, l’Orchestre de Cordoue, dirigé par José Luis Temes (né en 1956), signataire d’une notice très instructive, donne l’intégrale de son corpus orchestral, soit un peu plus de deux heures de musique (à l’exclusion de manuscrits non exécutables ou non destinés à être exécutés – exercices, annotations, pages inachevées). Commencé à un âge tardif (44 ans), il comprend trois Symphonies – «Sinfonía Asturiana» (1942), «Sinfonía breve» (1945) et «Sinfonía de la danza prima» (1951) –, une Impression symphonique (1940), le poème symphonique Chichen-Itzá (1944), un Adagio et Fugue avec violoncelle solo (1948), la Suite «El palo verde» (1956) et deux diptyques, Scènes de la nature (1965-1967) ainsi que Thème varié et Fugue, dans le style dodécaphonique (1963-1967). On peine cependant à voir l’intérêt qu’y trouvèrent, outre Chávez, des chefs tels qu’Erich Kleiber et Ataúlfo Argenta: datée et malsonnante, d’une naïveté confondante, elle prête hélas le plus souvent à sourire par sa gaucherie, entre lourds pastiches néobaroques quasi stokowskiens quand elle ne fait pas songer à un Ives dont les «maladresses» seraient ici involontaires. Sous l’influence de Rodolfo Halffter, et à l’image de Stravinski à la même époque, Prieto s’intéresse à partir de la fin des années 1950 à la technique dodécaphonique, mais ce tournant compositionnel n’a que peu d’incidences sur l’inspiration et, surtout, ne change rien à un refus obstiné de la modernité (album de deux disques Verso VRS 2047). SC
La rédaction de ConcertoNet
|