|
Back
CD, DVD et livres: l’actualité de juillet
07/15/2013
Les chroniques du mois
   Sélectionnés par la rédaction Sélectionnés par la rédaction
 Kaija Saariaho: l’ombre du songe Kaija Saariaho: l’ombre du songe
 Sergiu Celibidache dirige Bruckner Sergiu Celibidache dirige Bruckner
 Lorin Maazel dirige Schubert Lorin Maazel dirige Schubert
 Guide des instruments de musique 1800-1950 Guide des instruments de musique 1800-1950
  Oui! Oui!
Valery Gergiev dirige le Philharmonique de Vienne
Daniel Barenboim dirige Bruckner
Franz Welser-Möst dirige Bruckner
Gianandrea Noseda dirige Casella
Francesco La Vecchia dirige Ghedini
Ernst Kovacic dirige Krenek
Ilona Then-Bergh et Michael Schäfer interprètent Delvincourt
Otto Klemperer dirige des musiques du XXe siècle
Neeme Järvi dirige Chabrier
Le Quatuor Signum interprète Bartók, Berg et Schnittke
Le Joueur de Prokofiev filmé au Mariinsky
Steven Dann interprète Bréville, Koechlin et Tournemire
Horia Andreescu dirige W. G. Berger
Sigrid Kuulmann et Marko Martin interprètent Tubin
Alexander Walker dirige Brian
Le Quatuor Pacifica interprète Chostakovitch et Weinberg
Georg Solti filmé dans Mozart et Tchaïkovski
Susanna Mälkki et Dima Slobodeniouk dirigent Strasnoy
Récital du pianiste Stéphane Spira
Aapo Häkkinen dirige F. X. Dussek
Pelléas et Mélisande à l’Opéra de Paris (2012)
Les Soldats à Salzbourg (2012)
 Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Le concours Reine Elisabeth 2013
Luis Otavio Santos interprète J.-M. Leclair
Les Noces de Figaro à Glyndebourne (2012)
Pietro Massa interprète Castelnuovo-Tedesco
Francesco La Vecchia dirige Mancinelli
Philippe Herreweghe dirige Mozart
Juan Guillermo Vizcarrra interprète Wagner transcrit par A. Stradal
Découvrir Wagner (coordonné par Elisabeth Brisson et René Palacios)
Pas la peine
L’Olimpiade de Pergolèse à Jesi (2011)
Emy Bernecoli et Massimo Giuseppe Bianchi interprètent Ghedini
Vladimir Ashkenazy filmé dans Schubert et Schumann
Andrés Orozco-Estrada dirige Berlioz
Les solistes de chambre d’Uppsala interprètent Brahms
Francesco Piemontesi interprète Schumann et Dvorák
Hansjörg Albrecht interprète Wagner transcrit à l’orgue
Fidelio à Glyndebourne (1979)
Hélas!
Andrés Orozco-Estrada dirige Berlioz
Le match du mois
  
Quatrième de Bruckner en DVD: D. Barenboim, S. Celibidache ou F. Welser-Möst?
En bref
La preuve par trois du Quatuor Signum
Un Joueur gagnant
Wagneriana (suite...)
Le XXe siècle de Klemperer
L’incursion mozartienne de Philippe Herreweghe
Les Soldats prennent Salzbourg
Neeme Järvi fait briller Chabrier
Le Pelléas de Wilson passe à la postérité
La (longue) vie de Brian
Le violon de Tubin
Le violon de Delvincourt
L’alto de Bréville, Koechlin et Tournemire
Solti ou comment rouler des mécaniques
Strasnoy ou comment pratiquer l’humour en musique
Ashkenazy ou comment épater sans convaincre
Aus Breslau, Krenek spielt auf
W. G. Berger: postromantisme roumain
Un Dussek peut en cacher un autre
Le tour de France de Stéphane Spira
Un Fidelio sans éclat
Des Quintettes de Brahms venus de Suède
La trop timide Fantastique d’Andrés Orozco-Estrada
Le Quatuor Pacifica poursuit sa «Soviet Experience»
Francesco Piemontesi: pour Dvorák, pas pour Schumann
La preuve par trois du Quatuor Signum

Pour son troisième enregistrement chez Capriccio, intitulé «No.3», le Quatuor Signum joue sur le chiffre trois pour un récital au programme original, surprenant mais cohérent et tout à fait passionnant, qui comprend le l’Opus 3 de Berg et le Troisième Quatuor de Bartók et de Schnittke. Bien que les résultats soient très différents, les trois compositeurs ont en commun de disposer «de toutes les nuances de la vie, du frisson tragique jusqu’au simple jeu», qualité que Kodály attribuait à Bartók, et le programme frappe par son flux rythmique, ses climats qui basculent et son expressivité intense. Les musiciens allemands mènent la polyphonie complexe du beau Quatuor (1909-1910) de Berg avec beaucoup de lyrisme tout en respectant les contrastes de timbre et d’attaque mais peut-être avec moins de relief transparent que, par exemple, les Prazák, plus expressionnistes. Le Troisième (1927) de Bartók, un sommet fermement établi au grand répertoire, exige autant de prouesse technique des interprètes que d’engagement personnel. Plus proches des Hongrois, peut-être, que des Belcea, plus urgents et incisifs, ou de la concentration incandescente des Ebène, les Signum en livrent une interprétation beethovénienne d’esprit et non sans intensité, les rythmes percutants en place, le contrepoint toutefois plus souvent fondu qu’au relief accusé. Leur lyrisme particulier imprime une unité de bon aloi au polystylisme et aux excès du Troisième (1983) de Schnittke, tant accentués par les Kronos plus âpres. Les déraillements soudains de la ligne mélodique, dissonants et déchirants, y gagnent un pathétisme que l’on oserait qualifier de «russe». Le pari de ce programme aventureux est tenu (C5163). CL
Un Joueur gagnant

Si quelques-uns des opéras de Prokofiev ont trouvé un tant soit peu leur place au répertoire, à commencer par L’Amour des trois oranges, Le Joueur (1916/1927) a souffert d’une création reportée en raison de la Révolution russe et n’a pas ensuite accompli la carrière qu’il mérite – la première scénique parisienne n’a ainsi été donnée qu’en 1996 par les forces du Kirov, sous la direction de l’infatigable Valery Gergiev. C’est cette équipe qu’on retrouvait peu de temps après au disque (Philips). Une décennie et quelques représentations plus tard (comme au Met en 2008), c’est maintenant une vidéo, captée en juin 2010 toujours dans ce Kirov redevenu le Mariinsky, toujours avec Vladimir Galouzine, qui campe un Alexis (le rôle-titre) à la fois hâbleur, pitoyable et inquiétant, et Sergueï Aleksachkine, général point trop caricatural. Les autres chanteurs sont tout aussi typiquement russes et, surtout, du même niveau, vocal comme théâtral, notamment Larissa Diadkova, impériale en Baboulenka, et Tatiana Pavlovskaïa, une Polina convaincante dans ses errances et sa fragilité. Le décor unique de Zinovy Margolin, complété par les lumières de Gleb Filshtinsky, et les impeccables costumes 1900 de Tatiana Noginova s’effacent sobrement devant le livret tiré de la nouvelle éponyme de Dostoïevski pour mieux laisser s’exprimer la direction d’acteurs de Temur Chkheidze, qui alterne efficacement farce sociale, étude de caractères et virtuosité scénique – il faut en effet tenir la route sur une bonne moitié de l’ouvrage, dont le ressort est essentiellement psychologique. Dans la fosse, c’est le Gergiev des grands jours, animant sans cesse cette partition sauvage, pas très éloignée des œuvres les plus avant-gardistes des années 1920 (L’Ange de feu, Deuxième et Troisième Symphonies). Un spectacle bien chanté, bien dirigé, bien mis en scène et, pour ne rien gâcher, bien filmé par les caméras de Laurent Gentot (Mariinsky DVD MAR0536 ou Blu-Ray MAR0540).SC
Wagneriana (suite...)
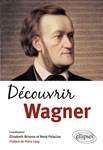
 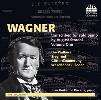
Célébrant le bicentenaire, les éditeurs entretiennent avec flamme la wagnéromania ambiante. Les organistes s’en donnent à cœur joie puisqu’après d’intéressants témoignages historiques, Oehms Classics publie l’hommage rendu par Hansjörg Albrecht – qui pousse sa passion jusqu’à publier dans le livret un «dialogue imaginaire» (... et un peu timbré) entre Wagner et lui. Enregistrées en avril 2012 sur les orgues de la Hauptkirche St. Nikolai zu Kiel, les transcriptions d’Edwin Henry Lemare et Erwin Horn amplifient la dimension contemplative (Tristan) ou sacrée (Parsifal) des Ouvertures ou des Préludes, mais manquent par trop de couleurs et d’inflexions rythmiques (Tannhäuser, Maîtres chanteurs) pour captiver véritablement (OC 690). Enregistré en juillet 2012 à Denton au Texas, le pianiste Juan Guillermo Vizcarra plonge, lui, dans le flux plus monochrome des transcriptions du Tchèque August Stradal (1860-1930). Ce «Volume One» des adaptations réalisées par l’élève de Bruckner offre un Wagner de salon (un peu raide), avec un côté «best of the Ring» («Chevauchée des Walkyries», «Murmures de la forêt», «Voyage sur le Rhin», «Marche funèbre de Siegfried»...) – plus intéressant à interpréter (chez soi) qu’à écouter (au détriment d’une version avec orchestre). Un bel art de la transcription néanmoins, qui atteint son objectif de ressusciter des «souvenirs de Bayreuth» – le génie recréatif de Liszt en moins – et culmine dans de touchants Wesendonck-Lieder. Par l’ardeur de son geste, le pianiste péruvien convainc (Toccata Classics TOCC 0151). On pourra écouter tout cela en parcourant Découvrir Wagner, ouvrage coordonné par Elisabeth Brisson et René Palacios. Son ambition ne doit pas être confondue avec une démarche de vulgarisation (façon «Wagner pour les nuls») mais traitée comme une volonté de décrypter l’homme et l’œuvre en multipliant les points de vue et les angles d’approche (signalons notamment l’intéressant article de la jeune soprano Vanessa Le Charlès intitulé «Chanter Wagner»). Un ouvrage collectif au contenu disparate et dont, comme le souligne l’éditeur, «l’objectif final est bien sûr d’expérimenter par soi-même les plus beaux passages wagnériens [...] puis d’aborder les opéras complets [...] pour découvrir ce qui provoque une telle fascination». Ce qu’elle provoque est décrit sans détours par la mezzo Petra Lang: «un vertige presque euphorique» (Ellipses, 220 pages, 14,50 euros). GdH
Le XXe siècle de Klemperer

Parmi une importante série de rééditions qu’EMI consacre à Otto Klemperer, disparu voici exactement quarante ans, on retrouvera avec plaisir ses interprétations entrées dans la légende – Haydn, Mozart, Beethoven et, évidemment, Mahler, dont il fut le disciple – mais le coffret de quatre disques dédié à la musique du XXe siècle vient opportunément rappeler que le chef allemand fut non seulement, dans l’entre-deux-guerres, à l’avant-garde de son temps mais, à l’instar de tant d’autres de ses confrères (Bernstein, Furtwängler, Kubelík, Markevitch, Martinon, ...), s’adonna aussi lui-même à la composition. Ces enregistrements avec le Philharmonia – supervisés, bien sûr, par Walter Legge – ou, plus tardivement, le New Philharmonia ont certes déjà été réédités par le passé, mais il y a tout lieu de se réjouir qu’ils soient de nouveau aisément accessibles. C’est déjà l’époque où Klemperer a sérieusement ralenti le tempo et ne se départ que rarement d’une esthétique «statue du Commandeur»: ça passe – le plus souvent – ou ça casse, et, en tout état de cause, il soumet les partitions à de redoutables et passionnantes «opérations vérité». Ainsi d’une Suite de Pulcinella effrontée et férocement grimaçante ainsi que d’une Symphonie en trois mouvements marmoréenne et glaçante, faisant regretter qu’il n’ait pas gravé d’autres œuvres de Stravinski, comme les Symphonies d’instruments à vent ou la Symphonie de psaumes. Le premier disque se conclut, toujours au début des années 1960, sur une Petite musique de quat’sous – qu’il avait créée en 1929 à Berlin – drue et acide. Le deuxième est intégralement dédié à Klemperer compositeur: débutant avec la nostalgique Valse gaie (1959), extraite de l’un de ses cinq opéras, Le But, il comprend principalement l’une de ses six Symphonies – la Deuxième (1969), où l’on reconnaît souvent des traits d’écriture mahlériens – et l’un de ses neuf Quatuors – le Septième (1969), rude combat dans la descendance du dernier Beethoven et de Zemlinsky. Sa baguette convient parfaitement au rare Nobilissima visione de Hindemith (remontant à 1954) et un Philharmonia à la fois somptueux et transparent ne fait pas regretter les extraits symphoniques de Hansel et Gretel, même s’ils sont un peu en dehors du thème de cette anthologie (l’opéra de Humperdinck datant de 1893). Le dernier tiers du coffret est consacré à une longue (une heure trois quarts) narration (en anglais) de Jon Tolansky, entrecoupée d’extraits musicaux (y compris de répétitions), de propos – dont certains inédits – de Klemperer et d’entretiens toujours admiratifs, souvent touchants, parfois drôles, avec des chanteurs et des musiciens du Philharmonia. Après l’évocation d’une vie marquée par Mahler et le Kroll Oper, mais aussi par l’exil et la maladie, de Berlin à Londres en passant par Los Angeles, Otto Klemperer: mémoires biographiques se concentre sur la relation privilégiée qu’il a nouée avec l’orchestre anglais, sur son style de direction et ses grands enregistrements pour EMI (5099940440125). SC
L’incursion mozartienne de Philippe Herreweghe

On a déjà eu l’occasion de rendre compte de l’interprétation par Philippe Herreweghe et l’Orchestre des Champs-Elysées des trois dernières symphonies de Mozart, lors d’un très beau concert donné en avril 2012 à l’Opéra royal du Château de Versailles. Le plaisir éprouvé sur le moment s’atténue quelque peu à l’écoute du présent enregistrement réalisé en studio, à la MC2 : de Grenoble du 12 au 15 avril 2012, c’est-à-dire exactement à la même époque que le concert susmentionné. On ne boudera toutefois pas son plaisir. Les timbres de l’orchestre sont très beaux (la clarinette dans la Trente-neuvième, les cors dans la Jupiter, les cordes dans les trois) et la fraîcheur de la vision du chef flamand constitue à la fois des piliers de chacun de leurs disques et une des raisons pour lesquelles ont les écoute toujours avec intérêt. Néanmoins, sous couvert de vouloir décaper ces partitions, on regrette parfois une certaine sécheresse, voire précipitation dans le discours. Le premier mouvement de la Trente-neuvième gagnerait à prendre davantage son temps, de même que le mouvement lent de la Quarantième. En revanche, quel Andante cantabile que celui de la Quarante-et-unième, où le discours avance sans cesse, oscillant avec une grande justesse entre le drame et une certaine nonchalance! Même si certaines interprétations sur instruments d’époque se sont montrées plus convaincantes (Pinnock, Gardiner, Harnoncourt), cet enregistrement demeure évidemment tout à fait estimable (album de deux disques Phi LPH 011). SGa
Les Soldats prennent Salzbourg

Les Soldats (1957-1964) bénéficie encore de son aura d’opéra mythique, impossible et extrême, mais il ne saurait prétendre au statut d’œuvre maudite, car malgré ses exigences hors du commun, il apparaît régulièrement à l’affiche et n’est pas inédit en vidéo: Arthaus a publié la production présentée par Harry Kupfer en 1989 à Stuttgart, reprise en 1994 à l’Opéra Bastille, et que la Ruhrtriennale a autoédité la production de David Pountney, créée en 2006 à Bochum et reprise en 2008 à New York. L’opéra de Bernd Alois Zimmermann a même pris d’assaut, l’été dernier, la forteresse mozartienne et straussienne de Salzbourg: il y a une perversité indéniable à faire jouer par la Philharmonie de Vienne cette musique qui n’a rien perdu de sa charge de brutalité et de destruction mais Ingo Metzmacher (né en 1957) sait aussi tirer parti de la subtilité des musiciens lorsqu’ils accompagnent les chanteurs. Ceux-ci se jouent des difficultés techniques et investissent avec passion les périlleuses successions de grands intervalles qui caractérisent les parties vocales: bien que tout à fait représentatives d’une certaine époque, elles n’en paraissent ainsi point trop datées. La mise en scène et les décors du Letton Alvis Hermanis (né en 1965) tirent parti de la largeur hors norme de la Felsenreitschule, idéale pour un livret constitué de courtes séquences, qui peuvent ainsi se succéder ou se dérouler concomitamment en différents points de la scène: un décor unique dont les lits, tables, fauteuils et chaises permettent d’évoquer les lieux de l’action, devant un alignement d’arches vitrées, qui soit laissent entrevoir délibérément les coulisses, notamment les soldats et leurs (vrais) chevaux, soit servent d’écrans pour la projection de photographies licencieuses de la Belle époque. La dureté, la laideur et la noirceur des images ne relèvent pas ici de la provocation: elles ne sont que le reflet des excès d’une partition qui, deux heures durant, soumet l’auditeur à des coulées de lave en fusion et d’un livret dont le pessimisme apocalyptique narre la déchéance de Marie, le suicide de deux de ses amants et le naufrage d’une humanité et d’une soldatesque tout droit venues de Wozzeck. Le coup de poing est tout aussi musical que scénique: misère sociale et affective, dépravation, voyeurisme, dont une vitrine roulante aux parois transparentes, accueillant les dérisoires ébats des personnages, concentre toute la force symbolique (EuroArts/Unitel Classica DVD 2072588 ou Blu-ray 2072584). SC
Neeme Järvi fait briller Chabrier

Est-ce le chef, l’excellent et boulimique Neeme Järvi? Est-ce l’Orchestre de la Suisse romande, formé à la dure par son prédécesseur Marek Janowski? Est-ce la prise de son de ce SACD? Tout cela contribue sans doute à la rutilance de cet album au minutage généreux, consacré à l’essentiel de l’œuvre orchestral de Chabrier – Suite pastorale (tirée des Pièces pittoresques), Joyeuse marche, Espana, Bourrée fantasque (dans l’orchestration de Mottl), Habanera et le plus rare Lamento – ainsi qu’à des pages tirées de ses œuvres lyriques – L’Etoile (Ouverture et Entractes), Gwendoline (Ouverture) et Le Roi malgré lui («Fête polonaise» et «Danse slave»). Les textures instrumentales somptueuses et la direction, éclatante et musclée, frisent parfois le tape-à-l’œil et Chabrier se montre ici davantage comme un producteur de champagne à la Offenbach que comme l’inspirateur de Debussy, Ravel et Poulenc, mais il faut également reconnaître au chef estonien et à ses musiciens un vrai sens de la nuance et de l’expression (Chandos CHSA 5122). SC
Le Pelléas de Wilson passe à la postérité

Voici le Pelléas et Mélisande revu (et éclairé) par Robert Wilson à l’Opéra national de Paris en février et mars 2012, filmé par Philippe Béziat, auteur du poétique documentaire «Pelléas et Mélisande», le chant des aveugles (voir ici). Coproduit avec le festival de Salzbourg, le spectacle avait été créé en février 1997 à Garnier, où il fut repris en 2000, avant de migrer à Bastille en 2004 et même à Madrid en 2011. Les comptes rendus successifs mis en ligne sur ce site permettent de se faire une idée précise, exhaustive et, pour l’essentiel, sans surprise des choix esthétiques du metteur en scène américain. Assurément, les gestes si typés et les lumières si travaillées restent dans les mémoires – la fin du dernier acte, poignant malgré ou grâce à son dépouillement extrême, est trop tôt interrompue par les applaudissements: son travail a fait date dans cette œuvre et sa parution est donc bienvenue, dans une présentation soignée et originale (la reliure étant placée en haut, l’album s’ouvre de bas en haut, et non de gauche à droite). Pour ce qui est de la musique, on admire, dans cette reprise, la direction chatoyante et dramatique de Philippe Jordan, ovationné par ses musiciens, davantage que la distribution vocale, inégale quoique sans faiblesse rédhibitoire. Il n’est pas dit, par exemple, qu’on n’aurait pas préféré entendre Jérôme Varnier, impeccable Médecin, en Arkel, où Franz Josef Selig, somptueux comme à son habitude, manque cependant de clarté. Dans l’un des ouvrages lyriques les plus redoutables pour des non-francophones, Anne Sofie von Otter, inattendue en Geneviève et, plus encore, Elena Tsallagova Mélisande à l’aigu sûr et séduisant, constituent d’excellentes surprises. En Golaud, Vincent Le Texier qui, une décennie plus tôt, lorsque van Dam chantait ce rôle, n’était encore que le Médecin, s’impose davantage par son incarnation dramatique que par son chant, mais comment la comparaison avec le splendide Pelléas de Stéphane Degout pourrait-elle tourner à son avantage? On trouvera dans la section anglophone du site un autre compte rendu de cette nouveauté (Naïve DR 2159). SC
La (longue) vie de Brian

Havergal Brian (1876-1972) est l’homme des records: trente-deux Symphonies – certes moins que Hovhaness ou Segerstam – dont la Première «La Gothique» dure une heure trois quarts et requiert huit cents exécutants (dont près de deux cents musiciens) et dont les vingt-et-une dernières ont été écrites après l’âge respectable de quatre-vingts ans. Naxos publie son neuvième volume consacré au compositeur anglais, comprenant principalement trois symphonies concises (de 9 à 16 minutes), apparues en neuf mois seulement (1964-1965), alors qu’il était âgé de quatre-vingt-neuf ans: pour la Vingt-deuxième «Symphonia brevis», dont un enregistrement de près de quarante ans, antérieur à sa création publique en 1983, est aujourd’hui indisponible, comme pour la Vingt-troisième et la Vingt-quatrième, créées à titre posthume en 1973 et pour lesquelles il n’existait pas encore d’enregistrement autorisé, cet album apparaît difficilement contournable. Sous la direction d’Alexander Walker (né en 1973), directeur musical de l’Orchestre symphonique de Northampton, l’Orchestre symphonique d’Etat «Nouvelle Russie», dont le directeur artistique et chef principal est Youri Bashmet, brille davantage par ses cuivres que par ses cordes, mais sert remarquablement cette musique un tantinet revêche et hautaine, évoquant l’objectivité distante de Hindemith et à, un moindre degré, les teintes sombres de Honegger ou la calme solennité d’Ives. Soixante ans plus tôt, dans la Première (1904) de ses cinq Suites anglaises, dont il n’existait à ce jour qu’un seul enregistrement commercial, réalisé voici plus de trente ans, le style de Brian est nettement plus abordable mais manie le second degré et, malgré un caractère très composite, conserve une certaine originalité. S’ils semblent parfois sacrifier au genre (langoureux «Sous le hêtre») ou à l’air du temps, entre scintillements straussiens de l’orchestration («Interlude») et diverses traditions britanniques – de l’église («Hymne») à la «British light music» («Marche caractéristique»), – les six mouvements n’en offrent pas moins 25 minutes de bonheur simple, jusqu’à un turbulent «Carnaval» comprenant – on pense ici encore à Ives – une citation quasi irrévérencieuse de God Save the King. On comprend aisément que Brian, à la suite d’une première londonienne sous la direction de Henry Wood, ait connu l’un de ses premiers succès avec ces pages, qui soutiennent sans peine la comparaison avec les œuvres similaires de Holst à la même époque (8.572833). SC
Le violon de Tubin
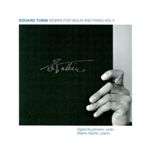
Sigrid Kuulmann (née en 1973) et Marko Martin (né en 1975) proposent un deuxième récital d’œuvres pour violon et piano de leur compatriote, Eduard Tubin (1905-1982). Le compositeur estonien avait une connaissance intime des deux instruments, sa préférence allant vers le violon pour lequel il composa en 1979, comme un dernier regard, alerte mais nostalgique, la Suite sur des danses estoniennes, écrite en Suède où il s’était exilé en 1944, fuyant l’occupation russe de son pays. D’un souffle encore postromantique, les autres œuvres, toutes écrites pour violon et piano comprennent un arrangement en 1974 de l’étourdissante «Danse du coq» de son ballet Kratt (1940) et, sur commande en 1945, un arrangement réussi du Vingt-quatrième Caprice de Paganini. Bénéficiant d’une excellente prise de son, Sigrid Kuulmann laisse chanter son beau violon, porté par le lyrisme scintillant du piano énergique de Marko Martin, dans de brèves partitions tels les Trois Pièces de 1933, la Méditation nacrée de 1938 ou le capricieux Capriccio n° 2 (1945) aux échos estoniens. Ecrit dès son arrivée en Suède, le Prélude est un chiaroscuro d’équilibre maîtrisé entre les deux instruments, le piano fluide et étincelant, le chant du violon plus sombre mais aux essors lumineux. La Première Sonate (1934) laisse pressentir le grand symphoniste à venir. C’est une pièce de haute tenue à la respiration ample, le thème central développé en arborescence à travers les trois mouvements, les textures à la fois denses et aérées. Les deux interprètes en livrent une lecture inspirée, magistralement épanouie (Estonian Record Productions ERP 6112). CL
Le violon de Delvincourt

Claude Delvincourt (1888-1954) reste avant tout connu comme directeur du Conservatoire national supérieur de musique de Paris de 1941 à sa mort, dans un accident de voiture alors qu’il se rendait à Rome pour la création de son Quatuor: entre les mandats très long de Rabaud (1920-1941) et très bref de Dupré (1954-1956), il fit entrer Messiaen et Milhaud dans le corps professoral et laisse, à la différence de son prédécesseur, l’image d’un homme courageux, qui, durant l’Occupation, appartint au Front national des musiciens et s’efforça de protéger au mieux ses élèves, créant l’Orchestre des cadets pour leur épargner le STO. Le compositeur est en revanche complètement oublié: élève de Boëllmann, Büsser, Caussade et Widor, il fut pourtant premier Grand prix de Rome en 1913 (ex-æquo avec Lili Boulanger), mais son séjour italien fut interrompu par la Première Guerre mondiale, durant laquelle il perdit l’œil gauche. L’infatigable curiosité de la collection «Un!erhört» de l’éditeur allemand Genuin et de deux de ses excellents musiciens attitrés, Ilona Then-Bergh et Michael Schäfer – ils ont déjà enregistré ensemble Andreae, Feinberg, Krein, Lazzari, Respighi et Sabaneev – vient à point nommé, car la Sonate pour violon et piano (1922), envoi final de Rome, que Jean-Marc Phillips-Varjabédian et François Chaplin avaient donné en concert en 1996, méritait d’être redécouverte: à la manière d’un Maurice Emmanuel, d’un Lucien Durosoir ou d’un Florent Schmitt, bien loin d’une certaine superficialité qui caractérise son époque et sans renier totalement un ancrage debussyste ou ravélien, elle surprend par sa densité, son audace harmonique, son originalité formelle et son refus de la facilité. Même le néoclassicisme un rien distant des cinq courtes Danceries («Ronde», «Bourrée», «Basquaise», «Louisiane» et «Farandole») de 1930 possède davantage la rugosité de celui de Roussel ou de Martinů que le confort de celui de Poulenc ou Françaix. Enfin, Contemplation (1935) révise avec bonheur la pièce de genre. L’album est complété par l’un de recueils pour piano seul de Delvincourt, Boccacerie (1922), sous-titré Cinq Portraits pour le «Décaméron», qu’il devait orchestrer en 1924: de brèves pages pleines d’esprit, de finesse et de légèreté, mais sans aucune superficialité (Genuin GEN 13271). SC
L’alto de Bréville, Koechlin et Tournemire

Après un premier album prudemment consacré à Brahms, Steven Dann (né en 1953) fait preuve, toujours chez Atma Classique, d’une tout autre originalité pour le deuxième, s’intéressant à trois compositeurs français de la même génération (1860-1870): en effet, dans ce programme, seule la Sonate (1915) de Charles Koechlin, la plus développée de ces trois partitions, a déjà fait l’objet d’enregistrements antérieurs. Créée par le jeune Milhaud, elle illustre la position à part tenue par le compositeur dans le paysage musical français de l’époque: il sait installer un climat tour à tour angoissant, aux limites de la tonalité, et lyrique, avec ces mélodies infinies, harmonisées de manière très recherchée, qui ne sont pas sans annoncer Messiaen. Dans sa Sonate, typiquement – et tardivement (1944) – franckiste, Pierre Onfroy de Bréville (1861-1949) fait preuve d’une longévité aussi «anachronique» que celle de R. Strauss. La Suite en trois parties (1897), dédiée à Monteux, est, au contraire, une œuvre de jeunesse de Charles Tournemire (1870-1939), dont l’atmosphère tour à tour mélancolique, robuste et joyeuse révèle moins un élève de Franck qu’une diversité inattendue d’influences. L’altiste canadien, accompagné par son compatriote James Parker (né en 1963), serait à remercier pour sa seule curiosité, mais il mérite aussi des éloges pour la pureté de sa sonorité, la rigueur de son archet et la sensibilité de son approche (ACD2 2519). SC
Solti ou comment rouler des mécaniques
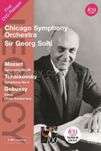
Le Chicago Symphony Orchestra brillait de tous ses feux ce 2 février 1985 au Royal Festival Hall de Londres. Dans une Trente-neuvième Symphonie de Mozart rigoureusement au point, Georg Solti, directeur musical à Chicago de 1969 à 1991, obtient un fini instrumental épatant: précision et suavité des bois, unité et ductilité des cordes. Eloignée de ce qui se pratique couramment aujourd’hui, cette interprétation tranchante ne tarde pas à convaincre. Suit une impressionnante et magnifique Quatrième de Tchaïkovski, qui offre l’occasion d’admirer les formidables pupitres de cuivres – parmi eux, le fameux corniste Dale Clevenger qui vient de prendre sa retraite après quarante-sept ans de bons et loyaux services. Les bois se distinguent également, en particulier le hautbois et le basson solistes. En guise de bis, le public a droit à «Fêtes», extrait des Nocturnes de Debussy. Les fanatiques du chef apprécieront probablement ce DVD, mais les autres pourront objecter que ces interprétations sont plus éclatantes que profondes (ICA Classics ICAD 5100). SF
Strasnoy ou comment pratiquer l’humour en musique

Dans Sum (2005-2011), cycle de quatre pièces pour orchestre, Oscar Strasnoy (né en 1970) remet en cause les fondements de la musique. Un peu comme dans la Sinfonia de Berio, le compositeur d’origine argentine cite – tantôt fugitivement, tantôt longuement – et exploite avec un malin plaisir des thèmes célèbres comme ceux du début de la Cinquième Symphonie de Mahler, du Finale de la Huitième de Beethoven et de la Sonate D. 960 de Schubert, dont la mélodie du Scherzo s’interrompt sans cesse dans ce processus de déconstruction ludique – dans Incipit, les oreilles exercées reconnaîtront peut-être le début du Château de Barbe-Bleue de Bartók. Dans Trois Caprices de Paganini (2011), pour violon et orchestre, Strasnoy s’amuse comme bien d’autres avant lui de ces pièces de virtuosité. Cette musique irrévérencieuse et recherchée ne s’impose pas d’elle-même au premier abord mais la notice permet de mieux en percevoir le sens. Durant ces concerts du festival Présences 2012, Susanna Mälkki et Dima Slobodeniuk se partagent l’excellent Orchestre philharmonique de Radio France (aeon AECD 1331). SF
Ashkenazy ou comment épater sans convaincre

Vêtu comme d’habitude d’un pull à col roulé, Vladimir Ashkenazy se produisait dans un studio de Glasgow ce 22 juin 1989, en présence de quelques spectateurs quasiment immobiles. A cause de l’image, triste, et du son, métallique, la visualisation de ce DVD procure peu de plaisir. Dès les Premier et Deuxième des trois Klavierstücke D. 946 de Schubert, le jeu paraît certes contrôlé mais aseptisé. Mieux mise en valeur, la Fantaisie «Wanderer» intéresse davantage: le pianiste, qui adopte une attitude sobre, l’interprète sans esbroufe. La Première Sonate de Schumann, anguleuse et restituée en deux dimensions, ne manque pas d’impressionner, grâce à son architecture rigide et à son énergie bien dosée, mais, comme l’Arabesque, elle s’oublie vite. Une archive de la BBC pour les inconditionnels du pianiste qui collectionnent la moindre trace de leur idole (ICA Classics ICAD 5101). SF
Aus Breslau, Krenek spielt auf

Le puissant style expressionniste d’Ernst Krenek (1900-1991) traverse les différentes périodes de sa trajectoire musicale, les pirouettes impertinentes, les flèches caustiques et les longs traits audacieux s’étiolant en des phrases d’une grande douceur qui se développent ou qui s’évanouissent. Compositeur autrichien contraint à l’exil en 1938, Krenek n’oublie en rien ses origines. Hormis Die Nachtigall, délicate mélodie irisée de 1931 plus proche de Schreker, admirablement mise en valeur par la voix éthérée de la soprano Agata Zubel, les œuvres au programme datent toutes des années 1970 et accusent une parenté avec les créations de ses aînés, Schönberg ou Wellesz, sans porter de signe de quelque influence américaine. Les quatre pièces héritent de son exploration du courant sériel reprise en force après 1945. Les dix volets de Statisch und Ekstatisch (1971-1972) et Von Vorn Herein (1974), alternent la riche élaboration d’une série de douze sons à une écriture libre aux réminiscences modales. Im Tal der Zeit (1979) se déverse comme un poème symphonique hardi et moderniste non dénué de sentiment. Le baryton Mathias Hausmann s’attaque avec panache aux difficultés du recitativo et du Sprechgesang de The Dissembler (1978), monologue pour voix et orchestre d’un cynisme amer sur un montage de textes de Krenek lui-même, révélateur de son état d’esprit à cette époque. Le programme entier épouse cet esprit, sans doute grâce à Ernst Kovacic, en phase, qui dirige l’Orchestre de chambre du Leopoldinum de Wroclaw avec beaucoup de fidélité et de conviction (Toccata Classics TOCC0125). CL
W. G. Berger: postromantisme roumain

La seule consonance du nom du Roumain Wilhelm Georg Berger (1929-1993) – à ne pas confondre avec l’Allemand Wilhelm Berger (1861-1911) – illustre la mixité culturelle de sa Transylvanie natale, sous influence germanique mais aussi tzigane. D’abord altiste de la Philharmonie «Georges Enesco» de Bucarest (1948-1957) et du Quatuor de l’Union des compositeurs (1953-1957), il s’est ensuite exclusivement consacré à ses activités de chef d’orchestre et de musicologue, tout en trouvant le temps d’édifier un très abondant catalogue, qui comprend notamment vingt-quatre symphonies et vingt-et-un quatuors (en quatre recueils) et auquel aucun CD n’avait semble-t-il jusqu’alors été consacré. Sans constituer une révélation fracassante, la découverte de cet univers ne manque pas d’intérêt: d’un éclectisme raisonné, Berger se disait avant tout influencé par Hindemith, mais son langage recourt à un spectre plus large, parfois plus nettement tonal, subtilement traversé de références populaires, parfois en revanche plus aventureux, jusqu’aux marges de la tonalité et de la série – même si la structure de ses séries est celle de suites de Fibonacci et ne s’apparente donc pas à un système de type dodécaphonique. Le tout sans parvenir à effrayer le régime, ce dont témoignent de nombreux prix et décorations et, surtout, ses fonctions de secrétaire de l’Union des compositeurs de 1968 à 1989, qui ne l’empêchèrent pas de devenir membre correspondant de l’Académie roumaine en 1991. De fait, du moins à en juger par cet album, la synthèse stylistique s’apparente globalement aux derniers feux du postromantisme, pas tant pour sa flamboyance expressive ou orchestrale que pour ses amples constructions d’apparence rhapsodique – deux mouvements de plus de vingt minutes chacun forment ainsi la Quatrième Symphonie (1964), sous-titrée «Tragique» – et pour son caractère lyrique, mélancolique, voire sombre. Mais cette musique, pétrie de références davantage que de citations, peut aussi faire songer à des compositeurs plus modernes, comme Bartók, Honegger ou, surtout, le Chostakovitch le plus intransigeant, celui de la Quatrième Symphonie, dans l’implacable puissance dramatique de certains passages ou dans le rôle confiés aux soli (hautbois dans le premier mouvement, flûte à la fin du second). Horia Andreescu (né en 1946), à la tête de l’Orchestre radio-symphonique de Berlin (celui de Marek Janowski), défend ardemment la mémoire de son compatriote et donne des clefs pour entrer dans un univers qui, nonobstant une syntaxe relativement familière, ne se laisse pas aborder aisément et conserve quelque chose de secret, sinon de mystérieux. Il accompagne en outre l’altiste allemand Nils Mönkemeyer (né en 1978), qui défend avec finesse et noblesse le Premier Concerto (1959), une œuvre, elle aussi, d’assez grande ampleur (une demi-heure), qui, malgré une atmosphère plus paisible, ne se départ guère d’une profonde nostalgie, même au détour du dynamique Finale à variations (cpo 777 756-2). SC
Un Dussek peut en cacher un autre

Attention! La jaquette du présent disque ne doit pas être lue trop rapidement car, contrairement à Jan Ladislav Dussek (1760-1812), qui bénéficie d’une petite notoriété, Franz (Frantisek) Xaver Dussek (1731-1799), auquel cet album est consacré, est un presque parfait inconnu (et sans rapport de parenté). On connaît très peu de choses de sa vie, Dussek faisant partie de ces compositeurs du centre de l’Europe qui ont prospéré durant la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui, malheureusement, sont très rapidement tombés dans l’oubli. Professeur de clavecin recherché à Prague, il semblerait que ce soit lui et sa femme, Josepha, une ancienne étudiante devenue soprano réputée pour laquelle il composa quelques airs, qui aient incité Mozart à venir dans la capitale tchèque afin d’y goûter le succès que ses opéras ne rencontraient pas forcément dans le reste de l’Europe. A tel point d’ailleurs que ce serait également chez Dussek, dans sa villa Bertramka (au cœur du quartier de Prague appelé Smichov, cette villa étant aujourd’hui devenue le musée Mozart de la ville), que Mozart aurait terminé la composition de Don Giovanni et aurait réalisé en grande partie celle de La Clémence de Titus. Deuxième opus de ses symphonies réalisé chez Naxos, les quatre que l’on entend ici sont assez typiques de ces compositeurs que l’éditeur a déjà contribué à réhabiliter, comme Vanhal, Dittersdorf, Cannabich, Sperger ou Hoffmeister. Dirigé avec entrain par Aapo Häkkinen (né en 1976), l’Orchestre baroque de Helsinki interprète avec un enthousiasme communicatif ces œuvres dont certains mouvements ne dépassent guère les deux minutes. La finesse du violon solo (dans l’Andante de la Symphonie G4) ou les sons suspendus en l’air des hautbois (dans celui de la Symphonie Bb2) sont autant d’agréables pauses au milieu de mouvements qui virevoltent comme cet Allegro assai de la Symphonie A3 ou ce non moins très beau Presto de la Symphonie G4 (là encore, quel hautbois!). Servi au surplus par une bonne notice, hélas seulement en anglais, ce disque est tout à fait recommandable et ravira les amateurs d’un répertoire sans prétention mais ô combien rafraîchissant (8.572683). SGa
Le tour de France de Stéphane Spira

Le pianiste Stéphane Spira (né en 1965), à ne pas confondre avec son homonyme saxophoniste de jazz, publie un album hors norme. Cette originalité tient d’abord au kitsch assumé de sa couverture, un hologramme en trois dimensions représentant l’artiste, vêtu d’un déguisement de superman et fendant les airs tout en jouant d’un piano volant. Mais il serait dommage de s’y arrêter, de même qu’il faut également oublier la notice (trilingue), qui se limite à une note d’intention et à une biographie du pianiste. Car au-delà de la cohérence géographique et même chronologique (1909-1943) du programme, c’est un «voyage musical en terroirs de France» qui est proposé: la Cerdagne du Haut-Garonnais Séverac, avec trois des cinq pièces de Cerdana, l’Auvergne du Puydomois Chabrier avec «Ballabile», deuxième des Cinq Pièces posthumes, et la Bourrée fantasque, puis la Bretagne du Trégorrois Le Flem, avec deux de ses grandes pages pianistiques, Avril et Par landes, et, pour finir, comme tout Tour de France qui se respecte, une arrivée dans la capitale, celle du Parisien Poulenc, avec la «Sicilienne», sixième des sept pièces de la Suite française (sur des thèmes de Claude Gervaise), un Intermezzo (en la bémol) et le Caprice en ut (d’après le Finale du Bal masqué). En fil rouge, comme autant de «Promenades», quatre des Préludes de Debussy – on arrive en Auvergne dans les «Brouillards» et on la quitte avec «Des pas sur la neige», tandis que «Le Vent dans la plaine» souffle sur la Bretagne et ce voyage en forme d’hommage à la musique française se conclut sur un clin d’œil, «Feux d’artifice» de Debussy citant en effet La Marseillaise. Mais ce plaisant concept serait resté vain si l’interprétation ne s’était pas montrée à la hauteur: à son aise dans tous ces paysages stylistiques pourtant fort différents, Spira aborde ces pièces sans arrière-pensées, avec naturel, fraîcheur et enthousiasme, davantage dans la générosité que dans l’articulation. Voici donc un Séverac qui trouve toute la place qui lui est due, entre Debussy et Albéniz, un Chabrier réjouissant de bonne santé, un Le Flem rayonnant, un Poulenc chaleureux et truculent, et, pour lier le tout, un Debussy résolument expressif et poétique (Spiriade). SC
Un Fidelio sans éclat

Comme le Don Giovanni chroniqué le mois dernier, le Fidelio mis en scène à Glyndebourne par Peter Hall (né en 1930), que réédite Arthaus, date de l’ère Haitink, à la fin de son mandat de principal conductor du Philharmonique de Londres (1967-1979) et au début de celui de directeur musical du festival. Comme pour cette précédente parution mozartienne, les sous-titres souffrent de nombreuses coquilles et, malgré des applaudissements à la fin de certaines scènes ou airs, le spectacle donne l’impression d’avoir été spécialement donné pour les besoins de la télévision, tant les chanteurs se tournent à point nommé – parfois trop ostensiblement – vers les caméras. Dans les décors traditionnels conçus par John Bury, la mise en scène, un peu à l’étroit sur le plateau de l’ancienne salle, demeure conventionnelle, mais coupe moins qu’il n’est d’usage dans les dialogues parlés. A la tête d’un orchestre une fois de plus acide et imprécis, le chef néerlandais tend ici aussi à s’engourdir, même dans des moments dramatiques, comme la Marche puis l’air de Pizarro au premier acte, et la distribution n’est guère stimulante. Il est certes intéressant d’entendre Elisabeth Söderström (1927-2009) dans le rôle de Léonore, auquel son nom n’est pas resté attaché, mais en dépit d’une incarnation très intense de son personnage, elle n’y est pas irréprochable. Le Florestan du Néerlandais Anton de Ridder (1929-2006) pâtit d’un timbre peu agréable (et de postiches assez ridicules). Le Suédois Curt Appelgren (né en 1943) est un Rocco bien jeune, manquant de profondeur et de rondeur, tandis que l’Australien Robert Allman (né en 1927) campe un Pizarro dépourvu de charisme vocal et scénique. Enfin, le naufrage de Michael Langdon (1920-1991) en Fernando est fort triste à entendre, de telle sorte que c’est le couple Marcelline/Jaquino formé par les Anglais Elizabeth Gale (née en 1948), une habituée du Glyndebourne des années 1970, et Ian Caley (né en 1948) qui s’en tire le mieux (102 307). SC
Des Quintettes de Brahms venus de Suède

Les deux Quintettes à cordes de Brahms restent, au concert comme au disque, dans l’ombre de ses Quatuors et de ses Sextuors. L’initiative des solistes de chambre d’Uppsala, issus, comme on peut s’en douter, de l’Orchestre de chambre d’Uppsala, est donc louable et prometteuse, mais elle ne laisse qu’un sentiment mitigé. L’interprétation ne manque pas de l’expression et de l’implication qu’appellent ces œuvres puissantes, lyriques et radieuses, mais la prestation instrumentale ne séduit pas, notamment en raison de l’aigreur et de la sécheresse de la sonorité – le fait qu’entre le Premier et le Second Quintettes, le premier violon et le second alto échangent leurs pupitres ne change hélas rien à l’affaire (Daphne 1045). SC
La trop timide Fantastique d’Andrés Orozco-Estrada

A la rentrée 2014, Andrés Orozco-Estrada (né en 1977) deviendra music director du Symphonique de Houston et Chefdirigent du Symphonique de la Radio de Hesse (Francfort), succédant respectivement à Hans Graf et Paavo Järvi: double consécration pour le Colombien, qui est, depuis 2009, chef titulaire du Symphonique basque et Chefdirigent de l’Orchestre des musiciens de Basse-Autriche. C’est à la tête de cette dernière formation qu’il donne une Symphonie fantastique pâle, conventionnelle, lente (55 minutes, avec toutes les reprises) – ce qui n’en fait pas moins un album bien court – et timide, sans ressort, presque indifférente: manquer de folie, de démesure et même d’envergure dans Berlioz est évidemment rédhibitoire. Le comble est que malgré ce manque d’engagement, il ne s’agit pas d’un enregistrement de studio mais d’une prise de concert, ce que laissent entendre les quelques imperfections d’une réalisation qui n’est pas rehaussée par un orchestre certes professionnel mais fort terne (Oehms Classics OC 869). SC
Le Quatuor Pacifica poursuit sa «Soviet Experience»

La maîtrise et l’audace du Quatuor Pacifica en font l’un des plus remarquables quatuors américains actuels. Après l’intégrale des Quatuors de Mendelssohn et de Carter, il poursuit celle des Quatuors de Chostakovitch (voir par ailleurs ici) par un troisième volume qui présente les quatre quatuors écrits entre 1964 et 1968. Acclamé en Amérique du Nord, le Quatuor se confronte en Europe à un public qui tient toujours en haute estime les différentes interprétations des Borodine légendaires, la jeune génération étant bien représentée par le brûlant Quatuor Danel. Ils font leurs preuves lors du finale réussi de l’énigmatique Neuvième qui, par ses rythmes rageurs, ses traits caustiques et son lyrisme soutenu, donne corps à ce qui était seulement alors pressenti. Leur interprétation limpide de l’impressionnant Dixième à l’équilibre classique en accuse le lyrisme douloureux sans rien manquer de l’expressivité énergique, chuchotée ou furioso. Un sentiment de poignant regret imprègne l’étrange Onzième, éclaté en sept brefs mouvements contrastés; peut-être à tort, les Pacifica le laissent dominer jusqu’à l’ironie désabusée, les traits violents et l’humour mordant de certains d’entre eux. Ils révèlent cependant toute leur maîtrise dans le Douzième, subtilement dodécaphonique au nez et à la barbe des autorités. Leur lecture confère aux climats changeants, âpres, grinçants, désespérés, une ligne directrice d’une urgence nécessaire culminant dans l’ironie suprême d’un rayonnant optimisme tonal et final. Le titre ambitieux de leur intégrale s’explique par la présence à chaque fois d’un autre compositeur de l’ère soviétique. Après Maïakovski et Prokofiev, ici c’est au tour de leur cadet Mieczyslaw Weinberg (1919-1995). Quoiqu’expressif, urgent et d’excellente facture, son Sixième Quatuor (1946), contemporain du Troisième de Chostakovich, son ami, n’a pas, dans cette interprétation, la force extrême de ce qui précède et serait à entendre dans un autre contexte (Cedille Records CDR 90000 138). CL
Francesco Piemontesi: pour Dvorák, pas pour Schumann

Septième disque... et septième éditeur pour Francesco Piemontesi (né en 1983), enrôlé cette fois-ci chez Naïve. Hélas, comme pour son album solo paru chez Claves, c’est ici un Schumann dont le Concerto est «corseté et tiré à quatre épingles» mais «manque de chair et de muscle, de passion et d’élan». Précautionneuse jusqu’à l’indifférence, fort peu vivante bien que captée en public (en décembre dernier), cette version n’est pas rehaussée par un Orchestre symphonique de la BBC bien terne et endormi, sous la direction de son ancien chef principal, Jirí Belohlávek, devenu chef honoraire en 2012. Au lieu de l’habituel Concerto de Grieg dans la même tonalité de la mineur, c’est celui de Dvorák qui complète le programme. Enregistrés en studio quelques jours plus tôt, les musiciens retrouvent un peu de nerf pour fouetter opportunément l’académisme du premier des trois principaux concertos du compositeur tchèque (V 5327). SC
La rédaction de ConcertoNet
|